Félix-Gabriel Marchand

11e premier ministre du Québec
24 mai 1897 au 25 septembre 1900
Libéral

Le fils
Félix-Gabriel Marchand est né le 9 janvier 1832, au domaine de Beauchamp, à Saint-Jean-sur-Richelieu (alors nommée Dorchester). Il est le fils de Mary MacNider, une femme de confession presbytérienne et d’ascendance écossaise, et de Gabriel Marchand, propriétaire terrien, négociant et officier supérieur dans la milice. Félix-Gabriel est le sixième et dernier enfant du couple. Le nouveau-né est baptisé deux jours plus tard par le prêtre J. E. Morisset dans la première église Saint-Jean-l’Évangéliste.
Jean-Jacques Lefebvre souligne que Félix-Gabriel est issu d’une famille notable du Québec. Il est « [l’] arrière-petit-fils d’un milicien, officier artilleur “tué par un boulet de canon” pendant le siège de Québec à l’été 1759, petit-fils d’un navigateur au long cours qui semble avoir péri en mer vers 1795, fils d’un négociant et officier supérieur de la milice qui, avec ses frères, a laissé son nom à la fondation de la première paroisse d’une ville du Richelieu, Saint-Jean, devenue, un siècle plus tard, centre industriel et militaire ».
Sur le père de Félix-Gabriel, Lionel Fortin raconte qu’après « des études au Séminaire de Québec, [Gabriel Marchand] devenait commis dans l’important établissement de l’Écossais John MacNider, situé rue de la Fabrique à Québec. Quelques années plus tard, il était promu gérant de cette maison de commerce. C’est à ce titre qu’il vint ouvrir à Saint-Jean, en 1802, un bureau et des entrepôts pour recevoir le bois qu’on allait alors chercher sur les bords du Lac Champlain. De Saint-Jean, port de transit, tout le bois était ensuite acheminé jusqu’à Québec, au siège social de la “MacNider firm”. À l’époque où Gabriel Marchand s’installait à Saint-Jean, la ville était surtout habitée par des loyalistes américains. Ce détail expliquera peut-être son [premier] mariage à Saint-Jean, le 1er janvier 1807, avec Amanda Bingham, fille d’Abner Bingham et d’Abigail Lane, originaires de Hero Island, près du lac Champlain, aux États-Unis. De cette union, qui sera de courte durée, naît une fille, Françoise, le 24 septembre 1807. L’enfant meurt âgée d’un mois le 30 octobre 1807. Un an et demi plus tard, Amanda elle-même décède le 5 mai 1809, âgée de 25 ans. Elle est inhumée, le 8 mai 1809, dans le cimetière protestant de Saint-Jean qui sera plus tard celui de l’église Saint James. Le veuvage de Gabriel Marchand dure un an. Le 6 octobre 1810, à l’église anglicane de Québec, il épouse, en secondes noces, Mary MacNider, fille de son patron, John MacNider et de sa première épouse Mary Hanna. »
Alex Tremblay Lamarche précise que Félix-Gabriel « est élevé dans la religion de son père, mais dans la langue de sa mère. Ses parents comprennent toutefois que la région, marquée par une forte présence anglo-protestante au début du XIXe siècle, est en train de se franciser et qu’il est important que leur progéniture s’exprime dans la langue de Molière. »
Issu d’une famille bien nantie, Félix-Gabriel a le privilège de recevoir un enseignement privé à l’école anglo-protestante St. John’s Classical School. En 1843, il poursuit ses études au Collège de Chambly où il apprend finalement le français. Malgré quelques difficultés au début, Félix-Gabriel maîtrise de mieux en mieux le français, assez qu’il le placera au cœur de sa vie professionnelle en devenant auteur et journaliste à l’âge adulte. En 1845, il fait son entrée au séminaire de Saint-Hyacinthe.
Selon Alex Tremblay Lamarche, « Félix-Gabriel ne termine toutefois vraisemblablement pas ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe. Après y avoir fait sa syntaxe, sa méthode, sa versification et ses belles lettres, il y commence sa rhétorique à l’automne 1849, mais quitte les lieux en décembre ou en janvier pour entamer sa cléricature. Il n’y reste cependant pas bien longtemps puisqu’il part à la découverte de l’Europe. »
Le 10 mai 1853, suite au décès de son père en 1852, Félix-Gabriel hérite de la terre paternelle au domaine de Beauchamp. Lionel Fortin ajoute que « peu après, Félix-Gabriel Marchand transforma le vieux domaine paternel de Beauchamp en ferme modèle et expérimentale. Il acheta, dans ce but, les instruments aratoires les plus nouveaux, fit les greffes les plus audacieuses et sema les graines les plus originales. Les essais du jeune agriculteur furent bientôt d’un grand intérêt dans la région lorsqu’on vit apparaître, sur le marché de Saint-Jean, les “pois de M. Marchand”, une espèce précieuse appelée de son vrai nom “pois momies”. Grand amateur de chevaux, Marchand avait la réputation d’être un habile “sportman” dans les courses équestres. Il eut des chevaux “imbattables” qui faisaient la convoitise des connaisseurs. À de nombreuses occasions, le propriétaire de Beauchamp reçu des acheteurs venant parfois de loin pour acquérir des sujets chevalins de “son ordre”. »
LE FILS


Selon Lionel Fortin, « C'est dans la première église, bâtie en 1828 que fut baptisé Félix-Gabriel Marchand 1832. Les photographies [ci-haut] nous montrent ce qui subsiste de cette bâtisse dont le portail se trouvait placé du côté est, face à l'actuelle rue Jacques-Cartier. En 1861, lors de l'agrandissement de ce temple religieux qui devint plus tard Cathédrale, on conserva une partie de la nef du vieil édifice pour le chœur et la sacristie de la nouvelle église. Sa façade fut alors établie du côté ouest, sur la rue Longueuil. »
Photographie de ce qui reste de la première église de Saint-Jean, lieu de baptême de Félix-Gabriel Marchand en 1832. 1979.
Collection Lionel Fortin

Acte de baptême de Félix-Gabriel Marchand. 1832
Collection Marilou Desnoyers

Photographie de Félix-Gabriel Marchand enfant. Vers 1845.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec



Livre Travels through the northern parts of the United States, in the years 1807 and 1808, volume II de Edward Augustus Kendall
signé par Gabriel Marchand, père de Félix-Gabriel Marchand, et sauvé de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1809.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Compte du St. John's Classical School où étudient Charles et Félix-Gabriel, les fils de Gabriel Marchand. Le document porte une mention de paiement.
Facture scolaire pour Félix-Gabriel Marchand au St. John's Classical School. 19 août 1843.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Compte du Collège de Chambly par matériel scolaire et divers avec mention de paiement. 1er semestre : 1839-40. 15 décembre 1839.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Grammaire françoise de Félix-Gabriel Marchand lorsqu'il étudie au séminaire de Saint-Hyacinthe (Collège de Saint-Hyacinthe) et sauvée de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1846.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Photographie de Félix-Gabriel Marchand. Vers 1867.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe Boisseau
Domaine de Beauchamp
Félix-Gabriel Marchand est né et passe une bonne partie de sa vie au domaine de Beauchamp. Quelques jours après sa mort, le journal Le Soleil présente dans son édition du 27 septembre 1900, ce domaine comme « un peu à l’écart du village [de Saint-Jean], en un varisant vallon ombragé de peupliers sur les bords du Richelieu ». Selon Lionel Fortin, « ce domaine se composait de trois terres adjacentes qui se trouvent actuellement dans la partie nord-est de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces trois terres qui mesurent ensemble au total treize arpents de largeur par trente arpents de profondeur et qui sont situées dans la première concession sur la rivière Richelieu […]. C’est sur ce domaine de Beauchamp, aujourd’hui subdivisé en plusieurs lots, que sont érigés l’Hôpital du Haut-Richelieu, la polyvalente [Chanoine-]Armand-Racicot, plusieurs édifices commerciaux ou communautaires, ainsi que de nombreux immeubles à appartements. C’est également sur cet ancien site que passe [l’autoroute] 35 menant au pont Félix-Gabriel Marchand, qui enjambe la rivière Richelieu. »
Selon le témoignage de l’ex-propriétaire du site, que rapporte Lionel Fortin, « la maison natale de Félix-Gabriel Marchand était de style vernaculaire, faite de pièces sur pièces et lambrissée de lattes à la verticale, comme plusieurs maisons de cette époque. C’était de plus une maison à deux étages et à pignon. » Quelques années avant 1924, la maison Marchand est transportée à environ deux cents pieds plus au sud. En 1924, des travaux sont exécutés sur la maison. On enlève le toit à pignon et on y ajoute un second étage couvert par un toit à quatre versants. Aussi, elle est agrandie du côté ouest par la construction d’une rallonge.
De nos jours, il reste très peu de choses de ce domaine. La maison natale de Félix-Gabriel est démolie depuis 1993 ainsi que toutes les bâtisses de ferme. Les maisons, les appartements, les commerces occupent tout l’ancien domaine. Il ne reste qu’un parc, parc du Domaine-de-Beauchamp, à l’intersection des rues Champlain et Lesieur qui rappel ce lieu où est né et a vécu le 11e premier ministre du Québec.




Sur ce plan de la ferme de Félix-Gabriel Marchand située dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu figurent les bâtiments, les terres cultivées et les types de culture.
Plan de la ferme de Félix-Gabriel Marchand à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vers 1858.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Sur ce plan recto verso de la terre de Beauchamp pour les années 1857-1858 et 1858-1859 située dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu figurent les bâtiments, les terres cultivées et non cultivées identifiées par parc, prairies et bois et les types de cultures. Mentions sur le plan : Grand bois, Parc, Petit bois occupé comme parc, Prairies nouvelles, Vieilles prairies, orge, graine de foin, blé d'Inde, avoine, pos, patate, carottes, betteraves, légumes divers, jardin, verger, basse-cour.
Plan de la ferme de Félix-Gabriel Marchand à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre 1857 et 1859.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec



Photographies de la maison natale de Félix-Gabriel Marchand au 750 de la rue Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Années 1990.
Collection Journal Le Canada Français







Photographies de la démolition de la maison natale de Félix-Gabriel Marchand au 750 de la rue Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 7 mai 1993.
Collection Journal Le Canada Français
Photographe Jacques Paul

Article du journal Le Canada français sur la démolition de la maison natale de Félix-Gabriel Marchand. 12 mai 1993.
Journal Le Canada Français

Photographie du parc du Domaine-de-Beauchamp situé à où se trouvait la maison natale de Félix-Gabriel Marchand et une partie du domaine.
Collection Dave Turcotte
Transposition du domaine de Beauchamp sur la carte de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 1979.
Collection Lionel Fortin
Plan des lots 81, 82, 83 et 84 constituants le domaine de Beauchamp. 1979.
Collection Lionel Fortin
Localisation des bâtisses sur le lot 82 du domaine de Beauchamp. 1979.
Collection Lionel Fortin
Photographie de la maison natale de Félix-Gabriel, telle que transformée en 1924. 1979.
Collection Lionel Fortin
Le père
Félix-Gabriel — que sa petite fille, Hélène Grenier, décrit comme un homme de taille élevée, de type roux, la moustache et les favoris abondants — fait la rencontre, en mai 1853, d’une jeune femme de Terrebonne, Hersélie Turgeon, qui est aussi son arrière-cousine. Elle est la fille de Louis Turgeon et de Pélagie Marchand.
Lionel Fortin relate que « ce fut tout de suite le coup de foudre, et leurs fréquentations ne tardèrent pas à devenir régulières, à compter de septembre 1853, par le truchement de lettres où les deux amoureux échangeaient leurs sentiments. Cette période de correspondance dura une année pendant laquelle Félix-Gabriel et Hersélie eurent le bonheur de se revoir à quelques reprises, soit à Terrebonne, à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Montréal. Puis ce fut la “grande demande” en mariage et les préparatifs dans l’attente de ce beau jour. »
Le 12 septembre 1854, c’est le grand jour. Le mariage a lieu en l’église Saint-Louis-de-France à Terrebonne. Il est présidé par le curé Théberge en présence de nombreux parents et amis. Le couple Marchand s’installe à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la terre paternelle dans le domaine de Beauchamp.
De cette union, onze enfants voient le jour :
-
Louis-Gabriel-Félix (2 juillet 1855 – 5 août 1855),
-
Marie-Hersélie-Eugénie (31 octobre 1856 – 5 février 1926),
-
Joseph-François-Gabriel (29 janvier 1859 – 16 septembre 1910),
-
Marie-Sophie-Elodie (25 août 1860 – 10 septembre 1876),
-
Joséphine-Hersélie-Henriette (5 décembre 1861 – 2 mars 1925),
-
Marie-Hélène (1er décembre 1863 – 7 mai 1953),
-
Marie-Ida-Agnès (6 mars 1865 – 30 août 1951),
-
Pierre-Charles-Edouard (28 avril 1866 – 1er août 1866),
-
Joseph-Edouard-Lin (23 septembre 1867 – 17 juillet 1868),
-
Marie-Cécile Ernestine (19 mai 1869 – 18 octobre 1943),
-
Joseph-Edouard-Alexandre (28 février 1871 – 21 juin 1871).
Alex Tremblay Lamarche relate que « la santé fragile d’Hersélie amène Félix-Gabriel à s’engager davantage que bon nombre de pères de l’époque dans l’éducation de ses enfants quand il est à Saint-Jean. […] Bien que la distance ne permette pas toujours à Félix-Gabriel Marchand d’être auprès de ses enfants lorsqu’ils sont malades, il s’assure qu’ils puissent disposer de tout ce dont ils auront besoin pour briller plus tard en société en leur offrant une éducation religieuse, littéraire et politique de premier ordre. Il envoie ainsi son fils au séminaire de Saint-Hyacinthe et vraisemblablement toutes ses filles au couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Saint-Jean. […] Quand le parlement siège et qu’il n’est pas en mesure d’être à la maison, il se tient tout de même au courant de la vie de ses enfants en les invitant à lui écrire pour qu’il puisse évaluer leur progression et demande des nouvelles de sa progéniture à sa femme et à ses filles les plus âgées. »
Lionel Fortin rapporte que « Félix-Gabriel s’attacha à développer chez ses enfants le goût des choses de l’esprit qu’il cultivait lui-même. Souvent la table familiale fut l’endroit privilégié pour de longues discussions sur les arts et les lettres, ce qui n’était pas sans stimuler tous et chacun à l’étude et à la lecture. Dans cette œuvre éducative, il était secondé par son épouse Hersélie, qui elle-même possédait un bagage de connaissances acquis au Couvent Saint-Roch, à Québec. Ce climat familial devait favoriser l’éclosion des talents de Gabriel et de Joséphine pour la littérature et le journalisme, et celui d’Ernestine dans le domaine du chant et du théâtre. »
Alex Tremblay Lamarche écrit : « pendant que Félix-Gabriel Marchand s’impose dans la sphère publique […], sa femme veille sur leurs enfants tout en entretenant les réseaux de sociabilité par le biais de correspondances, de thés et d’activités de charité. Les femmes jouent un rôle clef dans la sphère politique à cette époque en appuyant leur mari dans leurs fonctions et en œuvrant à l’occasion en coulisse pour influencer certaines décisions. Si cela ne semble pas être le cas d’Hersélie autant que ça le sera de Joséphine, il n’en demeure pas moins qu’elle joue un rôle actif. Elle participe à des manifestations politiques, offre des concerts lorsque son époux accède à la présidence de l’Assemblée législative et entretient des liens avec des femmes influentes du Parti libéral. »
Alex Tremblay Lamarche mentionne que « Marchand amène aussi à l’occasion certains de ses enfants à Québec pour les introduire dans la bonne société tout en les initiant à la vie politique. En plus de pouvoir suivre les travaux de l’Assemblée législative depuis les tribunes, ses enfants font la connaissance de plusieurs hommes politiques et échangent sur le sujet avec leur père tant et si bien que Félix-Gabriel en vient à écrire en 1878 à sa fille Joséphine qu’elle devient “plus rouge que [s]on père”. Celle-ci ne tarde d’ailleurs pas à se joindre aux rassemblements politiques organisés par le Parti libéral comme certaines de ses sœurs et son frère lorsqu’ils deviennent en âge d’y participer. »
Le 3 octobre 1868, Félix-Gabriel fait l’acquisition d’un terrain dans le Vieux-Saint-Jean d’aujourd’hui, sur lequel il fait bâtir, au cours de l’été 1869, une belle maison à deux étages en brique de style Second Empire. Cette demeure située au 126 de la rue Saint-Charles, à Saint-Jean-sur-Richelieu, est encore debout aujourd’hui, quoique transformée en partie.
Alex Tremblay Lamarche explique que « la maison familiale fait aussi une belle place aux personnalités politiques et littéraires. Les Marchand y reçoivent des amis de Montréal ou de Québec ou certains de leurs concitoyens. Le salon de leur résidence de la rue Saint-Charles s’impose comme “le rendez-vous d’une société d’élite” et voit ainsi défiler des notables tels que Louis Fréchette et Honoré Mercier. Quand il ne reçoit pas, Félix-Gabriel Marchand aime s’installer dans sa bibliothèque pour y lire les journaux du soir ou pour écrire pendant que sa femme lit ou tricote à ses côtés. »
Le 23 février 1872, Félix-Gabriel vend à son frère Charles le domaine de Beauchamp. Quant à sa résidence rue Saint-Charles, étant devenu premier ministre du Québec et devant passer presque tout son temps dans la capitale nationale, Félix-Gabriel la vend à son gendre, le sénateur Raoul Dandurand, le 28 janvier 1898.
LE PÈRE


Portraits d'Hersélie Turgeon et Félix-Gabriel Marchand peints par l'artiste Alfred Boisseau en 1862.
Collection Dave Turcotte
Photographe Musée du Haut-Richelieu

Photographie de la famille de Félix-Gabriel Marchand. Vers 1887.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe Livernois

Photographie de la famille de Félix-Gabriel Marchand à la campagne. Vers 1890.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Photographie de la maison de la famille Marchand au 126 de la rue Saint-Charles, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Années 1890-1900.
Bibliothèque et Archives du Canada

Photographie de la maison de la famille Marchand au 126 de la rue Saint-Charles, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 2022
Collection Dave Turcotte


Selon Alex Tremblay Lamarche, « plusieurs des activités auxquelles les Marchand participent mêlent en fait anglophones et francophones, catholiques et protestants. Par exemple, en 1879, à l’occasion du 25e anniversaire de mariage de Félix-Gabriel et de son épouse, un groupe d’amis leur fait parvenir une théière gravée à leurs noms ainsi que des vœux et compliments pour souligner l’heureux évènement. Le document est signé tant par des francophones que par des anglophones. »
Théière sur pied reçue en cadeau par Hersélie et Félix-Gabriel Marchand pour leur 25e anniversaire de mariage. 1879.
Collection Dave Turcotte
Photographe Musée du Haut-Richelieu

Cette chaise a été acquise par le médecin Émile Phaneuf lorsque la maison de la rue Saint-Charles a été vidée après le décès de Félix-Gabriel Marchand.
Chaise de la demeure familiale de Félix-Gabriel Marchand. Avant 1900.
Collection Michel Phaneuf
Photographe Musée du Haut-Richelieu

Ustensiles de chasse en argent utilisés par Félix-Gabriel Marchand, notamment lorsqu'il recevait à souper Honoré Mercier, autre premier ministre québécois originaire du Haut-Richelieu.
Ustensiles de cuisine. Avant 1900.
Collection Dave Turcotte
Photographe Musée du Haut-Richelieu


Livre The Fourth Book of Reading Lessons ayant appartenu à Félix-Gabriel Marchand. Frères des écoles chrétiennes et sauvé de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1877.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Canada Français

Photographie des enfants de la famille de Félix-Gabriel Marchand.
Vers 1866.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Photographie d'Ernestine avec son père Félix-Gabriel Marchand.
Vers 1875.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Joséphine Marchand et son conjoint Raoul Dandurand figurent au centre droit de cette photographie.
Photographie de la famille de Félix-Gabriel Marchand à Pointe-au-Pic. 1898.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Raoul Dandurand, conjoint de Joséphine Marchand, est nommé sénateur par le premier ministre canadien Wilfrid Laurier en 1898 et le demeure jusqu'à sa mort le 11 mars 1942. Il est président du Sénat du Canada de 1905 à 1909. En 1925, il devient président de l’Assemblée de la Société des Nations (SDN).
Buste de Raoul Dandurand par l'artiste Alfred Laliberté. Vers 1935.
Musée national des beaux-arts du Québec
Photographe Musée du Haut-Richelieu
Joséphine Marchand

Photographie de Joséphine Marchand. Vers 1880.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe J. E. Livernois
Joséphine Marchand épouse le 12 janvier 1886, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l’avocat Raoul Dandurand (sénateur de 1898 à 1942) qui joue un rôle important au sein de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. C’est le chef de l’opposition et futur premier ministre du Québec, Honoré Mercier, qui agit à titre de témoin pour le marié.
Tout comme son père, Joséphine Marchand développe son intérêt pour la lecture et l’écriture. Elle rédige son journal intime de 1879 jusqu’en 1900. Son mari n’aura accès à cette production qu’au lendemain de son décès. Pionnière du journalisme au Québec, Joséphine Marchand écrit de nombreux articles, en utilisant les pseudonymes de Josette, Josephte, Météore ou encore Marie Vieuxtemps, pour divers journaux et périodiques, dont La Patrie, L’Opinion, La Revue moderne et Le Monde illustré. Dès l’âge de 17 ans, ses contes et nouvelles paraissent dans Le Franco-Canadien, journal que son père a fondé. En 1893, elle lance la première revue féminine québécoise, Le Coin du feu. Ce mensuel qui paraît jusqu’en décembre 1896 est la première publication de langue française à être dirigée par une femme au Canada. Soucieuse de soutenir l’alphabétisation et la lecture dans les milieux défavorisés, elle fonde en 1898 l’Œuvre des livres gratuits, « une bibliothèque ambulante » qui expédie des livres gratuitement à des particuliers et à des institutions partout au Québec.
Une des premières féministes québécoises, elle est déléguée du Canada à Paris lors du Congrès international des femmes, convoqué à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. Elle s’occupe de la section féminine de l’Association nationale Saint-Jean-Baptiste, donne des conférences au Conseil national des femmes du Canada (dont elle est la directrice) et au premier Congrès de la langue française tenu à Québec en 1912.
Elle décède le 2 mars 1925, à sa résidence de la rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, après plusieurs années de maladie.
En 2020, elle est désignée personnage historique du Québec par le gouvernement québécois.
Gabriel Marchand
Les pommes ne tombent jamais loin de l’arbre. Gabriel Marchand marche dans les pas de son père vers le droit, le journalisme et la politique. Il est d’abord rédacteur au journal de son père Le Franco-Canadien de 1882 à 1885. Admis au Barreau le 11 juillet 1884, il exerce sa profession d’avocat à Saint-Jean, puis émigre aux États-Unis où il fonde le journal Le Ralliement à Holyoke, au Massachusetts. En 1887, il revint au pays et devient secrétaire de son père alors président de l’Assemblée législative. Il est nommé protonotaire du district de Saint-Jean le 3 octobre 1891.
Il prend la relève de l’œuvre de son père en devenant le propriétaire et rédacteur du journal Le Canada français du 17 juin 1898 au 24 juillet 1908, puis gérant et directeur général de la Compagnie de publication du Canada français de 1908 à 1910. Il se donne à l’écriture en étant l’auteur notamment d’un livret d’opérette et de la pièce de théâtre Le Timide en 1903 qui fait un tabac au Théâtre des Nouveautés de Montréal. Il sera d’ailleurs décoré des Palmes académiques du gouvernement français le 31 mars 1904.
Il est impliqué dans le monde des affaires à titre de président de la Compagnie d’exposition de Saint-Jean de 1902 à 1904 et de vice-président de la St. John’s Electric Co. en 1902. En politique, il est commissaire d’école à Saint-Jean de 1908 à 1910, échevin au conseil municipal de Saint-Jean de février à octobre 1908. Il est élu député libéral dans Saint-Jean le 8 juin 1908.
Il décède en fonction à sa résidence de Saint-Jean (134 de la rue Saint-Charles, à Saint-Jean-sur-Richelieu), le 16 septembre 1910, à l’âge de 51 ans et 7 mois, des suites d’une syncope.

Photographie de Gabriel Marchand. 1908.
Assemblée nationale du Québec
Le notaire
Après ses études au Séminaire de Saint-Hyacinthe, Félix-Gabriel est admis à l’étude de la profession de notaire, le 15 février 1850, par la Chambre des notaires de Montréal. Le 18 février 1850, il devient clerc au bureau de Me Thomas-Robert Jobson, à Saint-Jean.
Selon son brevet de cléricature : « Ledit Félix-Gabriel Marchand promet d’assister jour par jour, en l’étude du dit Me Jobson, aux heures qui lui seront fixées par le dit Me Jobson, d’obéir à tout ce que ce dernier lui commandera de licite et d’honnête, d’éviter son dommage et de l’en avertir toutes les fois qu’il en aura connaissance, de garder un secret absolu sur toutes les affaires professionales [sic] et autres du dit Me Jobson et faire tous les ouvrages accoutumés dans une étude de notaire, sous les directives du dit Me Jobson, et de ne jamais s’absenter, pendant les heures à être fixées comme susdit, du bureau du dit Me Jobson, sans sa permission spéciale dûment obtenue. Et de sa part, le dit Me Jobson promet d’enseigner au dit Félix-Gabriel Marchand la science du notariat et tout ce qui y appartient et lui permet l’usage des différents livres de loi et autres formant partie de sa bibliothèque et nécessaires à l’acquisition de ladite science du notariat. »
La même année, Félix-Gabriel s’embarque avec son ami Henry Tugault pour la France. Malgré ses hésitations, le père de Félix-Gabriel lui permet finalement de faire ce périple hors du commun pour l’époque. Le voyage en voilier dure six semaines.
Dans son œuvre Mélanges poétiques et littéraires, Félix-Gabriel décrit ce voyage dans son texte Un tour de France sous la seconde république. Jean-Jacques Lefebvre avance qu’il « semble que Félix Marchand y ait été présenté au héros politique, d’un moment, de la deuxième république de 1848, le grand écrivain, Lamartine qui était […] au comble de sa gloire littéraire, mais déjà au déclin de sa vie politique, et de sa fortune engloutie selon son biographe Luppé, en ses aventures électorales. Félix Marchand conserva longtemps une lettre de Lamartine. Hélène Grenier, [petite-fille de Félix-Gabriel Marchand], regrette qu’on ne l’ait pas retrouvée dans les papiers de sa succession. »
Marilou Desnoyers raconte que « dans une lettre datée du 30 juin 1850, Gabriel Marchand écrit à son fils Félix-Gabriel que les Tugault souhaitent ardemment, tout comme lui, le retour de leur enfant. » Félix-Gabriel est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu en septembre 1850 et il termine son stage.
Reçu notaire le 20 février 1855
Il est reçu officiellement notaire le 20 février 1855 et ouvre une étude à Saint-Jean. Alex Tremblay Lamarche explique qu’il « pratique d’abord seul, il travaille aussi en collaboration avec quelques confrères puisque la loi exige la signature d’un second notaire sur tout acte notarié. »
Jean-Jacques Lefebvre relate que « fervent des exercices au grand air, [Félix-Gabriel] se [rend] à pied, de sa demeure à son étude en ville, et pour ses affaires judiciaires. » En décembre 1869, Félix-Gabriel déménage son bureau de notaire à sa nouvelle résidence au 126 de la rue Saint-Charles, à Saint-Jean-sur-Richelieu. En août 1877, il déménage sa pratique dans un édifice toujours debout et situé aujourd’hui au 196 de la rue Jacques-Cartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Jean-Jacques Lefebvre mentionne que « sa calligraphie était haute, ferme et claire. » Alex Tremblay Lamarche affirme que Félix Gabriel est « un notaire apprécié qui compte une importante clientèle d’affaires au sein de laquelle on retrouve des industriels […], plusieurs banques locales, la corporation municipale et la fabrique de la paroisse de Saint-Jean. »
En 1874, il s’associe avec le notaire Charles-Thomas Charbonneau jusqu’au décès de ce dernier, le 11 janvier 1893. Alex Tremblay Lamarche ajoute que « Charbonneau devient un précieux collaborateur sur lequel Marchand peut se fier lorsque ses fonctions politiques l’appellent à Québec. En son absence, Charbonneau veille non seulement sur leur cabinet, mais aussi sur la famille de son confrère. »
Dès le 19 janvier 1893, Félix-Gabriel s’associe avec le notaire Alfred-Noé Deland, qui a d’ailleurs fait partie de l’association avec le notaire Charbonneau pendant une courte période (1889 à 1891). L’association « Marchand & Deland, notaires » sera la dernière de Marchand. Alex Tremblay Lamarche précise qu’en « 1896, les deux hommes accueillent un nouveau clerc : Télesphore Brassard. Ce dernier conservera un vif souvenir de Félix-Gabriel Marchand même s’il eut davantage l’occasion d’œuvrer auprès de Deland. Aux dires de Brassard, le pupitre de Marchand est couramment couvert de distiques et de quatrains écrits sur des bouts de papier çà et là. C’est un travailleur acharné qui n’en reste pas moins pour autant épris de poésie et de littérature. Il lui arrive couramment de griffonner “sous le souffle de l’inspiration, des ébauches de poèmes aux vers inachevés manquant soit d’une rime, soit d’un pied, soit d’une épithète, accolés à des vers qui boitaient pour avoir trop de pieds”. »
Président de la Chambre des notaires de 1894 à 1897
Lionel Fortin souligne que « Félix-Gabriel Marchand aimait beaucoup la profession de notaire. Il n’est donc pas étonnant de le retrouver parmi ceux qui s’intéressèrent à son progrès. Élu membre de la Chambre des notaires du district d’Iberville, le 17 septembre 1860, lors de sa formation, il y tint la charge de trésorier. Il y fut réélu en 1863, 1866 et 1869. En 1870, lors de la création de la Chambre des notaires du Québec, il y fut élu pour représenter le district d’Iberville en 1870, 1873, 1876, 1879. Il siégea ainsi sans interruption pendant douze ans (1870-1882). Il céda ensuite sa place à des confrères plus jeunes. Mais, en 1894, ses confrères du district d’Iberville le réélisaient encore une fois à la Chambre des notaires qui l’appela alors à la présidence pour le triennat de 1894-1897. Son terme achevé, il continua à siéger comme simple membre de la Chambre de 1897 à 1900. »
En 1892, Félix-Gabriel publie le Manuel et Formulaire général et complet du notariat de la province de Québec. Alex Tremblay Lamarche décrit qu’il « n’hésite pas à intervenir à l’Assemblée législative sur les questions touchant la pratique de son métier et s’engage dans la rédaction d’un ouvrage ayant pour but de “procurer à ceux qui se destinent au notariat la connaissance aussi exacte et aussi complète que possible de l’histoire de cette profession, des devoirs qu’elle impose, des lois ou des doctrines légales qui la régissent, ainsi que de la forme et du style des actes”. Son manuel connaît un accueil assez favorable puisque, contrairement à bien d’autres ouvrages publiés dans la province à la même époque, il ne se contente pas de reprendre des modèles français, mais en propose plusieurs adaptés aux réalités québécoises. »
Jean-Jacques Lefebvre relate qu’en tant que député, « il n’eut de cesse de proposer jusqu’à ce qu’il eut gain de cause, en 1894, le projet de loi d’abolition de la communauté de biens. En 1885, il y proposa une société d’assurance mutuelle pour la profession, mais le projet était prématuré. » Il aimait tellement sa profession que selon Lefebvre, « Félix Marchand était premier ministre et cependant s’absentait de la session parlementaire pour suivre les délibérations de la Chambre des notaires et de la Commission des examens. » Il est d’ailleurs le seul notaire à avoir été premier ministre dans toute l’histoire du Québec.
La Revue du notariat rend hommage à Félix-Gabriel après son décès. « Dans les délibérations de la Chambre des notaires, l’honorable M. Marchand se montra ce qu’il était dans sa vie politique et privée, courtois, affable, toujours de bonne humeur. Il ne faisait pas de bruit, mais son travail était sûr et solide. Il savait toujours tempérer par une bonne parole les débats quelquefois un peu acerbes. Là où il excellait surtout, c’était dans l’habileté qu’il mettait à convaincre, sans avoir l’air d’y toucher, ceux qui n’étaient pas de son opinion. Ce caractère si doux était cependant trempé comme de l’acier, et de là vient qu’une fois qu’il avait entrepris de faire réussir un projet, il sonnait plusieurs années de suite la charge sans jamais se décourager. […] Sa parole toujours calme était alors écoutée avec la plus grande attention. C’est à lui que l’on s’adressait de préférence pour combattre les mesures qui auraient pu nuire à l’avancement du notariat. Nous n’en finirions pas s’il nous fallait citer les projets de loi qu’il présenta pour amender les codes de façon à faciliter l’exercice de la profession. »
Félix-Gabriel « cesse » d’exercer le notariat en écrivant son dernier acte le 1er avril 1899. Son associé, Me Alfred Noé Deland poursuit son œuvre seul avant de s’associer en 1901 à leur ancien clerc, Me Télesphore Brassard. Tout au long de ses 44 ans de pratique, Félix-Gabriel Marchand a rédigé 6 324 actes.
LE NOTAIRE

Affiche annonçant une ascension en ballon au Champ de Mars à Paris et note de Félix-Gabriel Marchand indiquant qu'il en a été témoin.
Affiche publicitaire annotée par Félix-Gabriel Marchand lors de son voyage en France. 14 juillet 1850.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Plaque annonçant le bureau du notaire Félix-Gabriel Marchand.
Musée du Haut-Richelieu

Photographie de l'édifice Deland, situé au 196 de la rue Jacques-Cartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été occupé par le bureau du notaire Félix-Gabriel Marchand.
Musée du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français


Photographies de l'édifice Deland, situé au 196 de la rue Jacques-Cartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été occupé par le bureau du notaire Félix-Gabriel Marchand. 1979.
Collection Lionel Fortin

Il y a quelques années, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a acquis et restauré l'édifice de l'ancien bureau de notaire de Félix-Gabriel Marchand. Pour souligner les différentes études de cet immeuble, la Ville a reproduit l'ensemble des inscriptions qui se sont superposées au fil du temps.
Inscriptions des divers bureaux de notaires ayant occupé l'édifice Deland située au 196 de la rue Jacques-Cartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 2017.
Musée du Haut-Richelieu

Sceau du notaire Félix-Gabriel Marchand.
Musée du Haut-Richelieu
Don de la notaire Danielle Deland

Article portant sur l'étude notariale fondée par le notaire Félix-Gabriel Marchand en 1877 et continué en 1964 par Me Yves Deland, un descendant de l'associé de Marchand. Sur les photographies, on peut reconnaître l'édifice Deland, mais aussi on peut découvrir le pupitre de Marchand.
Article de la revue La Voix des notaires. Avril 1964.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Projet de loi (Bill 44), Loi autorisant la chambre des notaires de la province de Québec à réduire la durée de la cléricature de Robert Bennett Hurcheson à un an, à l'admettre comme notaire et à lui permettre d'exercer cette profession, après examen. 8e législature, 4 session (20 novembre 1894 au 12 janvier 1895).
Fonds Assemblée nationale du Québec
L'auteur
Celui qu’on surnomme affectueusement le « père Marchand » consacre une partie de son temps à la culture et à son rayonnement. Alex Tremblay Lamarche raconte que « les années que passe Félix-Gabriel Marchand au séminaire de Saint-Hyacinthe l’amènent à développer un amour des lettres et, en particulier, de la littérature française. Dès son adolescence, il s’en abreuve et quémande à ses parents l’argent nécessaire pour importer de France l’œuvre complète de Chateaubriand. »
Tout jeune, il aime déjà écrire en vers. En 1853, il publie deux poèmes dans La Ruche littéraire et politique : « La jeune mère au chevet de son fils » et « Le printemps ». Alex Tremblay Lamarche ajoute que « les années qui suivent lui permettent de publier d’autres vers dans Le Foyer Canadien et la Revue canadienne. Ses poèmes évoquent tantôt diverses réalités canadiennes — L’hiver, Hymne aux Martyrs de 1837 —, tantôt un idéal de justice sociale — Impromptu sur la charité, Charité enfantine, La tombola. La poésie de Marchand ne semble toutefois pas attirer l’attention de ses contemporains. Marchand se fera davantage connaître comme dramaturge que comme poète à son époque. »
Alex Tremblay Lamarche explique que « son théâtre puise largement dans celui d’Émile Augier, dramaturge français en vogue sous le Second Empire. Tout comme lui, il profite de ses pièces pour dénoncer — quoiqu’assez gentiment — les travers de la société (thème d’ailleurs aussi évoqué dans certains de ses poèmes). […] Dans ses pièces, Marchand se plaît à mettre en scène des personnages délibérément stéréotypés, évoluant dans un décor bourgeois, qui passent par toute une série de péripéties résultant d’un quiproquo. La justice immanente veillant, l’intrigue se termine pour le mieux dans l’allégresse générale. »
Alex Tremblay Lamarche spécifie que « la plupart des pièces de Marchand connaissent quant à elles un beau succès de son vivant et sont présentées un peu partout dans la province par des amateurs ou des troupes de théâtre professionnelles tout au long des dernières décennies du XIXe siècle. Par exemple, Erreur n’est pas compte fait l’objet d’un accueil particulièrement enthousiaste lors de sa première dans la capitale en 1872. » Le journal Le Canadien du 6 décembre 1872 commente dans un article titré « Un député vaudevilliste » que « même les adversaires politiques de [Marchand] soulignent son talent à grand trait : [N]ous autres conservateurs, nous n’avons aucune objection à ce que les électeurs de Saint-Jean élisent perpétuellement M. Marchand, à condition qu’il emporte avec lui à la capitale, tous les ans, au milieu d’un tas de vilain (sic) bills que nous désapprouvons, une pièce de théâtre aussi bien faite qu’Erreur n’est pas compte, que nous avons applaudis (sic) de tout cœur. […] Il ne manque vraiment qu’une chose à M. Marchand pour être l’homme le plus heureux du Canada, c’est d’avoir autant de succès en politique qu’au théâtre. S’il en était ainsi, il serait bientôt premier ministre ».
Félix-Gabriel Marchand est l’auteur de plusieurs œuvres littéraires et dramatiques dont :
Fatenville (1869)
Pièce en un acte et en prose
Elle est d’abord publiée dans la Revue canadienne. Elle est une caricature du snobisme des Montréalais incarné par le personnage de Fatenville, avocat ayant ruiné son père par ses extravagances et dont le nom dit tout.
Erreur n’est pas compte ou les inconvénients d’une ressemblance (1872)
Une comédie en deux actes et en prose
Ce vaudeville se moque d’un banquier désespéré de voir sa fille le ruiner par de folles dépenses.
Un bonheur en attire un autre (1883)
Une comédie en un acte et en vers
Cette pièce est présentée pour la première fois le 21 juin 1883, dans la Salle d’Opéra, à Saint-Jean, au bénéfice des familles des martyrs de l’insurrection canadienne de 1837-38.
Les Travers du siècle brillants (1885)
Une comédie en trois actes et en vers
Cette pièce fait l’objet d’un éloge très flatteur dans la Revue du monde Latin, à Paris.
Le Lauréat (1885)
Opéra-comique en deux actes
Alex Tremblay Lamarche décrit que « Marchand s’aventure du côté de la scène lyrique en publiant un livret d’opéra-comique, Le Lauréat, qui sera mis en musique une vingtaine d’années plus tard par Joseph Vézina, chef fondateur de la Société symphonique de Québec (aujourd’hui l’Orchestre symphonique de Québec). Malheureusement, Marchand n’assistera pas à la création de son œuvre, la première ayant lieu en mars 1906, soit quelque six ans après sa mort. L’opéra connaît un franc succès. Il aura même quelques reprises par la suite. Pour l’opéra-comique Le Lauréat, Marchand est le parolier et Joseph Vézina compose la musique. » Le rôle-titre est créé par le ténor et futur juge Jules-Arthur Gagné.
Les Faux Brillants (1885)
Comédie en cinq actes et en vers
Félix-Gabriel s’amuse des mésaventures d’un bourgeois quelque peu crédule qui, désireux de marier sa fille à un bon parti, en offre la main à un parvenu se faisant passer pour un baron italien. Cette pièce sera paraphrasée par le dramaturge et metteur en scène Jean-Claude Germain dans les années 1970. Du 24 mars au 15 mai 1977, elle est présentée au Théâtre d’Aujourd’hui. Le programme la présente ainsi : « Hilarante réécriture de la pièce de Félix-Gabriel Marchand. Le chef d’une famille de nouveaux riches bien de chez nous doit compléter son ameublement. Il doit choisir entre la culture “qui ne remonte pas du terroir” ou “celle qui descend en ligne droite du dernier bateau en provenance des vieux pays”. Par-delà la fascination qu’exerce une fausse aristocratie européenne sur la petite bourgeoisie québécoise du XIXe siècle, c’est tout le genre théâtral de la comédie de mœurs aux allures vaudevillesques qui est parodié. »
L’Aigle et la marmotte (1885)
Une fable
Nos gros chagrins et nos petites misères (1889)
Un texte en prose
Mélanges poétiques et littéraires (1899)
Alex Tremblay Lamarche souligne qu’au « sommet de sa gloire, Marchand publie en 1899 des Mélanges poétiques et littéraires qu’il fait illustrer d’une dizaine de dessins d’Henri Julien. Cet ouvrage, qui se veut un recueil de son œuvre, rassemble les quatre pièces de théâtre qu’il a écrites, le livret d’opéra qu’il a composé, dix de ses poèmes et quelques textes en prose dont il est particulièrement fier. » Ce recueil est publié par la librairie Beauchemin.
Honneurs
Grandement apprécié pour son apport à la littérature québécoise, ses contemporains le surnomment « notre Molière québécois » principalement en raison de son style ironique. Félix-Gabriel Marchand est nommé membre de la Société Royale du Canada lors de sa fondation en 1882. Il en est le vice-président, en 1883, président de la section française, en 1884, vice-président général, en 1897, et président général, en 1898. Il est fait docteur ès lettres par l’Université Laval en 1891. Le gouvernement français reconnait aussi ses mérites en le nommant, en 1879, officier de l’instruction publique de France et, en 1898, officier de la Légion d’Honneur. En 1891, il reçoit un doctorat en lettres honoris causa de l’Université Laval. En 1883, il est nommé membre de l’Académie des muses santones de France, qui compte entre autres des personnalités comme Jules Verne.
Jonathan Livernois constate que « plus souvent, on passe carrément à côté du statut d’écrivain ou d’homme de lettres d’un homme politique. Par exemple, dans l’ouvrage Les Premières Années du parlementarisme québécois (1974) de l’historien Marcel Hamelin, qui couvre la période allant de 1867 à 1878, aucun politicien n’est décrit comme un écrivain. Au mieux, les députés sont considérés comme des journalistes. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau y est surtout vu comme un avocat, Félix-Gabriel Marchand comme un notaire. » D’ailleurs, Livernois relate que « le député de Mercier et poète Gérald Godin pourra déclarer, quatre-vingt-dix ans plus tard : “Au Québec, le seul autre écrivain avant moi à faire le saut a été, au siècle dernier, Félix-Gabriel Marchand.”. »
L'AUTEUR

Poème de Félix-Gabriel Marchand intitulé Le Sonnet. Vers 1850.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Poème de Félix-Gabriel Marchand intitulé L'Aigle et la Marmotte. Vers 1885.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Enregistrement de la pièce La romance de Paul tiré de l'opéra Le Lauréat de Joseph Vézina sur un livret de Félix-Gabriel Marchand.
Chant : Emmanuel Bernier
Édition : Jean-Philippe Côté-Angers








Illustrations de l'artiste Henri Julien représentant les pièces écrites par Félix-Gabriel Marchand. Vers 1899.
Musée du Haut-Richelieu


Publications de pièces écrites par Félix-Gabriel Marchand : Un bonheur en attire un autre (1883) et Les Faux Brillants (1885).
Musée du Haut-Richelieu



Programme de la pièce Les Faux Brillants présentée au Théâtre d'Aujourd'hui en 1977. 17 novembre au 23 décembre 1977.
Collection Dave Turcotte
Don Louise Bédard

Publication de l'adaptation de Jean-Claude Germain de la pièce Les Faux Brillants écrite par Félix-Gabriel Marchand. VLB Éditeur. 1977.
Collection Dave Turcotte






Photographies de la pièce Les Faux Brillants présentée au Théâtre d'Aujourd'hui en 1977. Photographe Daniel Kieffer. Entre février et novembre 1977.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Fonds Daniel Kieffer

Article sur l'adaptation de Jean-Claude Germain de la pièce Les Faux Brillants écrite par Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Devoir. 22 mars 1977.
Journal Le Devoir




Photographies de l'avant-première de la pièce Les Faux Brillants écrite par Félix-Gabriel Marchand et mise en scène par Patrick Ménard du Théâtre de Grand-Pré. 2016.
Collection Dave Turcotte

DVD de la pièce Les Faux Brillants écrite par Félix-Gabriel Marchand et mise en scène par Patrick Ménard du Théâtre de Grand-Pré. 26 mars 2016.
Collection Dave Turcotte

Mélanges poétiques et littéraires, recueil des œuvres de Félix-Gabriel Marchand. C. O. Beauchemin & Fils, Libraires-imprimeurs. 1899.
Collection Dave Turcotte


Diplôme d'officier de la Légion d'honneur décerné à Félix-Gabriel Marchand. 12 septembre 1898.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Le journaliste
Jean-Claude Germain décrit Marchand comme étant « mélancolique de tempérament, d’apparence nonchalante et règle générale vêtu de noir, Marchand qui, à la fin du siècle, gardait encore des favoris à une époque où on ne les portait guère plus, était considéré par ses contemporains comme un homme d’esprit. » Il ajoute : « Devrait-on dans le passé politique immédiat trouver un répondant moderne à Marchand qu’on pense tout de suite à Georges-Émile Lapalme, par certains aspects de sa carrière parlementaire, et aussi à André Laurendeau, pour certains traits de son caractère. À première vue, dans la mesure où l’on accorde une certaine importance et du prestige à l’intelligence, le rapprochement peut sembler flatteur ; mais, en fait, il permet surtout de classer Marchand par association dans la catégorie la moins encombrée et la plus mal vue des hommes politiques québécois : celle des intellectuels. »
Intellectuel assumé, Marchand aime transmettre ses connaissances, mais aussi son opinion. Il voit l’opportunité de le faire en écrivant dans les médias. Comme journaliste, Félix-Gabriel Marchand collabore d’abord à La Ruche littéraire et politique en 1853 et en 1854, mais aussi au Foyer canadien, à la Revue canadienne, au Littérateur canadien, à La Revue légale et à L’Ordre.
En 1883, Félix-Gabriel Marchand fonde avec le futur premier ministre du Québec Honoré Mercier et Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, député à la Chambre des communes de 1872 à 1878, Le Temps de Montréal. Marchand est aussi, pour un temps, rédacteur en chef de ce journal dévoué aux intérêts du Parti libéral.
Mais son œuvre journalistique la plus marquante et pérenne est sans nul doute la fondation du journal Le Canada Français, le deuxième plus vieux journal francophone d’Amérique du Nord. En mars 1860, Félix-Gabriel Marchand ainsi que le notaire et conseiller municipal d’Iberville, Valfroy Vincelette, entreprennent des démarches pour lancer Le Franco-Canadien. Louise Bédard raconte que « les deux hommes convainquent les imprimeurs Pierre Cérat et Isaac Bourguignon, qui possèdent déjà à Montréal une feuille à saveur humoristique La Guêpe, de publier un journal à Saint-Jean. Pour lancer la nouvelle gazette, une souscription populaire permet d’amasser 800 $, une somme importante pour l’époque. L’avocat Charles Joseph Laberge, député d’Iberville qui a déjà fait ses premières armes dans d’autres publications, en sera le premier rédacteur et inspirera avec Marchand l’orientation du journal. Marchand, Laberge et Alfred Napoléon Charland, un étudiant en droit, font la promesse aux imprimeurs d’assurer gratuitement la rédaction du journal durant trois ans. Bourguignon et Cérat deviennent les imprimeurs-propriétaires comme cela était souvent la pratique du temps. Cérat se retire de l’aventure un peu plus d’un mois après le lancement du journal. »
Le vendredi 1er juin 1860, est publié le premier numéro de ce journal, d’allégeance libérale, bihebdomadaire de 4 pages. Marilou Desnoyers souligne que « Marchand vient alors pallier l’absence d’un organe de presse francophone dans la région, l’unique média mis à la disposition des habitants du lieu étant le journal “St. Johns News and Eastern Townships Advocate” (The News) implanté à Saint-Jean depuis 1850. »
Sa ligne éditoriale est présentée dans la première édition du journal : « Nous désirons que notre feuille sans cesser d’être canadienne, soit surtout franco-canadienne ». Louise Bédard rappelle que « la création du Franco-Canadien survient au moment où l’avenir du pays est en discussion. Nous sommes sept ans avant la proclamation de la Confédération canadienne de 1867. La nouvelle publication veut pallier le manque de journaux français trop peu nombreux pour la population qui parle la langue française, fait-on valoir dans le Prospectus paru en page frontispice de la première édition. »
Dominique Marquis croit que ce « nouveau périodique aura tous les attributs d’une bonne presse : hauteur et indépendance de vues seront au rendez-vous. Il sera catholique, mais pas religieux, donc pas dogmatique ; il sera nationaliste c’est-à-dire que tout en aimant et respectant “nos frères d’autres origines”, les rédacteurs seront toujours fiers de leur origine française […]. Le journal fait passer le pays avant la région : “Nous tiendrons compte en outre des intérêts particuliers de notre District, sans jamais les mettre au-dessus des intérêts du pays qui doivent toujours avoir le pas”. »
Louise Bédard mentionne que « si le nouveau journal est étroitement associé aux intérêts des libéraux, il prêche à l’occasion des idées plus progressistes comme la valeur de l’instruction publique et la création d’un ministère de l’éducation dont Marchand se fera l’apôtre une fois premier ministre du Québec. Le Franco-Canadien, comme les autres journaux du 19e siècle, s’adresse à un public restreint de lecteurs. La politique, particulièrement les débats parlementaires, tient une place de choix dans ses pages. »
Félix-Gabriel Marchand fait partie dès le début du comité de rédaction sous la direction de Charles Joseph Laberge, puis est le rédacteur en chef du journal de 1861 à 1863 et de 1867 à 1878. Alex Tremblay Lamarche affirme que ça permet à Marchand « de diffuser ses idées auprès de ses concitoyens et de prendre position dans l’espace public. Au cours des années 1860, il publie ainsi une série d’articles dans lesquels il se montre critique face au projet de Confédération qui est en train de se dessiner sur la scène politique. Il souhaiterait à la rigueur que les provinces britanniques nord-américaines se rassemblent au sein d’une fédération qui déléguerait des pouvoirs limités à un gouvernement central, mais assurément pas d’une fédération centralisatrice. En fait, si Marchand s’oppose au projet, c’est qu’il juge qu’il présente une menace pour la préservation de la langue française et qu’il sert davantage les intérêts des Britanniques que ceux des Canadiens français. »
Le 1er mars 1867, Marchand achète le Franco-Canadien à Isaac Bourguignon. Louise Bédard rapporte que « Marchand promet aux lecteurs qu’à partir de maintenant, le journal sera en mesure de publier les nouvelles aussi promptement que tout autre journal dans le pays. “Nous nous sommes, en outre, assuré l’échange ou l’abonnement de plusieurs journaux européens et américains et le Franco-Canadien sera à l’avenir aussi exactement renseigné que les meilleurs journaux de nos grandes villes. Les lecteurs n’auront donc, sous ce rapport, aucune raison de nous refuser leur patronage”. Il annonce aussi que le journal a renouvelé son matériel typographique pour exécuter l’impression de tous les ouvrages qu’on voudra lui confier. »
Louise Bédard précise que « la publication d’un journal ne paie pas. Deux ans seulement après avoir repris Le Franco-Canadien, Marchand signe le 1er novembre 1869 une promesse de vente du journal à Isaac Bourguignon qui reprend en main l’administration. Mais ce dernier n’en redeviendra officiellement propriétaire que le 19 juillet 1876, soit un mois après le Grand feu de Saint-Jean. »
En 1893, le Franco-Canadien, journal libéral depuis sa fondation, passe à des mains conservatrices à la suite d’une transaction de Bourguignon. La pilule ne passe pas dans les rangs libéraux et la réplique s’organise. La réplique vient de Marchand aidé de son organisateur électoral et avocat, Alphonse Morin. Le jeudi 6 juillet 1893, ils publient le premier numéro du journal Le Canada Français. Morin est le directeur-propriétaire de la nouvelle publication, mais le vend le 16 juin 1898 à Gabriel Marchand, fils de Félix-Gabriel Marchand.
Le 30 août 1895, Félix-Gabriel Marchand a gain cause dans un recours judiciaire et retrouve la propriété du Franco-Canadien. Après plus de deux ans de concurrence, le 4 octobre 1895, les deux journaux sont réunis. L’hebdomadaire portera d’ailleurs les deux noms dans son en-tête jusqu’au 3 septembre 1964.
LE JOURNALISTE

Premier exemplaire du journal Le Franco-Canadien signé par Charles Joseph Laberge. Volume 1, numéro 1. Vendredi 1 juin 1860.
Journal Le Canada Français

Alphonse Morin est avocat, protonotaire de la Cour Supérieure du district d'Iberville, directeur de la Banque de Saint-Jean et l'un des organisateur de Félix-Gabriel Marchand. D'ailleurs, ils fondent ensemble le journal Le Canada Français.
Photographie d'Alphonse Morin.
Collection Lionel Fortin

Exemplaire du journal Le Franco-Canadien indiquant dans son entête que Félix-Gabriel Marchand est le rédacteur-propriétaire du journal.
Volume 8, numéro 86. Vendredi 3 avril 1868.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Déclaration de Félix-Gabriel Marchand comme propriétaire-éditeur du journal Le Franco-Canadien. 27 mai 1868.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Exemplaire du journal Le Franco-Canadien indiquant dans son entête que Félix-Gabriel Marchand est le rédacteur en chef et qu'Isaac Bourguignon est le propriétaire du journal. Volume 18, numéro 2. Mardi 5 juin 1877.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Déclaration de Isaac Bourguignon comme propriétaire-éditeur du journal Le Franco-Canadien. 14 mars 1878.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Déclaration de Gabriel Marchand, fils de Félix-Gabriel, comme propriétaire-éditeur du journal Le Canada Français et Le Franco-Canadien. 16 juin 1898.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

« Prise devant les locaux du journal, probablement à l’intersection des rues Richelieu et Saint-Georges, la photo nous montre le personnel de cette vénérable publication, au tournant du siècle. Le journal The News fut fondé en 1848 à Philipsburg et vient s’établir deux ans plus tard à Saint-Jean. En plus de notre ville et de ses environs, cette publication couvrait un large territoire, s’étendant même jusqu’à une partie des Cantons-de-l’Est. Après avoir publié pendant plus de 120 ans, le “News” s’éteignit peu après la mort de son dernier propriétaire, M. Lawrence G. Gage, vers la fin des années 60. »
Photographie des employés du journal The News de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vers 1900.
Société d’histoire du Haut-Richelieu
Journal Le Canada Français

Panneau consacré à Félix-Gabriel Marchand lors de l'exposition du 150e anniversaire du journal Le Canada Français.
Musée du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français


Photographies de la cérémonie d'honneur à l'Assemblée nationale du Québec soulignant le 150e anniversaire du journal Le Canada Français, en présence du président Yvon Vallière, du député Dave Turcotte et des propriétaires du journal.
Assemblée nationale du Québec
Collection Dave Turcotte
Le Johannais
Élu conseiller municipal en 1858
Avant d’être élu député, Félix-Gabriel se fait élire conseiller municipal à la ville de Saint-Jean en 1858. Alex Tremblay Lamarche note qu’au « cours de son mandat, il siège sur différents comités, mais se fait surtout remarquer par sa volonté d’imposer petit à petit le français dans l’espace public et l’appareil bureaucratique. Saint-Jean est alors principalement administrée en anglais même si de plus en plus de Canadiens français accèdent au conseil municipal. Or, sous son impulsion et celle de quelques autres notables de la ville, la langue de Molière commence tranquillement à se faire une place à l’hôtel de ville. Par exemple, en mars 1858, le comité spécial pour le Département du feu sur lequel siège Marchand rend son rapport en français alors que le reste des documents administratifs rédigés à la même date sont en anglais. »
Alex Tremblay Lamarche ajoute que « les procès-verbaux du conseil municipal confirment que Félix-Gabriel Marchand a contribué à franciser la toponymie de Saint-Jean. En effet, en mars 1858, […] Marchand propose de changer les noms anglais de certaines rues pour les remplacer par des noms dont la prononciation et, idéalement, l’orthographe seraient les mêmes en anglais et en français. Il profite alors de l’occasion pour mettre de l’avant les racines françaises de la colonie en proposant que les principales artères de la ville soient renommées en l’honneur de héros de la Nouvelle-France. Front Street et McCumming Street deviennent ainsi les rues Richelieu et Champlain. »
Son passage en politique municipale est cependant de courte durée puisque son mandat se termine en 1859.
Le lieutenant-colonel du 21 ° bataillon d’infanterie légère du Richelieu
Pendant la guerre de Sécession américaine (1861-1865), la neutralité de la Grande-Bretagne par rapport au conflit qui déchire les États-Unis fait craindre les colonies britanniques d’Amérique du Nord d’être impliquées dans cette guerre civile. Marilou Desnoyers relate qu’on « choisit de renforcer les défenses canadiennes, notamment en établissant de nouvelles milices volontaires sur le territoire. À Saint-Jean, on organise dès janvier 1862 un corps de cavalerie, sous la direction du Capitaine Des Rivières. »
Alex Tremblay Lamarche affirme qu’à « Saint-Jean, l’effervescence devait être d’autant plus grande qu’on se sait à la frontière des États-Unis. De nombreux procès-verbaux du conseil municipal de l’époque font d’ailleurs mention d’un lieu à l’hôtel pour entreposer les armes et entraîner les compagnies. Pourtant, dans un premier temps, les Canadiens français qui y demeurent se montrent peu empressés à prendre les armes. Alors qu’une milice composée d’une troupe de cavalerie regroupant principalement les anglophones de Saint-Jean se forme dès février 1862, il faut attendre en décembre avant que des notables franco-catholiques organisent une compagnie d’infanterie. »
C’est le 19 décembre 1862 que Félix-Gabriel Marchand et son ami Charles-Joseph Laberge créent les « Chasseurs du Richelieu », une compagnie d’infanterie de la milice volontaire à Saint-Jean. Marchand prône la participation des « Québécois », dans le journal Franco-Canadien du 8 janvier 1863, afin qu’ils contribuent « puissamment à maintenir dans ce pays, le prestige, l’influence et le respect qui sont dus à notre origine ». Le 23 mai 1863, ce corps est incorporé au 21e bataillon de milices nouvellement formé. Félix-Gabriel et son cousin François-Henri Marchand y sont promus capitaine.
Alex Tremblay Lamarche explique qu’au « terme de la guerre de Sécession, la menace américaine s’éteint après avoir fait craindre le pire aux autorités du Canada-Uni. Le conflit tant redouté n’aura finalement pas eu lieu, mais un autre danger se profile à l’horizon. En effet, plusieurs Féniens nord-américains entament des raids contre le Canada au milieu des années 1860 afin de forcer le gouvernement de la Grande-Bretagne à se retirer de l’Irlande. Ces nationalistes irlandais sont redoutés par les citoyens de Saint-Jean qui se savent à la proximité de la frontière. »
Marilou Desnoyers met en contexte ces incursions : « Après la guerre de Sécession, de nombreux vétérans irlando-américains démobilisés mettent à profil leur expérience militaire afin de réaliser leur projet nationaliste. Ne pouvant traverser l’Atlantique, ils voient dans le Canada une monnaie d’échange idéale pour négocier la libération de l’Irlande. Entre 1866 et 1870. Les Féniens réaliseront différentes attaques armées au Canada, qui seront toutes repoussées. Cependant, les fausses rumeurs concernant les raids féniens, qui fuseront d’ailleurs bien davantage que le sang, alimentent la peur. ».
Selon Alex Tremblay Lamarche, « en juin 1866, le 21e bataillon est donc mobilisé à la frontière pour en assurer la surveillance et Marchand en est fait lieutenant-colonel et commandant. Le gros des conflits se déroule toutefois dans la vallée du Niagara en 1866 et l’infanterie légère de Richelieu ne paraît pas avoir participé aux combats qui se déroulent au cours de cette année. En avril 1870, le 21e bataillon est de nouveau mobilisé pour protéger la frontière de la menace fénienne. Il est cette fois-ci envoyé dans les Cantons-de-l’Est où Marchand reçoit le commandement de quelque 1000 hommes. Il est aussi placé à la tête d’une brigade de volontaires. Aucun danger ne pointant à l’horizon, Marchand rentre à Saint-Jean. Mais les Féniens se préparent à attaquer la frontière le 24 mai, date à laquelle plusieurs troupes britanniques doivent être à Montréal pour parader en l’honneur de la reine Victoria. L’offensive est finalement lancée le lendemain et le 21e bataillon est rappelé d’urgence à la frontière le 25 mai pour venir en aide aux troupes britanniques. Marchand accourt à la tête d’une brigade de 1200 hommes. Finalement, les Féniens fuient à l’approche des renforts britanniques. Après cette date, les Féniens ne représenteront plus jamais une menace au Québec et Félix-Gabriel Marchand ne servira vraisemblablement plus sous les armes. En juin 1880, il est mis à la retraite, mais conserve son titre de lieutenant-colonel comme l’usage le veut au XIXe siècle. »
Lionel Fortin écrit que « plus tard, le gouvernement impérial voulant reconnaître ses services et celui du 21e bataillon, distribua des médailles commémoratives à tous ceux qui vivaient encore parmi ces anciens militaires. Une cérémonie eut lieu le 20 mai 1900 à l’Hôtel de Ville de Saint-Jean ». Le Canada Français du 25 mai 1900 rapporte ainsi cet événement : « L’Hon. M. Marchand, premier ministre de la province de Québec et ancien colonel du 21e bataillon de St-Jean, assistait à cette belle démonstration organisée par M. J.P. Carreau, avocat de cette ville et ancien lieutenant-colonel du même bataillon… « Quand l’hon. M. Marchand apparut sur la scène un tonnerre d’applaudissements éclata. L’hon. premier ministre dit qu’il était heureux de se retrouver encore une fois au milieu de ses vieux amis de Saint-Jean, et surtout de pouvoir prendre part à la fête de la décoration de ses vieux compagnons d’armes. Il dit, en termes émus, que si la mitraille n’avait pas fauché dans leurs rangs lors de leur marche vers la frontière pour la défense de leur pays menacé, de nombreux vides s’y étaient faits depuis et que plusieurs d’entre eux subissant le sort commun à tous les hommes, étaient partis pour une autre vie. Ceux-là, dit-il, n’ont pas vécu assez longtemps pour recevoir la récompense due à leur conduite exemplaire et patriotique quand il s’est agi de repousser l’invasion fénienne, mais nous ne les oublierons pas en ce jour de réjouissance. […] L’hon. M. Marchand, félicita de nouveau ses vieux compagnons d’armes, leur rappela le temps où ils étaient sous ses ordres dans le 21e, puis dit que des démonstrations comme celles-là servaient d’exemple à la jeunesse qui, si un jour la patrie venait en danger, n’hésiterait pas, il en avait la ferme conviction, de voler à son secours. ».
Jean-Jacques Lefebvre spécifie qu’aux « dossiers de la milice des Archives du Canada, ses états de service sont ainsi décrits : lieutenant en décembre 1862, capitaine en mai 1863, major en août 1865, enfin lieutenant-colonel en juin 1866 du 21 ° bataillon d’infanterie légère du Richelieu. »
Le citoyen engagé
Avant de se lancer en politique québécoise, il s’implique dans sa communauté. Il agit notamment à titre de : président de la commission scolaire de la paroisse de Saint-Jean l’Évangéliste (1863 -1872), premier président de la commission scolaire de Saint-Jean (1872-1896), marguillier de la fabrique de Saint-Jean l’Évangéliste (1868-1871), président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean en 1885. Étant lui-même agriculteur, il est vice-président de l'Association d'agriculture du Bas-Canada et est élu directeur en 1861, vice-président en 1863 et président de la Société d'agriculture de Saint-Jean de 1864 à 1867.
Dans le domaine des affaires, il est élu président de la Société de construction de Saint-Athanase en 1860. Le 26 décembre 1868, il fonde, avec l’homme d’affaire et député d’Iberville Louis Molleur, la Société permanente de construction du district d’Iberville. Selon son acte constitutif, elle a pour objectif « d’aider ses membres et autres personnes ayant besoin de logements, à acquérir des propriétés, et de leur faciliter le moyen de les acquérir ». En 1873, « toujours avec Molleur, il participe à la fondation de la Banque de Saint-Jean, dont il sera membre du conseil d’administration de 1873 à 1879, puis le 17 octobre 1874 à celle de la Compagnie manufacturière de Saint-Jean, dont il sera aussi membre du conseil d’administration jusqu’à sa disparition en 1877. » (Dictionnaire biographique du Canada). En 1891, il est vice-président de la Compagnie de chemin de fer Saint-Jean et Sorel.
LE JOHANNAIS

Charles-Joseph Laberge exerce la profession d'avocat à Montréal, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il s'établit en 1852. Il est élu député d'Iberville en 1854 et réélu en 1858. Il est Solliciteur général du Bas-Canada dans le ministère Brown–Dorion, du 2 au 5 août 1858, sans occuper de siège dans le cabinet. Son mandat de député ayant pris fin avec cette nomination, il est réélu dans Iberville à une élection partielle le 6 septembre 1858. Il ne s'est pas représenté en 1861. Il est défait dans Saint-Jean à l'élection fédérale de 1867. Il est élu maire de Saint-Jean-sur-Richelieu à deux reprises et il refuse un troisième mandat. Il fonde en 1860, avec Félix-Gabriel Marchand, Le Franco-Canadien, auquel il collabore. Il fait aussi paraître des articles dans L'Ordre (Montréal), sous le pseudonyme « Libéral, mais catholique ». Il est nommé juge de la Cour supérieure à Sorel en septembre 1863, mais il perd son poste en juillet 1864. Il s'installe à Montréal, en 1872, à titre de rédacteur en chef du journal libéral Le National.
Photographie de Charles-Joseph Laberge. Vers 1875.
Collection Lionel Fortin

Louis Molleur exerce le métier d'instituteur de 1848 à 1853. Il est ensuite commerçant et agriculteur à Saint-Valentin jusqu'en 1863, commerçant à Henryville de 1863 à 1865, puis il s'établit à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1865. Il devient marguillier et est élu conseiller municipal à Saint-Jean. Il est élu député libéral dans Iberville en 1867, puis réélu en 1871, en 1875 (sans opposition), et en 1878. Il ne se représente pas en 1881. Il est cofondateur de la Société permanente de construction du district d'Iberville, dont il est vice-président en 1868 et président quelques années plus tard. En 1872, il participe à la création de la Compagnie de l'aqueduc de Saint-Jean. En 1873, il fonde avec Félix-Gabriel Marchand la Banque de Saint-Jean, dont il est président jusqu'en 1904. Il est aussi actionnaire et président de la Compagnie manufacturière de Saint-Jean de 1874 à 1876. Il participe à l'établissement du pouvoir hydraulique de Saint-Césaire en 1904. Il est directeur de la Canada Agricultural Insurance Co.
Photographie de Louis Molleur.
Collection Lionel Fortin

Cette illustration est extraite du livre Saint-Jean-de-Québec : origine et développement de l'abbé Jean-Dominique Brosseau, publié en 1937 sous les presses du journal Le Richelieu.
Gravure de l'invasion fénienne sur la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Selon Réal Fortin, « l’histoire est bien connue, le premier chemin de fer au Canada a été inauguré le 21 juillet 1836. Le train, tiré par la locomotive Dorchester, avait mis deux heures pour franchir la distance entre les gares de La Prairie et de Saint-Jean. Plusieurs historiens en ont fait le récit dans ses moindres statistiques. Les chiffres succédaient aux énumérations minutieuses et fastidieuses. Toutefois, c’est la narration de Félix-Gabriel Marchand qui est de loin la plus intéressante. Un vrai chef-d’œuvre littéraire qu’on devrait faire lire à tous les étudiants du Québec. »
Illustration du premier chemin de fer au Canada. Galerie d’histoire du Canada. 1967.
Collection Dave Turcotte
Feuillet reprenant le texte écrit par Félix-Gabriel Marchand : Inauguration du premier chemin de fer canadien. Éco-train Saint-Jean-sur-Richelieu. 17 juillet 2008.
Collection Dave Turcotte

L'Hôtel de ville de Saint-Jean, à l'époque de Félix-Gabriel Marchand, se trouvait dans l'édifice du Marché public (à gauche). La maison de droite fut la propriété de François Marchand, l'oncle de Félix-Gabriel, avant de servir d'Hôtel de ville de 1917 à 1957.
Photographie du Marché public et de l'Hôtel de ville de Saint-Jean entre 1917 et 1957.
Collection Lionel Fortin


Le député
La carrière politique de Félix-Gabriel Marchand débute aux côtés du député François Bourassa pour qui il assure, en quelque sorte, la fonction d’attaché politique avant l’heure. François Bourassa est le premier député de la circonscription de Saint-Jean dans le parlement du Canada-Uni. Il est élu le 1er août 1854, sous la bannière libérale, avec une majorité de 434 voix face à son adversaire, le notaire Thomas Robert Jobson de Saint-Jean. Il est un « agriculteur fortuné » de L’Acadie (Saint-Jean-sur-Richelieu), frère de l’artiste Napoléon Bourassa et l’oncle du journaliste et député Henri Bourassa. Il est réélu député en 1857, en 1861 et en 1863. En 1867, suite à la naissance de la Confédération, il est élu le premier député fédéral de Saint-Jean. Son homologue québécois n’est nul autre que Félix-Gabriel Marchand, élu premier député de Saint-Jean à l’Assemblée législative du Québec.
Lionel Fortin rapporte que : « Très populaire dans le comté, François Bourassa fut maintenu sans interruption dans ses fonctions aux élections de 1872, 1874, 1878, 1882, 1887 et 1891. Il prit sa retraite de la vie politique aux élections de 1896. Il était alors âgé de 83 ans ! Au total, il avait été 42 ans député du comté fédéral de Saint-Jean : 13 ans sous l’Union et 29 ans sous la Confédération, il était, à sa sortie de l’arène politique, le doyen de la Chambre des Communes ou " Le père du Parlement ". Au sujet de cette étonnante carrière, il faudrait ajouter que le député Bourassa ne parlait pas l’anglais ! Aussi, dès 1854, c’est Félix-Gabriel Marchand qui lui servit d’interprète auprès des électeurs anglophones du comté. Ce rôle secondaire que Marchand joua d’abord sur la scène des élections fédérales, le prépara sans doute au premier rôle qu’il devait obtenir un jour sur la scène provinciale. Ainsi lorsque François Bourassa meurt le 13 mai 1898, Félix-Gabriel Marchand occupait, déjà depuis un an, le poste de premier ministre du Québec. »
Élection québécoise de 1867
Le 1er juillet 1867, la Confédération canadienne devient réalité malgré l’opposition des libéraux. En août et septembre 1867, les premières élections québécoises ont lieu afin d’élire les 65 premiers députés à siéger à l’Assemblée législative aujourd’hui nommée l’Assemblée nationale du Québec.
Trois candidatures sont annoncées dans la circonscription de Saint-Jean : Isaïe Bissonnette, Henri-Joseph Larocque et Félix-Gabriel Marchand. Fait inusité, les trois candidats sont libéraux. Aucun conservateur ne se présente. Marchand est le favori. Larocque se retire au profit de Marchand. Bissonnette maintient sa candidature. Le dimanche 11 août 1867, une première « assemblée contradictoire » a lieu sur le perron de l’église à Saint-Valentin après la grande messe.
Le journal Le Franco-Canadien du 13 août 1867 présente les grandes lignes du discours du candidat Marchand : « Il avait été, dit Marchand, franchement opposé à la Confédération, telle que proposée. Ce qu’il avait toujours désiré, c’était que nous eussions, non pas une union législative sous le nom de Confédération, mais une confédération réelle. Maintenant que la nouvelle constitution est un fait accompli et qu’elle a reçu de l’autorité impériale, la sanction qui lui donne force de loi, il ne s’agit plus de la combattre et de chercher à la renverser. Il vaut mieux s’y soumettre franchement et travailler à lui donner, par des réformes opérées d’une manière constitutionnelle, les véritables caractères du système fédéral. »
Le journal ajoute quant à la politique locale, autrement dit québécoise, qu’elle « se présente sous un aspect pour ainsi dire tout nouveau, et elle demande, de la part de ceux qui seront chargés de veiller aux intérêts publics, la plus grande circonspection. Quoique bien disposé à donner à l’administration locale toutes les chances possibles de mettre en opération leur constitution, il est d’opinion qu’il sera du devoir de tout mandataire de veiller scrupuleusement à ce que la plus stricte économie préside aux actes ministériels. Avec les faibles ressources qui sont accordées à chaque province pour la direction de ses affaires locales, l’extravagance n’est plus permise, et il devient essentiel d’éviter les prodigalités, dont nous avons tant d’exemples dans le passé, si l’on veut exempter le public de la taxe directe et conserver sur le revenu provincial, quelques ressources pour donner aux industries indispensables à notre progrès, l’encouragement qu’elles méritent. Au nombre de ces industries, il faut placer en première ligne l’industrie agricole et l’industrie manufacturière, qui fournissent au commerce les produits essentiels à sa prospérité. Leur avancement devra être un des objets principaux de la législation locale. »
Les assemblées se suivent les unes après les autres aux quatre coins de la circonscription. Le candidat Bissonnette attaque uniquement Marchand sur le fait qu’il ne serait pas un « cultivateur », mais plutôt un « agriculteur ». Ainsi, pour Bissonnette, Marchand ne serait pas apte à représenter les intérêts agricoles de la circonscription au Parlement. Marchand réplique que « ce n’est pas en jouant comme cela sur les mots que l’on fait triompher une bonne cause, et il faut être bien en peine d’arguments pour en invoquer d’aussi faibles ».
Le vote se tient les 19 et 20 septembre. Marchand remporte la circonscription avec une majorité de 115 voix sur son adversaire et devient ainsi le premier député de Saint-Jean à l’Assemblée législative du Québec. Le journal Le Franco-Canadien du 21 septembre 1867 publie : « M. Marchand se sent honoré de la confiance qui lui a été témoignée, dans cette circonstance, par les électeurs de toutes les classes et de toutes les origines, sans distinction. Il est des plus heureux de voir que les futiles objections que l’on a cherché à faire valoir contre sa candidature n’ont pas produit chez les électeurs l’effet désiré et que la majorité a su apprécier ces objections à leur juste valeur. »
Le 27 décembre 1867, à trois heures de l’après-midi, la première session de la première législature de l’Assemblée législative du Québec est ouverte par le lieutenant-gouverneur Narcisse Belleau. Marchand siège aux côtés de ses onze collègues libéraux, derrière Henri-Gustave Joly de Lotbinière, le chef officieux de l’opposition. Ils font face aux 51 députés du gouvernement conservateur du premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, lui aussi homme de lettres.
Dans le journal Le Progrès du Golfe du 21 juin 1935, on constate qu’en « vrai politicien monsieur Marchand était de toutes les fêtes. Il s’associait de même à tous les deuils. Il ne manquait jamais une occasion de rencontrer les gens. Et quelle occasion plus favorable que le marché du samedi ? Aussi M. Marchand ne manquait-il jamais de " Faire son marché ". " Faire son marché " consistait à dire bonjour aux vendeurs et aux vendeuses, comme aussi aux acheteurs et aux acheteuses, ce qui rendait le marché doublement favorable. Et puis, il en profitait pour s’informer des événements de la paroisse, de la famille, de l’état des affaires et du prix des denrées offertes en vente. »
Alex Tremblay Lamarche mentionne que « le samedi est aussi l’occasion pour Marchand de recevoir ses électeurs des paroisses avoisinantes qui profitent du jour de marché pour se rendre à Saint-Jean vendre leurs produits ou s’approvisionner en denrées fraîches et faire un détour par l’étude de leur député qui fait plus souvent qu’autrement office de bureau de circonscription. Marchand ne semble d’ailleurs pas se consacrer à ses différentes occupations en vase clos puisque son étude de notaire voit défiler clients et électeurs et qu’il y travaille également à la rédaction d’articles pour Le Franco-Canadien et Le Canada Français. Marchand y reçoit aussi les personnalités les plus influentes de la circonscription. »
Marchand, le lieutenant
Lors de la deuxième session, Marchand abordera largement deux sujets qui lui tiennent à cœur : la colonisation et l’émigration. Lionel Fortin écrit que « sur cette dernière question surtout, il se fit l’interprète de trois mille Canadiens fixés aux États-Unis et qui demandaient des secours afin de revenir au pays ».
En mars 1869, Henri-Gustave Joly de Lotbinière devient le premier chef de l’opposition officielle et Marchand devient son lieutenant. Lionel Fortin raconte que « jusqu’à cette date, les libéraux s’étaient refusés à faire une opposition véritable au gouvernement surtout à cause de Marchand qui avait prôné la fin des luttes partisanes au sein de la Chambre. Mais avec le temps, les “rouges” comprirent qu’il fallait une opposition résolue afin de montrer une résistance énergique aux projets centralisateurs du gouvernement Chauveau et de combattre sans relâche ses tendances à soumettre l’action législative et administrative du gouvernement québécois à la domination fédérale. Dans ses fonctions de lieutenant, le député de Saint-Jean fut souvent appelé à remplacer son chef et à diriger les manœuvres de la “loyale opposition de Sa Majesté”. Il fit preuve à maintes occasions de ses qualités de stratège et de tacticien tout en étant mesuré, digne et poli. »
Lionel Fortin souligne que « durant les quatre années de son premier mandat, Félix-Gabriel Marchand avait su démontrer ses capacités d’homme politique. Quelque peu gêné lors de la première session, il revint à la seconde sans rien éprouver de son ancien embarras et il prouva qu’il pouvait tenir tête à n’importe quel ministre ou député. Son application à suivre les débats, sa parfaite connaissance des sujets traités et sa facilité pour les calembours faisaient de lui un député de haut calibre, même s’il ne possédait pas les qualités d’un orateur. »
Élection québécoise de 1871
Lors de l’élection de 1871, Marchand est réélu sans opposition dans la circonscription de Saint-Jean. Dans son deuxième mandat, outre l’abolition du double mandat, Marchand propose avec succès un amendement aux lois de chasse. Il demande également qu’on révise les lois municipales et celles sur l’agriculture.
Lionel Fortin rappelle qu’à « l’Assemblée législative, Marchand fut toujours l’un des orateurs les plus écoutés tant à cause des sujets qu’il soulevait que pour les nombreux calembours ou réparties spirituelles qu’il lançait à l’endroit de ses adversaires. Citons, entre autres, cette séance du 5 février 1875 que rapporte le lendemain, le journal montréalais L’Événement : “M. Marchand prend la parole après M. Langelier. Le député de Saint-Jean parle pendant près de trois heures avec beaucoup de verve et d’esprit. Les interruptions qui s’entrecroisent de tous côtés ne décontenancent pas l’orateur, qui a réponse à tout. Il ne cesse d’avoir dans tout son discours, les saillies les plus pétillantes, les mots les plus heureux. Le député de Saint-Jean est obligé de s’interrompre pour quelques instants : il lui est impossible de se faire entendre au milieu du fou rire qu’il vient soulever dans toute la chambre. Pendant le tumulte, l’Orateur (aujourd’hui nommé le président) se fait remplacer au fauteuil par [le député de Maskinongé, Moïse Houde], qui est, comme on le sait, un vieillard à barbe blanche. En apercevant M. Houde au fauteuil à la place de M. Blanchet, le député de Saint-Jean continue en disant : j’étais sans doute convaincu, M. L’Orateur, d’avoir été long dans mes remarques ; mais il ne me serait jamais venu à la pensée qu’on put parler aussi longtemps. Quand j’ai pris la parole, M. L’Orateur, vous étiez un homme dans toute la vigueur de l’âge, et je m’aperçois avec terreur que depuis mon début, la vieillesse a succédé chez vous à la jeunesse.” Ce à quoi aurait répondu le député Houde : “On peut bien vieillir quand on est forcé d’écouter des discours aussi longs”. »
Élection québécoise du 7 juillet 1875
Le 23 février 1875, le gouvernement du troisième premier ministre du Québec Charles-Eugène Boucher de Boucherville fait adopter le scrutin secret et la tenue des élections en une seule journée. Le 7 juin 1875, le parlement est dissout et l’élection générale est fixée au 7 juillet 1875.
Lionel Fortin présente le début de cette campagne ainsi : « Une semaine après le déclenchement des élections, Félix-Gabriel Marchand était déjà en campagne électorale. Le dimanche 13 juin 1875, il visitait ses électeurs de L’Acadie pour leur adresser la parole après la messe du matin et, le même jour, il était à Saint-Luc en après-midi, après les vêpres. Le dimanche suivant, 20 juin 1875, il était à Lacolle et à Saint-Valentin pour rencontrer ses constituants et pour faire face pour la première fois à son adversaire conservateur, Laurent-Lévi Roy. Les conservateurs prirent un peu de temps à dénicher un candidat valable à opposer à Marchand. Finalement, ils réussirent à convaincre M. Laurent-Lévi Roy, cultivateur de L’Acadie, un ancien libéral qui était passé du côté des conservateurs. »
Malgré une campagne vigoureuse des conservateurs, Marchand remporte les deux tiers des votes. Le journal L’Événement du 10 juillet écrit qu’après « avoir offert ses sincères remerciements à tous ceux qui avaient si cordialement contribué à son succès, [Marchand] invita ses partisans et ceux de son adversaire d’imiter les deux candidats qui restaient après la lutte, amis comme auparavant. M. Roy vint alors sur le balcon et les deux adversaires se serrèrent cordialement la main, au milieu d’une immense acclamation. M. Roy adressa ensuite ses remerciements aux électeurs qui leur avaient prêté leur support, et il exprima son concours dans les paroles de conciliation et de paix prononcées par M. Marchand. L’assemblée se mit ensuite en mouvement pour reconduire le député de Saint-Jean à son domicile, précédé du superbe corps de musique de MM. Roy & Daniel qui s’étaient gracieusement prêté à la circonstance. »
Bien que la circonscription de Saint-Jean demeure « rouge », les conservateurs font élire 43 des 65 députés de l’Assemblée législative. Le premier ministre conservateur Charles-Eugène Boucher de Boucherville est donc reporté au pouvoir.
LE DÉPUTÉ

François Bourassa est fermier à L'Acadie (Saint-Jean-sur-Richelieu). Il est capitaine d'une compagnie de l'Association des frères-chasseurs pendant la rébellion de 1838. Il est emprisonné à Montréal, puis libéré sans procès. Il détint le grade de capitaine dans le 3e bataillon de milice du comté de Chambly, de 1847 à 1859. Il s'installe sur une ferme à Saint-Jean, en 1849. Il représente la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste au conseil de la Municipalité de comté de Chambly, de 1850 à 1854. Il élu député de Saint-Jean en 1854. Il est maire de L'Acadie du 1er février au 6 septembre 1858. Il est réélu député en 1858 et en 1861. Il est candidat défait au siège de conseiller législatif de la division de Lorimier en 1862. Il est réélu député dans Saint-Jean en 1863. Il s'oppose au projet de confédération. Son mandat de député prend fin avec l'avènement de la Confédération, le 1er juillet 1867. Il est élu député libéral de Saint-Jean à la Chambre des communes en 1867 et réélu en 1872, en 1874, en 1878, en 1882, en 1887 et en 1891. Ne s'est pas représenté en 1896.
Photographie de François Bourassa.
Collection Lionel Fortin

Carte de la circonscription de Saint-Jean à l'époque de Félix-Gabriel Marchand.
Collection Lionel Fortin

Résultats de l'élection québécoise de 1867 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Diagramme des sièges des députés à l'Assemblée législative du Québec. 1867.
Collection Lionel Fortin
Le 23 janvier 1868, Marchand lance un débat qui sera un de ses principaux chevaux de bataille : l’abolition du double mandat. À cette époque, rien n'empêche un député de se faire élire au parlement de Québec et à celui d’Ottawa simultanément. Lors de la première élection québécoise en 1867, 19 des 64 députés élus à l'Assemblée législative du Québec le sont aussi à la Chambre des communes d’Ottawa. Ils sont, pour la plupart, des vétérans du Parlement de la province du Canada (1841-1867). D’ailleurs, cinq des sept ministres du conseil des ministres québécois siègent aux deux parlements, dont le premier ministre Chauveau.
Marchand souhaite « abolir le double mandat en se basant sur quatre arguments :
1. La présence de députés fédéraux menace l'indépendance de la Chambre provinciale, car ceux-ci, notamment s'ils sont ministres à Ottawa, peuvent exercer des pressions auprès des élus provinciaux.
2. Si un conflit survenait entre les deux ordres de gouvernement, quelle serait la position d'un député siégeant à Québec et à Ottawa? S'il appuyait le fédéral, un double mandataire affaiblirait le Parlement de Québec.
3. Les ministres fédéraux qui siègent à l'Assemblée législative, après avoir élaboré et voté des lois provinciales, doivent ensuite décider, une fois à Ottawa, du désaveu de certaines d'entre elles par le pouvoir central. Comme cette pratique est courante dans les premières années de la Confédération, ils sont donc à la fois juges et parties.
4. Le cumul de deux charges parlementaires est une lourde tâche impossible à concilier si les sessions parlementaires sont convoquées en même temps. Dans ce cas, les doubles mandataires préfèrent siéger à Ottawa, ce qui s'explique par le fait, observe-t-on à l'époque, que cette scène politique est plus prestigieuse que Québec. »
Comme plusieurs députés, surtout conservateurs, profitent de cette situation et que le premier ministre Chauveau en fait une question de confiance, la proposition de Marchand est rejetée par 39 voix contre 21, le 15 février 1868. Convaincu et persévérant, Marchand réitère cette demande chaque session.
En 1871, lors de la deuxième élection québécoise, plusieurs candidats devenus députés ministériels se sont engagés « à combattre le double mandat aux côtés de Félix-Gabriel Marchand. Comme l'Ontario règle la question en mars 1872, à Québec, au mois de novembre suivant, le premier ministre Chauveau permet le vote libre pour une première fois sur cette question, car il est incapable de maintenir la cohésion des rangs ministériels. Par 34 voix contre 25, la Chambre tranche en faveur de l'abolition de la double représentation, mais le Conseil législatif casse aussitôt cette décision. Il statue « qu'il n'existe pas de raisons suffisantes pour justifier la Législature de l'abolir, et par là même, de restreindre les justes droits et privilèges du peuple, dans le choix de ses représentants ».
« Au printemps 1873, le Parlement fédéral est le théâtre d'un ultime débat dans lequel les doubles mandataires québécois, divisés, s'affrontent de nouveau. Henri-Gustave Joly, chef de l'opposition libérale à Québec et député à Ottawa, juge qu'il est temps d'abolir cette pratique comme l'ont fait toutes les provinces « sauf le Québec où la Chambre qui représente le peuple l'a condamnée ». En réponse, [le futur premier ministre du Québec] John Jones Ross, député à Ottawa et conseiller législatif à Québec, soutient qu'au contraire, « le Conseil législatif du Québec a correctement représenté le point de vue des électeurs du Québec à ce sujet ». C'est justement ce même Ross qui, mentionnons-le, dirigea la mise à mort du projet de loi Marchand au Conseil législatif de Québec à l'automne 1872. Le jeune député Honoré Mercier, futur premier ministre du Québec, réplique en condamnant tant l'« anomalie » du double mandat que le geste du Conseil législatif, dont « le caractère nominatif porte atteinte à la liberté du peuple ».
« Finalement, c'est le 3 mai 1873 qu'est sanctionnée la loi fédérale déclarant « inhabiles à siéger ou à voter » aux Communes les conseillers législatifs et les députés des assemblées législatives « des provinces actuelles et futures du Canada ». La loi permet aux doubles mandataires de conserver leurs deux sièges jusqu'au prochain scrutin. Ils arrivent à la croisée des chemins en janvier 1874 quand des élections générales sont déclenchées à Ottawa. En même temps, à Québec, la Chambre finit par adopter la loi que Marchand présente pour la septième fois depuis 1868. Le premier ministre Gédéon Ouimet permet le vote libre comme son prédécesseur Chauveau, même s'il s'oppose personnellement à la mesure non sans grandiloquence : « Le pays ressentira la fatale influence de l'abolition du double mandat, prédit-il. Le Parlement local de Québec en souffrira. » À la sanction de la loi québécoise, le 28 janvier 1874, seuls quatre des 12 doubles mandataires choisissent de conserver leur siège à l'Assemblée législative du Québec. Les autres optent pour Ottawa. »
SOURCE : Site de l’Assemblée nationale du Québec

Projet de loi (Bill 9), acte pour établir des dispositions spéciales à l'égard de la Législature de la Province de Québec. 2e législature, 3e session (4 décembre 1873 - 28 janvier 1874).
Fonds Assemblée nationale du Québec


Portraits des premiers ministres du Québec Pierre-Joseph-Olivier Chauveau et Charles-Eugène Boucher de Boucherville.
Collection Dave Turcotte

Projet de loi (Bill 38), acte pour incorporer la Société Saint-Jean-Baptiste de la ville de Saint-Jean. 1re législature, 1re session (27 décembre 1867 - 24 février 1868).
Fonds Assemblée nationale du Québec


Journal du Conseil législatif de la province de Québec, deuxième session du premier parlement, volume II, ayant probablement appartenu à Félix-Gabriel Marchand et sauvé de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1869.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Laurent Lévi Roy est maire de L'Acadie de 1869 à 1870 et de 1877 à 1887. Il est aussi préfet du comté de Saint-Jean de 1877 à 1887.
Portrait de Laurent-Lévi Roy, candidat conservateur dans Saint-Jean lors de l'élection québécoise de 1875.
Collection Lionel Fortin

Résultats de l'élection québécoise de 1875 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Le ministre
La troisième législature de l’Assemblée législative est marquée par de nombreux débats sur le financement de la construction de chemin de fer. Le journal L’Événement du 15 décembre 1875 relate un extrait d’un discours de Marchand sur le sujet. « Bon nombre d’honorables députés ont dit qu’ils n’avaient pas à se plaindre de la politique du gouvernement au sujet des entreprises publiques. Moi, je dis qu’au contraire, j’ai à m’en plaindre. S’il y a une partie de la province qui a été négligée au point de vue des entreprises publiques, c’est bien celle que je représente. Ce qui a été établi en fait d’entreprises est dû à l’initiative privée. Ce que je dis là, je le dis d’une manière désintéressée, car je ne suis aucunement intéressé dans les entreprises dont je veux parler. Il y a eu, on se le rappelle, rivalité entre le Haut et le Bas-Canada. Aujourd’hui on cherche non pas à ressusciter cette rivalité, mais à la faire naître entre le Nord et le Sud de la province. »
Nommé Secrétaire provincial
Coup de théâtre, le premier ministre conservateur Charles-Eugène Boucher de Boucherville est démis de ses fonctions le 2 mars 1878 à la suite d’un conflit avec le nouveau lieutenant-gouverneur, de tendance libérale, Luc Letellier de Saint-Just. Le lieutenant-gouverneur refuse d’approuver une loi ayant été votée par les deux chambres de la législature québécoise qui aurait forcé des municipalités à payer pour la construction de chemins de fer. Letellier de Saint-Just, en vertu de ses pouvoirs de vice-roi, charge Henri-Gustave Joly de Lotbinière, chef de l’opposition libérale, de former un nouveau gouvernement. Le nouveau premier ministre ainsi que son cabinet sont assermentés le 8 mars 1878.
Cette journée est importante pour Marchand, car il est nommé ministre dans le premier gouvernement libéral de l’histoire du Québec. Au sein du cabinet Joly, il assure la fonction de secrétaire provincial. Sa joie sera de courte durée, car le même jour, une motion refusant la confiance de la Chambre au cabinet Joly est adoptée. Le nouveau gouvernement libéral étant défait, une élection est déclenchée. La date du scrutin est fixée au 1er mai 1878.
Élection québécoise du 1er mai 1878
Lionel Fortin décrit que « la campagne électorale dans le comté de Saint-Jean débuta par une première assemblée qui eut lieu à Lacolle le 21 mars 1878. Pour la deuxième fois, l’Honorable Marchand avait à faire face à Laurent-Lévi Roy, de L’Acadie, qui avait été candidat contre lui en 1875 pour le parti conservateur. Au cours de cette assemblée à Lacolle, l’honorable Secrétaire provincial s’appliqua à démontrer les conséquences désastreuses de la politique du gouvernement de Boucherville qui avait été destitué ; l’énormité du déficit si cette administration fût restée au pouvoir et l’injustice du “bill” des chemins de fer. Marchand exposa ensuite la politique du nouveau gouvernement libéral et termina son discours par un appel au patriotisme des électeurs. De son côté, Laurent-Lévi Roy annonça sa candidature et tenta d’attaquer la cause réformiste, mais sans succès. »
Le 23 mars, une assemblée a lieu à la Place du Marché de Saint-Jean. Le candidat conservateur Roy est le premier à prendre la parole. Il est suivi par nul autre que l’Honorable Joseph-Adolphe Chapleau, nouveau chef du Parti conservateur. Après près de deux heures de discours, Marchand lui donne la réplique à son tour.
Le journal Le Franco-Canadien du 26 mars 1878 écrit : « Le député de Saint-Jean fut accueilli avec une chaude sympathie par l’assemblée. Il fit une dissertation claire et précise sur la question constitutionnelle et appuyant son argumentation sur la base solide des autorités les plus compétentes. Il fit le procès du ministère conservateur, l’accusa d’avoir enfreint les traditions constitutionnelles et d’avoir outrepassé sa sphère d’action légitime, il établit que le lieutenant-gouverneur, loin d’avoir violé la constitution, en avait été le fidèle gardien et le véritable protecteur des droits et des privilèges du peuple, menacés par les conservateurs. Enfin, il mit à néant toutes les assertions et tous les arguments de son [prédécesseur]. Le discours de l’Hon. M. Marchand fut souvent interrompu par les applaudissements des auditeurs. »
Sans surprise, Marchand est réélu député de Saint-Jean avec une majorité accrue. Déjà minoritaire au déclenchement de l’élection, les libéraux arrivent en deuxième place, mais se maintiennent au pouvoir par l’appui des députés conservateurs indépendants. Le Parti libéral fait élire 31 députés avec 47 % des votes, contre 32 pour le Parti conservateur, qui a recueilli 49 % des votes. Il y a deux députés conservateurs indépendants.
Nommé Secrétaire provincial
Reconduit dans ses fonctions, Marchand se fait le promoteur d’une mesure au cœur du programme électoral libéral : abolir le Conseil législatif. À la fin d’une première session complète, le journal L’Événement du 20 juillet 1878 trace un bilan du nouveau ministre. « M. Marchand se rapproche de M. Joly par ces qualités de verve spirituelle et de courtoisie qui diminuent l’acrimonie des luttes politiques, et l’on a toujours remarqué qu’il y avait entre eux un lien particulier de sympathie. M. Joly aime tous ses collègues, mais il préfère M. Marchand. Le secrétaire provincial s’est montré à cette occasion comme toujours un lieutenant habile et dévoué, et il a pu parfois adoucir par un bon mot les blessures que la droite portait à l’opposition. »
Parlant de l’ensemble des députés ce même journal souligne que « supérieure à celles qui l’ont précédée, la nouvelle Chambre a affirmé sa valeur à la fois par l’éclat de ses discussions et la sagesse de ses votes. Durant six semaines, elle a siégé tous les soirs et travaillé d’arrache-pied. La session a été aussi laborieuse que brillante ; c’est la plus méritoire dont nos annales locales garderont la trace ; la longueur des séances, la chaleur de la saison, rien n’a pu ralentir l’ardeur de nos députés ; toujours à leur poste, ne pouvant le laisser un instant de peur de perdre un vote, ils ont diminué généreusement le chiffre de leur indemnité, lorsque leur assiduité et leurs services, leur donnaient bien le droit de l’augmenter. »
Nommé Commissaire des Terres
Le 19 mars 1879, le cabinet Joly est remanié suite au décès, le 3 novembre 1878, de Pierre Bachand, député libéral de Saint-Hyacinthe et Trésorier provincial. Dans ce remaniement ministériel, Marchand qui était Secrétaire provincial devient Commissaire des Terres. C’est Alexandre Chauveau, le fils de l’ex-premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, qui reprend l’ancienne charge de Marchand.
Lionel Fortin affirme que c’est « au cours de la session de 1879 que le gouvernement Joly eut à se défendre dans l’affaire Gowen, affaire dans laquelle se trouva impliqué Marchand à titre de Commissaire des Terres de la Couronne. Selon les accusations portées par Israël Tarte, député de Bonaventure, le ministère [de Marchand] aurait sacrifié pour 5 000 $ une hypothèque de 17 000 $ que le gouvernement possédait sur une propriété que venait d’acquérir Hamond Gowen, le beau-frère du premier ministre Joly. La Chambre ne tarda pas à former un comité d’enquête sur cette affaire. Aux dires de Marchand, qui fut interrogé sur cette transaction, le gouvernement avait fait une excellente affaire en acceptant 5 000 $ ».
Le journal L’Événement du 29 juillet 1879 reprend les explications de Marchand : « […] qu’après les précautions qu’il avait prises et suivant l’avis des évaluateurs, [Marchand] s’était cru justifiable d’accepter l’offre de M. Gowen. Il considère la partie concédée comme n’ayant aucune valeur […]. Du reste c’était l’opinion de tout le monde que cette propriété avait perdu beaucoup de sa valeur, à cause de l’arrêt survenu dans la construction navale à Québec. Il est d’opinion que cette industrie ne renaîtra qu’après la condamnation des navires en fer. Il considérait aussi en faisant cette transaction que les difficultés légales étaient insurmontables et que la propriété avait diminué considérablement de valeur. […] Il jure positivement que dans toute cette affaire il n’a eu en vue que l’intérêt public. »
Le comité dépose son rapport en août 1879. Gérard Bergeron résume ainsi les conclusions du rapport : « l’opération n’avait eu “rien de malhonnête”, mais qu’on pourrait discerner “une erreur de jugement […] en ceci qu’on aurait pu faire de meilleurs arrangements, dans l’intérêt de la province”. Le gouvernement donc, sous la responsabilité du [ministre] Marchand, “a agi de bonne foi” et doit être exempt de tout blâme au sujet de cette transaction ».
De retour à l'opposition
Pendant ce temps, le gouvernement libéral minoritaire a de la difficulté à faire adopter tous les projets de loi qu’il souhaite de peur de perdre la confiance fragile de la Chambre. Ce qui devait arriver arriva. Le 29 octobre 1879, le gouvernement Joly perd le vote sur une motion de censure suite à la défection de cinq députés libéraux vers les conservateurs, dont le futur premier ministre Edmund James Flynn et Alexandre Chauveau, le fils de l’ex-premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Le premier ministre Joly demande au nouveau lieutenant-gouverneur Théodore Robitaille de dissoudre les Chambres. Ce dernier refuse et le destitue le 30 octobre 1879. Le 31 octobre 1879, le nouveau premier ministre conservateur Joseph-Adolphe Chapleau et son cabinet sont assermentés.
Alex Tremblay Lamarche mentionne que « de retour dans les “les « froides régions” de l’opposition — l’expression est de Marchand —, le député de Saint-Jean reprend ses critiques à l’endroit du gouvernement. Sous le ministère Chapleau, il est un jour question d’emprunts. Comme le gouvernement Joly de Lotbinière avait réussi à faire un emprunt au taux de 4 %, mais que celui de son successeur n’avait été capable d’en faire un de même nature qu’au taux de 5 %, le magnat des chemins de fer Louis-Adélard Senécal s’était engagé à payer la différence de 1 % pour “mettre ses amis en état de dire que leur emprunt était aussi avantageux”. Pressés de dire combien ils avaient réellement payé pour cet emprunt, les conservateurs répondent par la voix du ministre Louis-Onésime Loranger : “Quatre pour cent net” et Marchand répond du tac au tac : “Oui, quatre pour cent net et un pour cent sale”. »
Élection québécoise du 2 décembre 1881
Le 7 novembre 1881, la Chambre est dissoute en vue d’un scrutin le 2 décembre 1881. Lionel Fortin constate qu’à Saint-Jean, « la campagne électorale débuta une semaine après la dissolution de l’Assemblée législative. Le lundi soir 14 novembre 1881, avait lieu à Saint-Jean une grande réunion des électeurs, libéraux et conservateurs, favorables à la candidature de Charles Arpin, courtier de Saint-Jean. Voulait-on éliminer Marchand ? Cela n’est pas impossible surtout de la part d’une fraction des libéraux du comté sans doute mécontents du peu de patronage qu’il avait fait au moment où il était ministre. Cependant, cette tentative de renversement échoua, car M. Arpin se retirait peu après […]. […] Quelques jours plus tard, vu la défection de son adversaire, Félix-Gabriel Marchand se voyait réélu une fois de plus député du comté de Saint-Jean, par acclamation, le 25 novembre 1881. »
Le gouvernement conservateur de Joseph-Adolphe Chapleau est maintenu au pouvoir lors de l’élection du 2 décembre 1881. Les conservateurs font élire 49 députés avec 50 % des votes et les libéraux 15 députés avec 39 % des votes. Il y a un député conservateur indépendant.
La montée d'Honoré Mercier
Pendant que les conservateurs se réinstallent au pouvoir, une nouvelle étoile émerge au firmament libéral. Honoré Mercier est un jeune et brillant avocat, né en 1840 à Saint-Athanase (Saint-Jean-sur-Richelieu), dans cette ancienne partie qui est aujourd’hui Sainte-Anne-de-Sabrevois. Il est député libéral de Saint-Hyacinthe depuis 1879. Il succède à Joly en 1883 à la tête du Parti libéral. Il prône l’idée d’un « Parti national » qui grouperait toutes les forces progressistes du Québec.
Selon Lionel Fortin : « Comme chef d’opposition, Mercier se montra dès lors déterminé à consacrer tous ses talents et toute son énergie à faire triompher les vues de son parti dans la politique provinciale. Sous le commandement de ce chef énergique, la phalange libérale ne cessa d’attaquer les gouvernements conservateurs de [Joseph-Adolphe] Chapleau (1879-1882), [Joseph-Alfred] Mousseau (1882— 1884), [John Jones] Ross (1884-1887). Les conservateurs de leur côté, souvent à court d’arguments, se rabattaient sur l’ex-gouvernement Joly. »
Élection québécoise du 14 octobre 1886
Le 9 septembre 1886, la Chambre est dissoute en vue d’un scrutin le 14 octobre 1886. Lionel Fortin décrit la campagne libérale ainsi : « Profitant de l’impopularité du gouvernement conservateur d’Ottawa qui avait ordonné la pendaison du chef métis, Louis Riel en 1885, Mercier centra sa campagne électorale sur cet événement pour soulever la population contre les conservateurs du Québec que les journaux libéraux du temps surnommaient “les pendards”. »
Lionel Fortin précise que « les conservateurs du comté mirent presque trois semaines avant de trouver un candidat capable de faire opposition à Marchand. Ne trouvant personne dans le comté, ils durent, en désespoir de cause, aller chercher l’avocat Louis-Philippe Pelletier de Montréal. »
Lionel Fortin ajoute : « Parachuté de Montréal et pratiquement inconnu des électeurs, le candidat Pelletier ne jouissait guère de la popularité comme M. Marchand. Les chefs conservateurs de Saint-Jean, les frères John et Henderson Black, Charles Arpin et E. R. Smith, propriétaire-éditeur du “ News”, firent alors des pieds et des mains pour assurer le triomphe de leur candidat. Tous les moyens leur semblèrent bons dans ces circonstances pour arriver à leurs fins. Ils organisèrent donc une campagne de diffamation sur le compte de l’Honorable Marchand. Ils parcouraient les rangs et faisaient du porte-à-porte dans le but de convertir les électeurs à leur cause. Dans la région de Roxham (Saint-Bernard-de-Lacolle) composée en partie d’électeurs anglophones et protestants, ils tentèrent de soulever le sentiment national et religieux contre le candidat libéral. John Black alla jusqu’à dire que M. Marchand avait déclaré dans un discours que le temps était arrivé de chasser tous les protestants du pays ! Un pareil mensonge ne pouvait rester sans démenti. M. Marchand convoqua une assemblée publique à Roxham et somma Black et Pelletier de prouver leurs dires. Tous deux furent obligés de les désavouer et de reconnaître devant les électeurs la fausseté de leurs assertions. »
Le 5 octobre 1886, le chef libéral Honoré Mercier arrive par train, vers huit heures du soir, à Saint-Jean. Une foule énorme l’attend au pavillon à patiner de Saint-Jean où il doit tenir l’assemblée. Le journal Le Franco-Canadien du 8 octobre 1886 présente cette soirée ainsi : « L’hon. M. Mercier fit son entrée, ayant à la main un bouquet que l’on venait de lui offrir. […] De longues acclamations retentirent aussitôt. Après quelques paroles d’introduction par M, Marchand, le chef de l’opposition prit la parole. Il dit qu’il en était à sa 73e assemblée depuis deux mois et demi ; qu’il avait parcouru toute la province, et que partout le sentiment populaire était adverse au gouvernement. Il a prié les électeurs de ne pas le priver des services précieux, et de l’expérience de l’hon. M. Marchand, dont il aura besoin pour les combinaisons à faire après la chute maintenant certaine du gouvernement. M. Marchand ayant combattu depuis longtemps et ayant fait des sacrifices considérables pour la bonne cause, il est juste, ajouta l’orateur, qu’il partage les honneurs du triomphe. »
Lors du dépôt des candidatures, deux jours plus tard à l’Hôtel de Ville de Saint-Jean, le bulletin de Marchand compte plus de 360 signatures. Le même jour, il fera un triomphe devant plus de 1 200 personnes réunies à la Place du Marché de Saint-Jean. Le 14 octobre 1886, Marchand est de nouveau réélu haut la main dans la circonscription de Saint-Jean.
Comme prédit par Mercier, le gouvernement conservateur de John Jones Ross perd l’élection. Les libéraux font élire 33 députés avec 39 % des votes et les conservateurs 26 députés avec 46 % des votes. Il y a 3 députés conservateurs indépendants et 3 députés nationalistes. Malgré la majorité libérale, les conservateurs tentent de rester au pouvoir, car ils espèrent le ralliement des 6 députés conservateurs indépendants et nationalistes. Constatant son incapacité à gouverner, le premier ministre Ross démissionne finalement le 25 janvier 1887. Louis-Olivier Taillon est désigné premier ministre par le lieutenant-gouverneur le jour même.
LE MINISTRE

Mosaïque du conseil des ministres du premier ministre Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Journal L'Opinion publique. 4 avril 1878.
Assemblée nationale du Québec
Fonds Assemblée législative


Livre Letellier de Saint-Just et son temps ayant probablement appartenu à Félix-Gabriel Marchand et sauvé de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1885.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Résultats de l'élection québécoise de 1878 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Diagramme des sièges des députés à l'Assemblée législative du Québec. 1878.
Collection Lionel Fortin
Abolition du Conseil législatif
Maintenu dans ses fonctions de ministre, Marchand se fait le promoteur d’une mesure au cœur du programme libéral de l’élection de 1878 : abolir le Conseil législatif. Ce dernier est formé de 24 conseillers législatifs nommés par le lieutenant-gouverneur suite aux recommandations du premier ministre. Bien qu’ils ne soient pas élus par la population, un certain nombre de ces membres occupent, à diverses époques, des fonctions de ministre et même de premier ministre : Charles Boucher de Boucherville (1874-1878 et 1891-1892) et John Jones Ross (1884-1887).
Le Conseil législatif dispose des mêmes pouvoirs que l’Assemblée législative, sauf celui de soumettre des projets de loi à caractère financier. Les conseillers législatifs détiennent surtout un veto sur la législation votée par les députés. Marco Bélair-Cirino et Dave Noël ajoutent que les « membres du Conseil y ont recours en 1898 pour bloquer l’adoption d’un projet de loi libéral[, présenté par Marchand,] rétablissant le ministère de l’Instruction publique, qui avait été aboli par les conservateurs en 1875. »
Marco Bélair-Cirino et Dave Noël précisent que « les 24 membres de la Chambre haute du Parlement doivent — jusqu’en 1921 — posséder des biens-fonds dans la “division” qu’ils représentent. Le tracé des districts est dessiné à l’avantage des régions anglophones, ce qui inquiète une partie de la classe politique québécoise de 1867 qui redoute l’érection d’une “forteresse anglaise” au cœur des institutions politiques du Canada français. »
Le projet de loi de Marchand visant l’abolition du Conseil législatif est finalement adopté par l’Assemblée législative à la majorité. Cependant, comme ce « bill » devait également être approuvé par ce même Conseil qu’on voulait abolir, il fut rejeté comme il fallait s’y attendre. Pour conforter les libéraux dans leur argumentaire, la « Chambre haute », à majorité conservatrice, bloque près du tiers des projets de loi du gouvernement libéral adoptés par la « Chambre basse ».
Marco Bélair-Cirino et Dave Noël se souviennent que c’est finalement, près d’un siècle plus tard, « le premier ministre unioniste Jean-Jacques Bertrand qui signe l’arrêt de mort de la Chambre haute. Le “bill 90” sur l’abolition du Conseil législatif est adopté par l’Assemblée législative à la fin de novembre 1968. Il est étudié à toute vapeur au Salon rouge à compter du 12 décembre […]. » Le Québec est la dernière province à l’abolir, 40 ans après la Nouvelle-Écosse.

Projet de loi (Bill 110), acte pour incorporer « La compagnie du chemin de fer de Saint-Jean à
Sorel ». 4e législature, 3e session (28 mai 1880 - 24 juillet 1880).
Fonds Assemblée nationale du Québec

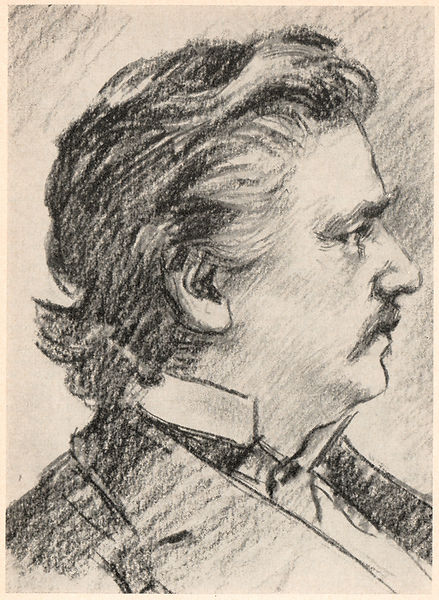
Portraits des premiers ministres du Québec Henri-Gustave Joly de Lotbinière et Joseph-Adolphe Chapleau.
Collection Dave Turcotte


Portraits des premiers ministres du Québec Joseph-Alfred Mousseau et John Jones Ross.
Collection Dave Turcotte


Portraits des premiers ministres du Québec Louis-Olivier Taillon et Honoré Mercier.
Collection Dave Turcotte

Résultats de l'élection québécoise de 1886 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Photographie de l'opposition libérale à l'Assemblée législative du Québec. 1883
Assemblée nationale du Québec
Photographe Jules-Ernest Livernois
Le président
Élu président de l'Assemblée législative
Le 27 janvier 1887, au cœur de cette querelle politique, Félix-Gabriel Marchand est élu orateur, président comme on dit de nos jours, de l’Assemblée législative. Jacques Lacoursière écrit : « Le 27, les députés se réunissent pour choisir un orateur. C’est l’occasion du premier affrontement majeur. On sent partout que l’atmosphère est surchauffée. Selon la Minerve, “Québec ressemble plutôt à une ville en insurrection qu’à une capitale”. Le premier ministre Taillon propose Henri-Édouard Faucher [député] de Saint-Maurice au poste de président de l’Assemblée. La motion est rejetée par [32 voix contre 27]. Mercier propose alors la candidature de Félix-Gabriel Marchand, qui est acceptée par 35 voix contre 27. Ce premier vote est, en quelque sorte, une manifestation de non-confiance à l’égard du ministère Taillon. »
Le Franco-Canadien du 4 février 1887 ajoute : « Aussitôt le vote proclamé, des applaudissements et des hourras enthousiastes s’élevaient de toutes parts, du parquet de la chambre comme des galeries, en dépit des règles de la chambre ; mais l’enthousiasme débordait et ne connaissait plus de bornes. L’hon. M. Marchand prit son siège escorté de l’hon. M. Mercier […]. Alors le nouvel élu reçut les félicitations des deux côtés de la chambre. M. Taillon et ses partisans l’entourèrent en le félicitant. C’était une scène curieuse, dit le correspondant du [journal] Star, et tout le monde en jouissait de tout cœur. Les félicitations des nationaux ne firent pas défaut non plus, comme on le pense bien. L’hon. M. Marchand n’avait pas assez de ses deux mains pour répondre aux joyeuses accolades de ses amis. »
Tous les journaux de l’époque accueillent l’élection du président Marchand avec beaucoup d’éloges. Le journal L’Électeur affirme : « Si jamais une nomination a été de nature à réjouir le cœur des libéraux, c’est bien celle de l’hon. M. Marchand à la présidence de l’Assemblée législative. C’est un véritable sujet de réjouissance pour tout son parti que de voir ce vétéran de nos luttes, cet homme intègre et ferme qui siège dans l’Assemblée législative depuis 1867 et qui depuis plus de vingt ans s’est tenu solide au poste, combattant de sa plume et de sa parole, dans l’arène publique et à la chambre, recevoir aujourd’hui la récompense cent fois méritée de son travail. Comme tous nos hommes supérieurs, il a été le point de mire de la calomnie ; mais ses adversaires ont en vain cherché à souiller son nom, qui est resté sans tache. Aussi les félicitations qui lui sont venues de toutes parts hier, à son installation au trône, avaient-elles quelque chose de particulièrement cordial même de la part de ses adversaires dont il n’a jamais, on peut le dire, perdu la sympathie personnelle. Merci donc, du fond du cœur, à notre chef l’hon. M. Mercier d’avoir donné à ce vieux compagnon d’armes, à ce fidèle ami d’enfance, à ce champion zélé de la cause nationale, le poste le plus honorable qu’il était en son pouvoir de conférer. »
Mais le début de mandat du président Marchand est houleux, car immédiatement après son élection, le nouveau premier ministre conservateur Louis-Olivier Taillon demande d’ajourner la Chambre sans fournir d’explications sur le changement de Cabinet (Ross à Taillon) tel que le demande le chef de l’opposition, Honoré Mercier. Seulement trois jours après son assermentation, le gouvernement Taillon est renversé. Taillon se voit forcé de donner sa démission. Il est d’ailleurs le premier ministre ayant eu le mandat le plus court de l’histoire du Québec. Le 29 janvier 1887, le chef libéral Honoré Mercier est assermenté premier ministre ainsi que son cabinet.
Alex Tremblay Lamarche déclare que « s'ouvrent alors “les cinq sessions les plus mondaines” qu'airait connues le parlement de son histoire. Dès l’hiver 1887, Marchand s’installe dans les appartements de fonction qui lui sont réservés dans l’hôtel du Parlement et se fait un devoir de remplir avec son épouse les obligations sociales et mondaines qui leur incombent. Les appartements de l’orateur sont en effet à l’époque “le salon mondain par excellence de la haute société politique et bourgeoise de Québec”. »
Alex Tremblay Lamarche souligne que « Marchand profite également de son mandat pour faire “de grandes améliorations en faveur de ses confrères” journalistes sur le paquet de la chambre. Cela ne l’empêche pas pour autant de se montrer particulièrement prudent avec les deniers de la province. Ses échanges avec le greffier de l’Assemblée législative révèlent en effet un politicien soucieux d’éviter toute dépense superflue. La tâche est toutefois loin d’être facile. Depuis son accession à la présidence, Marchand est devenu celui qui gère le plus fort contingent de fonctionnaires à l’Assemblée et les requêtes de la part de députés désireux de trouver une place pour un proche dans l’administration publique ne manquent pas ! Alors que l’époque est au favoritisme et au clientélisme, le député de Saint-Jean résiste aux pressions pour maintenir les finances de la province à flot. »
Élection québécoise du 17 juin 1890
Le 9 mai 1890, la Chambre est dissoute et le jour de l’élection est fixé au 17 juin suivant. Lionel Fortin trace un survol de cette élection. « Ces nouvelles élections étaient gagnées d’avance puisque le gouvernement Mercier était alors plus populaire que jamais au Québec. Dans le comté de Saint-Jean, cette cote de confiance se manifesta à l’égard de l’Honorable Félix-Gabriel Marchand lors de son retour à Saint-Jean. Le samedi soir 29 mars 1890, l’Honorable député du comté de Saint-Jean et président de l’Assemblée législative arrivait par train à la gare du Grand Tronc, à Saint-Jean. Une foule nombreuse, escortée par deux corps de musique, l’attendait déjà pour le conduire à l’Hôtel de Ville où le maire de la ville, M. Wilfrid Brosseau, lui lut une adresse élogieuse. […] La campagne électorale débuta peu après dans le comté. Comme prévu, Marchand fit la tournée des paroisses pour rencontrer ses électeurs et les mois d’avril et mai passèrent sans que paraisse l’ombre d’un candidat conservateur pour lui faire opposition. Cependant, au début de juin, à la grande surprise des libéraux qui escomptaient déjà une élection par acclamation, l’avocat conservateur Antonin-David Girard, de Saint-Jean, était désigné comme porte-drapeau de son parti dans le comté. […] Puis arriva le 17 juin 1890, jour du scrutin. L’Hon. Marchand obtint à cette élection, la plus grosse majorité de sa carrière politique, soit 436 voix. […] Les Libéraux furent en liesse non seulement dans le comté de Saint-Jean, mais partout dans le Québec. Un balayage libéral venait de donner à Mercier un triomphe sans précédent ».
Le gouvernement Mercier est maintenu au pouvoir faisant élire 43 députés avec 44 % des votes et les conservateurs 23 députés avec 45 % des votes. Les autres sièges sont répartis entre un député ouvrier, un conservateur indépendant et cinq nationalistes. Le 4 novembre 1890, jour de la première séance de la septième législature, Marchand est maintenu dans sa fonction de président de l’Assemblée législative.
Des investissements pour Saint-Jean
Lionel Fortin décrit que « c’est sous le gouvernement Mercier, que Marchand obtint enfin quelques faveurs pour le comté de Saint-Jean tenu jusqu’ici, sauf durant un an et demi, dans “les froides régions de l’opposition”. C’est ainsi que, grâce à son député, la Ville de Saint-Jean reçut la concession d’un superbe terrain d’une valeur de 2 000 $ qui fut converti en parc public et baptisé “Parc Marchand”. L’Hôpital de Saint-Jean pour sa part reçut une subvention spéciale de 500 $. Marchand s’occupa également de faire réparer le Palais de Justice de Saint-Jean, négligé par les gouvernements conservateurs, au coût de 13 000 $. Marchand s’employa de plus à faire octroyer une indemnité de 3 500 $ aux victimes du grand incendie qui avait dévasté le centre-ville de Saint-Jean, en 1876, et à subventionner la Société d’Agriculture du comté par le versement de 2 200 $. D’autres montants furent aussi distribués pour des travaux de voirie ou d’égouttement des terres, soit 1 500 $ pour un pont en fer à Saint-Luc et 4 500 $ pour le creusement de la rivière Lacolle, afin de récupérer de 6 000 à 8 000 arpents de terre jusque-là inutilisés. »
La chute de Mercier
Lionel Fortin explique qu’à « l’automne 1891, le gouvernement Mercier fut compromis quand éclata le scandale de la baie des Chaleurs. Les conservateurs avaient découvert qu’Ernest Pacaud, le trésorier du parti de Mercier, avait encaissé une part dans l’octroi voté pour la construction d’un chemin de fer à la baie des Chaleurs. Cet événement devait servir de tremplin aux conservateurs et précipiter la chute de Mercier qui fut lui-même accusé d’avoir trempé dans l’affaire. »
Le 21 décembre 1891, face à ce scandale, le lieutenant-gouverneur Auguste-Réal Angers destitue de ses fonctions le premier ministre libéral Honoré Mercier. Le jour même, le conservateur Charles-Eugène Boucher de Boucherville, qui a été premier ministre de 1874 à 1878, est de nouveau assermenté ainsi que son cabinet.
Lionel fortin précise qu’il « faut dire que durant tout le “règne” du gouvernement Mercier, le député de Saint-Jean, devenu président de l’Assemblée législative, avait évité de s’impliquer dans les décisions du Conseil des ministres afin de garder la plus parfaite impartialité. Tout au plus, avait-il discrètement souligné à Mercier son manque de prudence dans l’utilisation des fonds publics et le danger que représentaient certains amis politiques, organisateurs électoraux et ramasseurs de miettes qui gravitaient autour du Cabinet. Mais Mercier, aveuglé par le prestige du pouvoir, n’écouta pas ces judicieux conseils. Les événements de la baie des Chaleurs devaient donner raison à Marchand, mais il était déjà trop tard pour Mercier dont la réputation allait être compromise et la santé gravement altérée dans le cours de cette pénible affaire. »
Quant à Honoré Mercier, il est cité à procès l’année suivante et il est déclaré non coupable après seulement 17 minutes de délibération du jury.
Élection québécoise du 8 mars 1892
Minoritaire, le premier ministre conservateur Charles-Eugène Boucher de Boucherville fait dissoudre la Chambre le 22 décembre 1891 et le lendemain, il déclenche une élection pour un scrutin le 8 mars 1892.
Lionel Fortin raconte que « dès la mi-janvier 1892, Marchand se trouva en campagne électorale dans le comté pour faire face à Jacques-Emery Molleur, un ancien libéral que l’ambition avait poussé à accepter la candidature conservatrice dans le comté de Saint-Jean. Le premier “coup de feu” entre libéraux et conservateurs fut tiré à Saint-Blaise lors d’une assemblée qui eut lieu entre des partisans libéraux et Jacques-Emery Molleur, le lundi 8 février 1892. Les conservateurs s’attachèrent surtout à discréditer le gouvernement Mercier espérant, par le fait même, viser Marchand. Or cette manœuvre ne réussit qu’à mieux prouver la parfaite honnêteté du député sortant qui avait gardé ses distances et son indépendance lorsqu’il était dans le Cabinet. […] Les conservateurs ne se tinrent pas pour battus et changeant de front cette fois-ci, ils reprochèrent à l’Honorable Marchand de “n’avoir jamais rien fait pour son comté”. On ne fut pas lent chez les libéraux à donner la riposte. Les pauvres conservateurs étaient vraiment en mal de scandale. Ils n’eurent d’autres ressources finalement que de faire publier et circuler dans le comté un chiffon répandant les calomnies les plus sottes contre Marchand et sa famille. »
À ce sujet, Lionel Fortin rappelle que « dans son édition du 30 juin 1892, le Franco-Canadien rapportait que l’Honorable Marchand venait d’intenter contre Jacques-Emery Molleur, son adversaire aux dernières élections, et contre les propriétaires du journal News, de Saint Jean, deux actions pour dommages au montant de 25 000 $ chacune, basées sur une accusation diffamatoire et fausse contenue dans une adresse aux électeurs du comté de Saint-Jean, publiée par Molleur dans un supplément du News et propagée avec profusion durant la lutte. Six mois plus tard, un jugement était finalement rendu en janvier 1893 en Cour Supérieure, par le Juge Gill condamnant Jacques-Emery Molleur à payer à Marchand à titre de dommages-intérêts la somme de 500 $. »
Le 13 février 1892, se tient à Saint-Jean la première assemblée politique où les deux candidats se font face. Le journal Le Franco-Canadien du 18 février 1892 transcrit la réplique de Marchand aux détracteurs du gouvernement libéral d’Honoré Mercier. « J’occupe, dit-il, depuis cinq ans la position de président de l’Assemblée législative. Cette position m’imposait des fonctions et des devoirs tout spéciaux que je me suis efforcé de remplir au mieux de mes faibles capacités ; elle m’obligeait surtout à la plus stricte impartialité à l’égard des deux partis politiques représentés par la députation, et me plaçait, durant mon terme d’office, en dehors du mouvement de la politique active. Comme preuve du fidèle accomplissement de mes difficiles fonctions, je suis heureux de pouvoir invoquer le témoignage que toute la députation m’a rendu en me réélisant unanimement à la présidence au début de la dernière session. J’ai donc à vous rendre compte aujourd’hui, non pas de ma conduite en rapport avec la politique active des partis, mais de l’accomplissement de mon devoir dans la position spéciale que j’ai occupée. Cette position je l’occupe encore, et je ne serai dispensé des devoirs qu’elle m’impose qu’à l’ouverture de la prochaine législature provinciale. Je suis donc à l’heure qu’il est le gardien obligé de la dignité et des prérogatives de l’Assemblée législative. À ce titre, je suis tenu de protester contre l’empiètement commis par le chef de l’exécutif sur ces mêmes prérogatives lorsqu’au lieu de convoquer les chambres, comme il en a été requis, pour les mettre en position de juger des accusations portées contre ces ministres, il s’est arrogé arbitrairement et inconstitutionnellement le droit de créer un tribunal à sa guise pour en disposer au mépris des principes les plus élémentaires du gouvernement responsable. Il est aussi de mon devoir de protester au nom de l’Assemblée législative contre la violation de la loi au moyen de laquelle de l’avis de ses aviseurs irresponsables, le lieutenant-gouverneur a omis de convoquer la législature dans le délai légal et soumis inutilement le peuple de cette province à tous les inconvénients et aux énormes dépenses d’une élection générale, après avoir dissout des chambres tout fraîchement élues par le peuple. »
Le 23 février 1892, à Saint-Valentin, le candidat conservateur Molleur s’en prend à la pauvreté de Marchand. La réplique de Marchand, si on en juge à partir du journal Le Franco-Canadien du 25 février 1892, est solide : « Vous venez d’entendre, dit M. Marchand, mon adversaire, faire grand étalage de ses richesses et de ma pauvreté. Malheureusement, je suis pauvre, et heureusement pour M. Molleur, il est riche. Il s’est enrichi en faisant travailler le peuple qui est resté pauvre, moi, je me suis appauvri pour le peuple. Entre nous deux voilà la différence. Mais, je voudrais bien savoir de vous, M. Molleur, continua M. Marchand, ce que votre grand cœur d’homme riche vous a fait souscrire pour la Société d’agriculture du comté de Saint-Jean, depuis trois ans ? — Silence de la part de M. Molleur – “Eh bien, je vais le dire pour vous, ajouta M. Marchand. Il y a trois ans vous avez souscrit 1 $ ; il y a deux ans, 2 $ et l’année dernière en prévision des élections, sans doute, 5 $. L’obole du riche. Et moi, l’homme pauvre il y a trois ans, j’ai souscrit 105 $, il y a deux ans 25 $ et l’an dernier encore 25 $. L’obole du pauvre.” Cet incident a causé un émoi saisissant et la mine déconfite du candidat a prouvé jusqu’à la fin de l’assemblée que le coup avait porté juste. »
Selon la Gazette officielle de Québec, les dépenses électorales de Marchand se chiffrent à 215 $ et celles de son adversaire, Jacques Emery Molleur, atteignent 651 $. Le 8 mars 1892, Marchand est de nouveau réélu député de Saint-Jean. Cependant, à sa grande désolation, le nouveau gouvernement conservateur du premier ministre Charles-Eugène Boucher de Boucherville est maintenu au pouvoir. Les conservateurs font élire 51 députés avec 52 % des votes et les libéraux 21 députés avec 44 % des votes. Il y a un député conservateur indépendant.
Le 26 avril 1892, à la reprise des travaux parlementaires, n’étant plus député ministériel, Marchand est contrait de laisser sa charge de président de l’Assemblée législative.
LE PRÉSIDENT

Photographie du président Félix-Gabriel Marchand sur le trône lors d'une séance de l'Assemblée législative du Québec. 1887.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe A. R. Roy

La table de l'orateur était utilisée par le président de l'Assemblée (dont Marchand) de 1886 à 1976 pour déposer ses documents pendant les séances. Elle était située à droite du trône. Elle est visible sur la photo précédente.
Table du président de l'Assemblée législative du Québec.
Assemblée nationale du Québec
Photographe Musée du Haut-Richelieu

Ce marteau de l'orateur était utilisé (1931 à 1968) par le président de l'Assemblée pour ramener les députés à l'ordre.
Marteau du président de l'Assemblée législative du Québec.
Assemblée nationale du Québec
Photographe Musée du Haut-Richelieu
Manuel de l'Assemblée législative du Québec.
Collection Dave Turcotte
Livre La Province de Québec.
Collection Dave Turcotte


Procès-verbaux de l'Assemblée législative de la province de Québec ayant probablement appartenu à Félix-Gabriel Marchand et sauvé de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1887.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français


Statutes of the Province of Quebec, passed in the Fifty-Fourth Year of the Reign of Her Majesty Queen Victoria ; and in the First Session of the Seventh Legislature ayant probablement appartenu à Félix-Gabriel Marchand et sauvé de l'incendie du journal Le Canada Français en 1988. 1890.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Retaille d'une reliure de livre personnalisé au président Félix-Gabriel Marchand. 1887.
Société d'histoire du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français

Huile sur toile de l'artiste Eugène Hamel dans la Galerie des Présidents. 1889.
Assemblée nationale du Québec
Photographe Francesco Bellomo

Photographie du président Félix-Gabriel Marchand dans la Galerie des orateurs à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. 1887.
Assemblée nationale du Québec
Photographe Livernois

Carte d'accès à la Tribune privée de l'orateur Félix-Gabriel Marchand. Entre 1887 et 1892.
Assemblée nationale du Québec.
Collection Yves Beauregard

Portrait de Antonin-David Girard, candidat conservateur dans Saint-Jean lors de l'élection québécoise de 1890.
Collection Lionel Fortin

Résultats de l'élection québécoise de 1890 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Mosaïque des députés de l'Assemblée législative du Québec. 1890.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe M. A. Montminy

Le Palais de justice de Saint-Jean fut bâti au cours de 1859-1860. Félix-Gabriel Marchand a obtenu de l'argent de son gouvernement pour des travaux de réparations. Il sert toujours aux mêmes fonctions depuis cette époque.
Photographie du Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. 1979.
Collection Lionel Fortin

À l'époque du gouvernement Mercier, grâce à Félix-Gabriel Marchand, la ville de Saint-Jean reçoit la concession d’un superbe terrain d’une valeur de 2 000 $ qui est converti en parc public et baptisé Parc Marchand. Situé derrière le Palais de justice, ce magnifique parc porte aujourd'hui le nom de parc Félix-Gabriel Marchand.
Photographie du parc Félix-Gabriel Marchand à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Musée du Haut-Richelieu

Lettre du premier ministre Honoré Mercier au lieutenant-gouverneur Auguste Réal Angers en lien avec l'affaire de la baie des Chaleurs.
Collection Dave Turcotte

Portrait de Jacques-Emery Molleur, candidat conservateur dans Saint-Jean lors de l'élection québécoise de 1892.
Collection Lionel Fortin

Résultats de l'élection québécoise de 1892 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Chef de l’opposition
Lionel Fortin rappelle que « la chute du gouvernement [libéral] et le discrédit jeté sur le nom d’Honoré Mercier à cause de l’affaire de la baie des Chaleurs entraîna une crise au niveau du leadership du Parti. Mercier dut démissionner comme chef du Parti libéral et aussitôt la petite phalange oppositioniste se regroupa autour de l’honorable Félix-Gabriel Marchand dont la réputation d’honnêteté était devenue proverbiale. »
Selon Alex Tremblay Lamarche, « s’il n’a pas l’éloquence et le charisme d’un Mercier ou d’un Chapleau, le député de Saint-Jean présente ce dont le Parti libéral a le plus besoin à ce moment : un chef à la réputation irréprochable connu de tous pour son honnêteté et son intégrité. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on songe à le porter à la tête du parti. Dès 1878, son nom circule en effet dans les rangs des libéraux pour remplacer Joly de Lotbinière. Au cours des années qui suivent, lorsque ce dernier s’absentait, c’est Marchand qui le remplaçait. »
Le journal Le Franco-Canadien du 12 mai 1892 décrit les premières séances du nouveau chef d’opposition contre le gouvernement conservateur. « L’opposition sous la direction de l’hon. M. Marchand, qui se montre chef vigoureux et “debater” accompli, fourbit ses armes et se prépare à l’assaut. Dans la discussion sur le discours du trône, on a pu s’apercevoir que l’opposition de Sa Majesté ne craignait pas de porter des coups. De fait, les meilleurs discours ont été ceux de nos amis qui, rangés en phalange serrée autour de leur chef, sont bien décidés de faire face à l’ennemi et de ne pas reculer d’une semelle. Ils ont pleine confiance dans le chef qui les dirige. Sa grande prudence leur était bien connue, comme maintenant sa fermeté de caractère et sa vaillance au combat les émerveillent. L’abolition du Conseil législatif devient un des principaux articles du programme de l’opposition. »
Moins d’un an après l’élection du 8 mars 1892, le premier ministre conservateur de Boucherville démissionne le 13 décembre 1892 suite à la nomination de l’ancien premier ministre conservateur Joseph-Adolphe Chapleau à titre de lieutenant-gouverneur. Les relations entre les deux hommes étaient tendues. L’ex-premier ministre Louis-Olivier Taillon est de nouveau assermenté premier ministre le 16 décembre 1892.
Le journal Le Franco-Canadien du 19 avril 1895 explique la lourde tâche de Marchand comme chef de l’opposition. « M. Marchand, nous le savons, a accepté avec répugnance la position de chef. Avec la modestie qui le caractérise, il ne se prétendait pas qualifié à occuper ce poste de confiance auquel l’élevait son parti, il a prouvé une fois de plus la vérité du proverbe qu’on est toujours mauvais juge dans sa propre cause. Ce n’était pas à vrai dire, une besogne enviable que celle de diriger le Parti libéral après la manière dont il avait été décimé aux élections de 1892. La démoralisation était dans nos rangs et les adversaires, en gros bataillons, en poltrons qu’ils sont, traitaient nos amis avec morgue et insolence. M. Marchand ne se laissa pas déconcerter : il fit face comme un homme à cet orage de calomnies et d’infamies. Peu à peu, il réussit à faire renaître le courage parmi ses partisans tant de la chambre qu’au-dehors. À force de tact et de modération, la nouvelle députation finit par s’apercevoir que ceux que les meneurs bleus lui avaient représentés comme des voleurs, avaient pour chef un gentilhomme irréprochable. Bien des préjugés tombèrent et bien des yeux se désolèrent alors. Depuis qu’il est son chef, M. Marchand a dirigé l’opposition avec prudence, il n’a pas commis de faux pas. Il n’a pas la prétention d’être un orateur, mais il parle avec concision et clarté. Il n’y a rien du démagogue chez lui ; ce qu’il fait, il le fait avec la conviction sincère que c’est dans l’intérêt public. Vous ne le verrez jamais encourager une opposition factieuse sans but […]. Un homme de cette trempe est toujours sûr de posséder l’estime publique et le respect de ses adversaires eux-mêmes. Irréprochable sous tous les rapports, d’un caractère élevé, conciliant tout en restant ferme, le nom de M. Marchand est un drapeau dont un parti est orgueilleux de bon droit. »
Lionel Fortin rapporte qu’au « début de décembre [1895], l’Honorable Marchand présentait une motion qui attira beaucoup l’attention de la presse. Devant le mauvais état des finances provinciales, Marchand proposa qu’un comité de onze membres choisis dans les deux partis soit nommé pour étudier la situation financière et son système administratif en vue de trouver des moyens de l’améliorer en dehors de toute considération de parti. Il ajouta qu’il était prêt à tenter cet effort, en homme d’État et en homme d’affaires, et à appliquer un remède comme le feraient les actionnaires d’une banque dont les opérations se solderaient par un déficit. Cependant, le gouvernement conservateur refusa de concourir à cette offre généreuse et chevaleresque. »
Le 4 mai 1896, le premier ministre Taillon annonce sa démission pour faire le saut en politique fédérale à titre de ministre des Postes. Il demeure premier ministre jusqu’au 11 mai 1896. Ce jour-là, Edmund James Flynn est assermenté premier ministre. L’élection du premier ministre Wilfrid Laurier à Ottawa, le 23 juin 1896, met fin à près de 18 ans de règne conservateur au fédéral. Cette victoire libérale met la table pour l’élection québécoise à venir.
La pré-campagne
Constatant l’engouement des Québécois pour les libéraux de Laurier et implicitement de Marchand, le premier ministre Flynn se met tout de suite en campagne. L’historien Robert Rumilly raconte que « le 6 septembre [1896], il tint une assemblée à Saint-Jean-Port-Joli, avec [Louis-Philippe] Pelletier et [Thomas] Chapais. Et dans une sorte de discours-manifeste, il esquissa le programme de son gouvernement. Le ton était optimiste : “Nos campagnes sont en pleine voie de régénération ; l’instruction agricole se répand ; nos écoles spéciales se peuplent d’élèves. Un redressement s’est opéré depuis le régime Mercier, dont les extravagances avaient ruiné la province. Si les gouvernements conservateurs, celui de M. de Boucherville et celui de M. Taillon, ont emprunté et taxé, c’est pour boucher les trous creusés par le gouvernement Mercier. Ils y ont assez bien réussi ; à la prochaine session, nous pourrons élargir notre politique ferroviaire et abolir la taxe sur les mutations d’immeubles.” Flynn indiquait, d’une manière discrète, mais claire, la rupture avec les principes un peu draconiens de Taillon. Il accordait des concessions jusque dans le domaine de l’enseignement. Sans justifier, certes, les prétentions des radicaux, Flynn reconnaît qu’on a trop poussé la jeunesse canadienne vers les humanités, les études classiques. Il faut d’abord élever le niveau études primaires, en commençant par mieux payer les instituteurs. Puis, au sortir de l’enseignement primaire, diriger un plus grand nombre de jeunes gens vers les écoles d’agriculture. »
Lionel Fortin confirme aussi que « l’année 1896 devait être celle des tournées électorales dans le Québec. En septembre notamment, Marchand se rendit dans la Gaspésie et aux Iles de la Madeleine. Au début d’octobre il était dans la région de Drummondville et à la fin d’octobre au Lac-Saint-Jean. […] À ces tournées qui préparaient les élections de 1897, Marchand ajouta une organisation ou machine électorale, dont il jeta lui-même les bases en convoquant à Montréal, le 28 novembre 1896, ses amis politiques des différents comtés du district de Montréal. Environ 500 partisans répondirent à l’appel du chef de l’opposition. En fait, les libéraux avaient déjà le vent dans les voiles et sentaient que l’élection de Laurier à Ottawa, en juin 1896, annonçait un changement de gouvernement à Québec. Pour résumer la situation, on aurait pu prédire “Rouge à Ottawa, rouge à Québec”. C’est d’ailleurs sur le succès de l’élection fédérale de 1896 que les libéraux provinciaux bâtirent leur campagne. »
Élection québécoise du 11 mai 1897
Le premier ministre Flynn demande la dissolution de la législature le 27 février 1897. L’élection générale aura lieu le 11 mai 1897. L’historien Jean-Louis Roy résume le programme du premier ministre Flynn : « Respect des usages constitutionnels, aide accrue à l’éducation, à l’agriculture, développement et utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, revalorisation du service civil provincial, réorganisation des départements, diminution des taxes, nouvelle répartition des revenus entre le fédéral et le provincial, subsides aux chemins de fer. »
L’historien Jacques Lacoursière relate que Marchand « insiste moins sur son programme que sur la “politique d’expédients et d’opportunisme” de l’ancien gouvernement conservateur. Il s’efforce de projeter l’image d’un Parti conservateur en plein désarroi et toujours empêtré dans le scandale McGreevy. Il se contente surtout de dénoncer la mauvaise gestion financière des conservateurs en soulignant que la dette de la province de Québec est passée de 25 millions en 1892 à 34 millions de dollars en 1897. »
Le livre Les élections au Québec ajoute que « le mot “taxeux” est martelé dans la presse libérale, allusion à la taxe sur les mutations de propriété adoptée en 1892, dont Flynn n’a annoncé la suppression qu’en novembre 1896. La Minerve justifie cette mesure, rendue indispensable par “les folies de Mercier” et “les extravagances du rougisme”. Cette pique contre l’héritage du défunt premier ministre [Mercier] agace La Patrie qui demande à “laisse[r] les morts en paix” et rappelle que “ce que le peuple a à juger en ce moment ce n’est pas le régime Mercier […], mais c’est le régime Flynn.” […] Le thème central des débats demeure cependant les accusations de corruption qui fusent encore de partout. Les conservateurs tentent en effet de ramener à la surface les scandales qui ont entrainé la chute du gouvernement libéral en 1892. Pour eux, “ceux qui tripotaient” alors “sont les mêmes qui sollicitent encore aujourd’hui nos suffrages”. De son côté, la presse libérale enchaîne les histoires impliquant les conservateurs : […]. Même s’il n’est premier ministre que depuis peu, Flynn est pointé du doigt pour son rôle de ministre sous de Boucherville et Taillon : “Ces trois gouvernements, de Boucherville, Taillon et Flynn, n’en font qu’un”. »
La campagne électorale des libéraux est davantage axée sur la figure emblématique de Wilfrid Laurier, premier francophone québécois à devenir premier ministre du Canada moins d’un an avant, que sur le programme du parti. D’ailleurs, le mot d’ordre « Votez pour Marchand contre Flynn » devient « Votez pour Laurier contre Flynn ».
Lionel Fortin spécifie que « la lutte commença bientôt dans le comté. Le premier coup de feu de la campagne fut tiré à Lacolle le vendredi 9 avril 1897. L’assemblée fut tenue dans la salle publique qu’encombrait une foule nombreuse. Marchand y fit à cette occasion un discours où il démontra comment les gouvernements Taillon et Flynn avaient endetté la province malgré leurs promesses et termina en déclarant que son programme pouvait se résumer en un mot : ÉCONOMIE. […] Comme chef de l’opposition, Marchand fut dans l’obligation lors de cette campagne de partager son temps entre son comté et plusieurs comtés du Québec. [Le 26 avril 1897], Marchand se rendait à Montréal en soirée où une grande démonstration eut lieu en son honneur. On évalua à 15 000 personnes le nombre de ceux qui firent escorte au chef de l’opposition et à la députation libérale qui l’accompagnait. Le défilé s’effectua par les rues Notre-Dame, McGill et Saint-Jacques et fut accompagné d’environ 2 000 flambeaux et d’une dizaine de corps de musique. Une magnifique voiture tirée par quatre chevaux dans laquelle avait pris place l’Honorable Marchand [et] le maire Parent de Québec[, futur premier ministre québécois], […] fut saluée par des salves d’applaudissements. L’arrivée au parc Sohmer fut triomphale. »
Selon le livre Les élections au Québec : « Le 28 avril, Flynn et Marchand participent à une assemblée sur la Place du Marché, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les jours qui ont précédé, les deux chefs ont fait courir des foules importantes lors de rassemblements à Montréal. Leur rencontre, deux semaines avant le scrutin, ne semble toutefois pas susciter beaucoup de passion. Malgré le soleil, l’événement n’attirerait qu’environ un millier de personnes. Le Courrier de Saint-Jean parle d’une assemblée “très paisible et très attentive”, ce qu’il faut peut-être attribuer à la personnalité des deux tribuns qui, selon Robert Rumilly, n’ont pas “de dynamisme, de popularité véritable”. »
Le 11 mai 1897, le gouvernement conservateur sortant est défait. Sur les 338 800 électeurs inscrits, seulement 225 179 se présentent voter. Le Parti libéral de Marchand fait élire 51 députés avec 53 % des votes et le Parti conservateur de Flynn, 23 avec 43 % des votes. Dans sa propre circonscription de Gaspé, Flynn gagne par seulement 11 votes. Certains journaux ont même publié à tort qu’il avait perdu. Flynn sera le dernier chef conservateur à occuper la fonction de premier ministre dans l’histoire du Québec. Marchand est quant à lui le premier d’un long règne libéral ininterrompu jusqu’à l’élection de l’unioniste Maurice Duplessis en 1936.
Le journal Le Canada Français du 14 mai 1897 décrit l’ambiance survoltée dans la circonscription de Saint-Jean suite à l’élection du premier premier ministre johannais. « La soirée du 11 mai courant restera longtemps gravée dans le souvenir des bons libéraux de notre ville. Dès sept heures la foule envahissait la salle du Théâtre Royal attendant avec anxiété les bulletins. Montréal nous arriva avec ses cinq divisions libérales. Ce fut une explosion de joie. À huit heures, un télégramme nous apporta la majorité absolue, l’hon. M. Marchand était au pouvoir. Nous renonçons à dire ici la scène qui s’ensuivit. Pendant cinq minutes durant, l’air retentit des cris de victoire qui devaient donner mal aux oreilles des conservateurs abasourdis d’une pareille dégringolade. Quand le calme fut rétabli, l’hon. M. Marchand remercia ses électeurs et avec sa modestie ordinaire reporta sur son comté natal l’honneur qui lui revenait de posséder le premier ministre de la province. Puis ayant annoncé que ses amis de Montréal requéraient sa présence, toute l’assemblée composée d’un millier de personnes le suivirent à sa demeure et au milieu des acclamations et des chants de victoire, dételèrent les chevaux de sa voiture et le traînèrent en triomphe par les rues de notre ville jusqu’à la gare du Grand Tronc où elles l’acclamèrent longuement à son départ. »
CHEF DE L'OPPOSITION

Mosaïque des députés de l'Assemblée législative du Québec. 1892.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe M. A. Montminy

Mosaïque des députés de l'opposition à l'Assemblée législative du Québec. 1894-1895.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe Montminy & Cie

Portrait du premier ministre du Québec Edmund James Flynn.
Collection Dave Turcotte

Boîte de cigares à l'effigie du premier ministre Wilfrid Laurier.
Collection Dave Turcotte


Le gouvernement provincial devant l'opinion. Discours programme prononcé le 6 septembre 1896, à Saint-Jean-Port-Joli par le premier ministre Edmund James Flynn. 1897.
Collection Dave Turcotte
Macaron électoral du premier ministre Edmund James Flynn. 1897.
Prêt d'un collectionneur privé

Lettre circulaire signée par Félix-Gabriel Marchand invitant les libéraux du district de Montréal à une réunion. 21 novembre 1896.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Résultats de l'élection québécoise de 1897 dans la circonscription de Saint-Jean.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Le premier ministre
Le 24 mai 1897 à 16 heures 30, Félix-Gabriel Marchand est assermenté comme 11e premier ministre du Québec. Il est aussi assermenté à titre de secrétaire de la province, mais laissera ce poste deux jours plus tard lors de l’assermentation de son cabinet. Le soir de son assermentation, il assiste au dîner d’État à Spencer-Wood, la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, à l’occasion de la Fête de la Reine Victoria. Le lendemain, il se rend à Montréal où il fait, dans l’avant-midi, une première apparition aux bureaux du gouvernement.
Lionel Fortin raconte que « c’est à Montréal que Marchand forma son Cabinet, non sans affronter certains problèmes d’influence politique. Ces pressions lui venaient de trois groupes distincts. En premier lieu, il y avait les chefs fédéraux, Laurier et [son influant ministre Israël] Tarte, qui voulaient favoriser certains candidats et en éliminer d’autres ; ensuite, venait la haute finance de Montréal et de Québec qui entendait avoir ses porte-paroles au Cabinet. Enfin, quatorze députés provinciaux du Parti libéral exigeaient que quelques-uns d’entre eux soient nommés à des postes-clés sans quoi ils se montreraient hostiles au ministère. Marchand dut faire face à la situation et en chef habile et conciliant, il fit de son gouvernement une synthèse de toutes les tendances ».
Cabinet de Félix-Gabriel Marchand, 11e premier ministre du Québec, le 26 mai 1897 :
Félix-Gabriel Marchand : premier ministre et trésorier
Joseph-Émery Robidoux, secrétaire de la province
Horace Archambeault, procureur général
François-Gilbert Miville-Déchêne, commissaire à l’Agriculture
Simon-Napoléon Parent, commissaire aux Terres, Forêts et Pêcheries
Henry Thomas Duffy, commissaire aux Travaux publics
Adélard Turgeon, commissaire à la Colonisation et aux Mines
James John Guerin, ministre sans portefeuille
George Washington Stephens, ministre sans portefeuille
Joseph Shehyn, ministre sans portefeuille
Alex Temblay Lamarche précise qu’en « 1897, lorsqu’il prend le pouvoir, [Marchand] continu de résister “aux demandes les plus pressantes de ses propres amis” afin de mettre la hache dans les dépenses gouvernementales. Lorsqu’un entrepreneur, ayant appris que Marchand venait de faire installer l’électricité dans sa résidence de la rue Saint-Charles, tente d’acheter ses faveurs en lui envoyant une caisse de lampes et d’appareils électriques, le premier ministre, indigné, les refuse. Marchand continue donc de suivre ses préceptes à la suite de son accession aux plus hautes fonctions politiques de la province. »
Comme le veut la loi électorale de l’époque, les ministres doivent se faire élire de nouveau dans leurs circonscriptions respectives suite à leur assermentation. Sans difficulté, Marchand est réélu sans opposition député de Saint-Jean le 12 juin 1897.
Le 23 novembre 1897 s’ouvre la première session de la neuvième législature du Québec. Dès l’ouverture de la Chambre, Marchand présente la politique qu’il entend mettre en œuvre afin de restaurer les finances publiques. Il soulève également le litige quant aux frontières entre le Québec et l’Ontario et aborde la question de l’instruction publique. Tout comme Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, premier premier ministre du Québec et lui aussi homme de lettres, Marchand souhaite créer un véritable ministère de l’Instruction publique. À cette l’époque, l’éducation est principalement entre les mains du clergé dans la province.
30 ans de vie parlementaire
C’est au moment où le projet de loi sur l’instruction publique est discuté à l’Assemblée que les députés et les citoyens de Québec rendent hommage à Félix-Gabriel Marchand à l’occasion de ses trente ans de vie politique. Un grand bal a lieu à cette occasion, le 27 décembre 1897, à l’Hôtel de Ville de Québec.
Lors de cet événement, Marchand déclare : « À mon entrée dans la vie publique, j’inaugurais avec ma jeune province, une ère nouvelle où tous deux nous apercevions le mirage d’un avenir attrayant qui nous entraînait par le charme de son sourire, plein de brillantes promesses. Nous entreprenions ensemble le grand voyage vers l’inconnu… Nous nous sommes ainsi mis en route, contemplant dans un ravissement juvénile, la brillante perspective qui s’offrait à nos regards. J’aurais voulu continuer longtemps cette joyeuse promenade, mais au premier détour du chemin, mes illusions se sont évanouies comme une vaine fumée. De vieux galants, expérimentés dans l’art des coquetteries diplomatiques, s’étaient présentés, et l’ingrate, cédant à leur galanterie savante, s’était envolée avec eux vers les sommets lumineux, me laissant choir dans les froides régions où gémit cette tribu aussi intéressante qu’incomprise, qui se nomme la “loyale opposition de Sa Majesté”. J’y suis resté longtemps, bien longtemps, sans cependant maudire mon infidèle ; la servant au contraire, avec dévouement, dans l’espoir que ma constance inébranlable serait tôt ou tard appréciée. Mes espérances n’ont pas été vaines ; après de longues années d’attente, j’ai vu mes rivaux disparaître tour à tour par l’effet de violents divorces, et ma longue et patiente sollicitude recevoir enfin sa récompense. […] Vous voulez bien aujourd’hui me féliciter de ce retour de la fortune politique qui, selon vous, est une récompense du devoir accompli, et vous ajoutez que ma modeste carrière parlementaire a été remplie avec honneur et entourée du respect et de l’estime universels. Votre témoignage m’est d’autant plus flatteur que j’aperçois dans cette brillante réunion, des adversaires influents avec lesquels j’ai plus d’une fois rompu une lance dans l’arène parlementaire. Ce concours généreux m’offre une ample récompense de tous les désappointements du passé et un fort encouragement à persévérer dans la voie droite que je me suis tracée au début et que j’ai la prétention de n’avoir jamais abandonnée. »
Instruction publique
Gérard Bergeron rappelle que « le point de départ de cette histoire remonte aussi loin que la fondation même de la Confédération. Il y avait eu le régime d’un ministère de l’instruction publique dès cette date et pendant huit années, jusqu’en 1875. Le premier titulaire, P.-J.-O. Chauveau, avait cumulé ce poste avec la fonction de premier ministre. Les deux autres titulaires étaient également conservateurs et premiers ministres, Gédéon Ouimet et Charles-Eugène Boucher de Boucherville. C’est sous ce dernier que fut supprimé le ministère et rétablie la fonction de surintendant duquel relevait tout le secteur de l’instruction publique. »
Jacques Lacoursière mentionne qu’une « des premières mesures que le premier ministre Marchand, […], voulait mettre de l’avant était le rétablissement d’un ministère de l’Éducation. Ce projet faisait partie du programme de son parti lors des élections. Le Conseil de l’instruction publique conserverait une large domination sur tout ce qui n’est pas l’administration matérielle. Celle-ci serait remise entre les mains d’un ministre. Marchand voulait améliorer la qualité de l’instruction de quatre façons : “1er Création d’un ministère de l’instruction publique ; 2e Uniformité des livres scolaires ; 3e Amélioration du sort des instituteurs ; 4e Répartition plus équitable des subsides alloués aux diverses institutions de la province.” »
« Le recensement de 1891 a révélé que, sur 1 073 815 Québécois âgés de 10 ans et plus, 275 878 ne savent ni lire ni écrire. Le Québec a le triste honneur de posséder un taux d’analphabétisme bien supérieur à celui de l’Ontario ou du Canada en général. Cette situation alarme les hommes politiques soucieux de l’avenir de la nation. » - Livre Canada-Québec, 1534-2015.
Le livre Canada-Québec, 1534-2015 présente ainsi la « saga » de la création du ministère de l’Instruction publique. « Mgr Paul Bruchési, consacré archevêque de Montréal le 8 août 1897, voit d’un très mauvais œil ce projet. Il entend profiter de son séjour à Rome pour inciter les autorités pontificales à prendre position pour le maintien du système en place. Voulant contrer son action, le 19 novembre 1897, Marchand écrit au cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d’État du Vatican. Il lui souligne qu’il y a encore des évêques qui ne cachent pas leur hostilité face au Parti libéral. “Une certaine défiance, écrit-il, éloigne de nous quelques évêques dont nous avons à cœur, dans l’accomplissement consciencieux de nos devoirs publics, de faciliter la mission divine, en contenant l’opinion populaire dans les bornes de l’orthodoxie, sans contrarier ses aspirations vers les progrès utiles et les réformes légitimes.” Le premier ministre suggère “l’envoi d’un délégué qui prolongerait son séjour dans notre pays, assez longtemps pour y établir des rapports amicaux entre le Gouvernement et l’Épiscopat. Lui seul pourrait mettre fin au malaise et produire entre les représentants des deux pouvoirs la confiance mutuelle si désirable”.
À Rome, Bruchési frappe à toutes les portes dans l’espoir d’empêcher l’établissement d’un ministère de l’Éducation. Le 22 novembre, il expédie au premier ministre le télégramme suivant : “Pape vous demande surseoir pour bill instruction publique. Lettre partie aujourd’hui par ordre.” Le lendemain, le texte du discours du Trône contenait l’annonce du projet de loi. Le lieutenant-gouverneur Joseph-Adolphe Chapleau, qui avait reçu lui aussi le texte du télégramme de Bruchési, sent le besoin de répondre à ce dernier en lui rappelant la bonne volonté du gouvernement. Il souligne que le gouvernement peut difficilement rejeter son projet et, s’il le faisait, de graves conséquences pourraient en découler.
[…]
Le 7 décembre, Marchand reçoit la lettre écrite par Bruchési le 22 du mois précédent. Cette dernière semblait confirmer la volonté du pape de voir le projet de loi retiré. Quelques ministres manifestent alors leur volonté de démissionner si on se soumet aux pressions romaines. Le premier ministre lui-même considère qu’il ne pourra plus diriger le gouvernement. Toujours le 7, il fait part des réactions au lieutenant-gouverneur : “Permettez-moi de vous déclarer que l’abandon de notre loi scolaire, dans les circonstances actuelles, provoquerait une agitation profonde dans la population de cette province, entraînerait la démission de plusieurs membres du Cabinet et produirait des conséquences si graves que je ne puis en prendre la responsabilité.” Chapleau télégraphie immédiatement au cardinal Rampolla pour lui dire que, si la demande du pape constitue un ordre formel pour le premier ministre, ce dernier, comme catholique, sera obligé de démissionner de son poste.
Le 11, le cardinal Rampolla expédie à Chapleau un câblogramme qui précise que “le Saint-Père a voulu exprimer désir d’éviter toute innovation qui pût troubler la paix et les bons rapports entre l’Église et l’État. Il n’a pas eu l’intention d’exercer de telles pressions qui puissent amener ministre à donner démission.” Rome est vraiment ennuyé par toute cette affaire et on se rend compte que Bruchési a peut-être exagéré autant la situation que la volonté du pape. Le 17 décembre 1897, le cardinal Rafaelo Merry del Val, dans une lettre à Chapleau, formule un certain blâme sur la conduite de l’archevêque de Montréal. “J’ai eu connaissance de la lettre et de la dépêche de Sa Grandeur Mgr Bruchési, quand elles étaient déjà lancées, écrit-il, et j’avoue que cette manière d’interpréter la pensée du Saint-Père m’a paru bien étrange. Faut-il l’attribuer à un manque de connaissances suffisantes du système du gouvernement dans les provinces de la Confédération ou à un défaut d’appréciation des conditions locales des hommes et des choses ? Je ne sais.”
L’Assemblée législative passa à l’étude du projet de loi qui fut approuvé, le 5 janvier 1898 par 44 voix contre 19. Le même jour, Bruchési, appuyé par Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, et par Joseph-Thomas Duhamel, archevêque d’Ottawa, renouvela sa demande de retirer le projet de loi. Ce que refusa à nouveau Marchand. Le projet de loi devait recevoir l’approbation du Conseil législatif à majorité conservatrice. Le 10 janvier, les conseillers rejetèrent le projet par 13 voix contre 9. Au mois de mars 1900, Marchand propose à l’Assemblée d’adopter une motion pour abolir le Conseil législatif. Les députés votèrent majoritairement en sa faveur. Mais, c’était à prévoir, les conseillers législatifs rejetèrent le projet par 17 voix contre 6. »
Dans les mois suivants, le premier ministre canadien Wilfrid Laurier intervient discrètement. Il souhaite réconcilier les évêques et le Parti libéral, qui est aussi son parti. Un compromis est trouvé. Certaines réformes se feront, mais le projet de ministère est abandonné. Le gouvernement Marchand est souvent associé à l’expression « Révolution tranquille Marchand », car il faudra attendre la Révolution tranquille pour que le gouvernement libéral de Jean Lesage crée enfin un ministère de l’Éducation au Québec en 1964 et en 1968, pour que le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand puisse réussir à abolir le Conseil législatif.
Trésorier provincial
À titre de « ministre des finances », Marchand souhaite corriger rapidement la situation catastrophique des finances publiques du Québec. Rendant sa tâche plus complexe, Marchand découvre après son élection, un déficit de 946 908 $ sur un budget d’environ trois millions de dollars, laissé par le précédent gouvernement conservateur.
Gérard Bergeron présente la situation ainsi : « la question de la dette publique se situait au tout premier rang de la gravité et de l’urgence. Une nouvelle philosophie des finances publiques s’imposait : au lieu d’augmentations fiscales et d’une multiplication des emprunts, tabler surtout sur des économies de dépenses, des restrictions budgétaires et, surtout, provoquer une forte augmentation des revenus publics. Le notaire de petite ville sut démontrer qu’il savait faire usage de gants de fer. »
Alex Tremblay Lamarche explique comment Marchand s’y prend concrètement : « il entend réduire les dépenses de chaque ministère. Puisque les fonds qui sont mis à la disposition de chacun sont fort minces, Marchand accepte d’ouvrir un crédit supplémentaire “sous forme de contingents” pour pallier les dépenses imprévues, mais il constate rapidement que ces montants additionnels sont utilisés dès les premiers mois et qu’il lui faut émettre des mandats spéciaux au cours de l’année. Il ordonne donc au comptable de l’Assemblée de “ne payer qu’un douzième, chaque mois, de la somme votée sous ce titre anglais de ‘contingents’” afin que ses ministres se soumettent à la rigueur budgétaire. Il laisse d’ailleurs le souvenir d’un chef ayant prôné tout au long de sa vie “l’importance des petites économies dans les budgets publics”. »
Lionel Fortin ajoute que « le gouvernement Marchand connut plus de succès en matière financière. En 1896-1897, le gouvernement conservateur de Flynn laissait un déficit de près d’un million de dollars. L’Honorable Marchand, après deux ans d’administration habile et ferme, faisait disparaître ce passif et annonçait en 1899 un surplus sur les dépenses ordinaires de 22 556,22 $. Face à ce succès, les journaux, tant du Québec que de l’Ontario et même de Londres, ne ménagèrent pas les éloges à l’égard de Marchand. Dans le comté de Saint-Jean, on lui fit même une grande fête, à l’Ile-aux-Noix, le 9 septembre 1899. »
Le journal Le Canada Français du 15 septembre 1899 écrit : « L’Île-aux-Noix, ce lieu si pittoresque et si achalandé des touristes, a été le théâtre, samedi dernier, d’une sympathique démonstration et d’une chaude réception faite à notre distingué député et au chef vénéré des libéraux, l’honorable F.G. Marchand. C’est en effet cet endroit si fertile en souvenirs historiques et sur lequel la nature s’est plus à déverser les charmes les plus attrayants que le Club National avait choisi comme rendez-vous des citoyens désireux de rendre hommage à celui qui, par une sage et fidèle administration, vient d’inaugurer pour la province, l’ère des surplus. Environ 250 excursionnistes nous arrivaient donc, samedi à 10 h, venant de Montréal et d’ailleurs, et s’embarquaient bientôt sur le Majestic pour se rendre à l’Île. Au départ, une salve de coups de canon fut tirée en l’honneur du héros de la fête et tout le temps du voyage, notre magnifique fanfare égaya les voyageurs enthousiasmés du beau panorama qui se déroulait sous leurs yeux. Vers 13 h, le bateau accostait le quai de l’Île-aux-Noix où plusieurs cultivateurs des environs s’étaient déjà rendus pour saluer le premier ministre de la province de Québec. On marcha aussitôt vers le fort, lieu du rendez-vous, où un lunch fut servi. Puis on fit une visite détaillée de la forteresse, cette relique historique qui a été d’un si grand secours à la flotte anglaise en 1812. Enfin, vers 14 h et demie, la foule se réunit au pied du terrassement, autour de l’honorable M. Marchand et de sir Henri Joly de Lotbinière son ancien collègue et son ami intime, de l’Hon. Horace Archambault, procureur général, de l’honorable T. Duffy, commissaire des travaux publics, de l’honorable sénateur Dandurand et d’une vingtaine de députés arrivés par le train du matin pour prendre part à la démonstration. »
Bilan du gouvernement Marchand
Le 18 janvier 1900, lors de l’ouverture de la troisième session de la neuvième législature, le discours du trône esquisse un bilan des réalisations du gouvernement Marchand. Voici quelques extraits :
« L’éducation de la jeunesse a été l’objet de son attention toute spéciale. Il a augmenté l’aide accordée aux municipalités pauvres et aux écoles du soir ; il a subventionné pour les élèves institutrices une école normale qui vient d’être fondée à Montréal ; l’œuvre des livres gratuits pour les écoles primaires se poursuit et sera bientôt inaugurée par la distribution d’une excellente carte géographique de notre province à toutes les écoles, dans les municipalités qui voudront en bénéficier. […] Afin d’activer la colonisation dans notre province, mon gouvernement a apporté le plus grand soin à l’ouverture de chemins nouveaux dans les régions colonisables, et de nombreux colons en ont profité pour y rechercher des établissements. L’agriculture a aussi reçu sa large part d’encouragement de mon gouvernement qui, notamment, s’est occupé de la propagation des meilleures espèces d’arbres fruitiers, des perfectionnements des qualités du beurre et du fromage, et de l’amélioration des chemins publics dans les différentes municipalités. […] Mon gouvernement s’est particulièrement préoccupé de la protection et de la mise à profit de nos immenses régions forestières, ainsi que de nos superbes pouvoirs d’eau et de nos ressources minières. Grâce à son concours, des industries nouvelles et nombreuses continuent à s’établir dans des régions jusqu’à ces derniers temps inhabitées, où des centres manufacturiers et populeux surgissent. Le bois de pulpe a pris, depuis quelques années, une telle importance, au point de vue de la prospérité de notre population et du revenu public, que mon gouvernement a cru devoir en augmenter l’exploitation dans le pays au bénéfice de notre population industrielle et ouvrière. »
Alex Tremblay Lamarche précise que « Simon-Napoléon Parent, commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries suspend la vente des chutes de Shawinigan. Il juge le prix de base fixé par le gouvernement précédent beaucoup trop bas et reporte la vente en haussant le prix de base. Ce faisant, il écarte les investisseurs locaux qui tentaient depuis quelques années de se porter acquéreurs des lieux et c’est un groupe de riches hommes d’affaires anglophones qui réussit à acquérir les chutes en septembre 1897. Parent pose toutefois des conditions afin de favoriser le développement de la région, notamment un aménagement hydroélectrique et un investissement en travaux dans des délais de 30 mois ou moins. Shawinigan voit ainsi le jour grâce à l’essor industriel qui prend son envol sous le gouvernement de Marchand, tout comme Chicoutimi et Grand-Mère. Marchand ne souhaite en effet pas seulement engranger des profits en vendant les ressources naturelles de la province à des capitaux en grande partie étrangers, il désire aussi attirer des investisseurs au Québec et créer des emplois pour une population partant de plus en plus vers les États-Unis, faute d’opportunités au Québec. »
Alex Tremblay Lamarche ajoute que « Marchand a connaissance du potentiel dont recèle le territoire québécois. Il sait le nord de la province riche en minéraux et en rivières aptes à produire de l’électricité. Il poursuit donc le travail engagé par ses prédécesseurs et, sous son règne, le Québec fait l’acquisition d’une part significative du domaine de Rupert. Mieux, il travaille de concert avec Laurier pour que le gouvernement fédéral reconnaisse officiellement ces nouvelles frontières. Le 13 juin 1898, Ottawa sanctionne que le territoire de l’Abitibi et les terres qui s’étendent au sud de la rivière Eastmain jusqu’à la baie James font officiellement partie du Québec. »
Lionel Fortin raconte qu’afin « d’amener les Américains à investir chez nous, le premier ministre Marchand se rendait à New York en avril 1900 pour y rencontrer capitalistes et financiers intéressés à l’industrie du bois de pulpe. […] Cette expédition à New York fut l’un des derniers actes que posa Marchand à titre de premier ministre du Québec, avant qu’il ne soit forcé par la maladie à s’immobiliser en mai 1900. À cette date, on pouvait déjà affirmer que Marchand avait accompli la tâche colossale qu’il s’était tracée à son arrivée au pouvoir. Grâce à un régime d’économie, il avait réussi à équilibrer le budget de la province en un peu moins de deux ans. De même, par ses réformes dans plusieurs domaines, il avait su corriger les injustices du passé. Enfin, par le biais des politiques financières clairvoyantes de son gouvernement, il avait ouvert les voies au développement industriel de la pâte et papier et à l’exploitation de notre pouvoir hydraulique et de nos richesses naturelles. Cependant, ce travail extraordinaire avait usé la santé pourtant robuste de cet homme. Il ne devait pas s’en relever. »
PREMIER MINISTRE


Portraits des premiers ministres du Québec Edmund James Flynn et Félix-Gabriel Marchand. Galerie nationale : Les gouverneurs et les premiers ministres de Québec 1867-1920.
Collection Alain Lavigne


Macarons des premiers ministres du Québec Edmund James Flynn et Félix-Gabriel Marchand. Production Le macaronier. Vers 1980.
Collection Dave Turcotte



Revue de presse sur l'élection du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 25 mai 1897, 26 mai 1997 et 3 juin 1897.
Journal Le Soleil

Mosaïque du cabinet du premier ministre du Canada Sir Wilfrid Laurier du 23 juin 1896
et du cabinet du premier ministre du Québec Félix-Gabriel Marchand du 11 mai 1897.
Collection Dave Turcotte

Mosaïque du cabinet du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. 27 novembre 1897.
Journal Le Monde illustré

Diagramme des sièges des députés à l'Assemblée législative du Québec. 1897.
Collection Lionel Fortin

Adresse honorifique des citoyens de Québec à Félix-Gabriel Marchand à l'occasion du 30e anniversaire de son entrée dans la vie publique comme membre de l'Assemblée Législative, notamment signée par Simon-Napoléon Parent, maire de Québec et son successeur comme 12e premier ministre du Québec. 27 décembre 1897.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Tube portant l'adresse des citoyens de Québec à Félix-Gabriel Marchand à l'occasion du 30e anniversaire de son entrée dans la vie publique. 27 décembre 1897.
Collection Dave Turcotte

Huile sur toile de l'artiste Joseph-Charles Franchère remise à Félix-Gabriel Marchand pour souligner ses 30 ans de vie parlementaire. 1897.
Musée du Haut-Richelieu
Photographe Émilie Gaudreault
Revue de presse des célébrations du 30e anniversaire de vie politique du député Félix-Gabriel Marchand. Journal La Presse. 27 décembre 1897.
Journal La Presse
Revue de presse des célébrations du 30e anniversaire de vie politique du député Félix-Gabriel Marchand. Journal La Presse. 28 décembre 1897.
Journal La Presse
Revue de presse des célébrations du 30e anniversaire de vie politique du député Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 28 décembre 1897.
Journal Le Soleil




Menu du banquet offert à Félix-Gabriel Marchand par le Club Letellier à Montréal. 26 janvier 1898.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec



Discours de Félix-Gabriel Marchand prononcé à l'Assemblée Législative sur la loi de l'Instruction publique. 28 décembre 1897.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Revue de presse suite au discours sur le budget du trésorier Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 7 février 1899.
Journal Le Soleil

Discours sur le budget prononcé par Félix-Gabriel Marchand à l'Assemblée Législative. 24 janvier 1900.
Collection Dave Turcotte
Don d'Alain Lavigne
Revue de presse suite au discours sur le budget du trésorier Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 25 janvier 1900.
Journal Le Soleil

Caricature du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. C. Shaw & Co. Vers 1900.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Vir probus
Au printemps 1900, après avoir prononcé un discours présentant un projet de loi pour abolir le Conseil législatif, Marchand est indisposé et doit quitter la chambre. Lionel Fortin relate ainsi ses derniers mois. « Miné par l’artériosclérose depuis le début de la session parlementaire de 1900, l’Honorable Marchand était obligé, en mai 1900, de cesser toute activité. Il se retira alors en repos à la résidence de son fils, Gabriel Marchand, rue Saint-Charles, à Saint-Jean, où il demeura quelques mois. Le lieutenant-gouverneur du Québec, Sir Louis-Amable Jetté, vint en personne lui rendre visite à Saint-Jean, le 7 août 1900, durant sa convalescence, en compagnie de Rodolphe Lemieux, député fédéral de Gaspé, et d’Honoré Gervais, avocat de Montréal. Cependant, à la fin d’août 1900 [Marchand] reprenait le travail ».
Lionel Fortin ajoute : « Mais à peine de retour au poste, une rechute soudaine le forçait définitivement à garder le lit. Toutefois, ne voulant pas s’éloigner de Québec, il s’installa pour lors chez son gendre le Docteur Arthur Simard, au 25, rue Sainte-Ursule, où il fut sous les soins assidus du Docteur Simard et de ses collègues, les Docteurs Brochu, Rousseau et Fortier. C’est à la résidence du Docteur Simard que l’Honorable Félix-Gabriel Marchand décéda le mardi 25 septembre 1900 à 7 heures 45 du soir. Il était âgé de 68 ans et 8 mois. Il avait à son chevet, son épouse, sa belle-fille Madame Gabriel Marchand, ses quatre filles Mesdames Legendre, Grenier, Simard et Larocque, ses gendres Messieurs Legendre, Grenier et Simard, Madame Adélard Turgeon, épouse du ministre de la Colonisation, Monsieur Vachon, son secrétaire privé et le Révérend Père Jésuite Louis Garceau, qui avait également assisté Honoré Mercier dans ses derniers moments. En mourant, Marchand laissa tout juste à sa veuve une police d’assurance-vie et quelques biens qui la mettaient à l’abri des besoins de l’existence. En fait, il mourut pauvre, beaucoup plus pauvre que quand ses électeurs du comté de Saint-Jean l’avaient envoyé, pour la première fois, siéger à l’Assemblée législative de Québec. »
Félix-Gabriel Marchand est le premier premier ministre du Québec à mourir en fonction. Grand homme politique respecté de tous, le Québec tout entier est en deuil le jour de sa mort. Le gouvernement du Québec lui offre des funérailles d’État grandioses.
Lionel Fortin raconte que « le corps de l’Honorable Marchand fut d’abord exposé à la résidence du Docteur Simard, rue Sainte-Ursule, jusqu’au 27 septembre 1900 à 6 heures du soir. Puis les restes mortels étaient transportés le lendemain à la salle de l’Assemblée législative où, dès 9 heures du matin, la foule défila sans interruption, de jour comme de nuit, jusqu’à l’heure des funérailles. Le 29 septembre 1900, jour des funérailles, bien avant l’heure fixée pour le départ du cortège funèbre, une foule considérable d’environ 50 000 personnes encombrait les abords du Parlement et les hauteurs avoisinantes. À 9 heures 30 précises, les porteurs : Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada ; Sir Henri Joly de Lotbinière, lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique [et ex-premier ministre du Québec] ; l’Honorable Israël Tarte, député fédéral de Saint-Jean-lberville ; l’Honorable Simon-Napoléon Parent, ministre dans le cabinet Marchand et maire de Québec[, celui qui va succéder au premier ministre Marchand] ; l’Honorable Edmund-James Flynn, chef de l’opposition à l’Assemblée législative de Québec [et ex-premier ministre du Québec] ; M. Louis Molleur, ancien député d’Iberville, président de la Banque de Saint-Jean ; M. James O’Cain, président de l’Association libérale de Saint-Jean ; l’Honorable George Washington Stephens, ministre dans le cabinet Marchand, enlevaient le cercueil de son lit de parade dans la salle de l’Assemblée législative et le déposaient dans un corbillard tiré par six chevaux superbement harnachés. »
Lionel Fortin souligne qu’environ « cinq mille personnes ayant à leur tête des membres de la famille et des personnalités éminentes formèrent le cortège qui défila lentement et majestueusement jusqu’à la Basilique de Québec où devait avoir lieu le service funèbre. Tout le long du parcours qui dura près d’une heure, les fanfares jouèrent des airs funèbres tandis que le carillon de la Basilique sonnait le glas. Dans chaque rue, l’on pouvait voir des drapeaux en berne, et des édifices publics, des magasins et des résidences privées ornés de tentures de deuil. Ce spectacle si émouvant, qui ne devait pas s’effacer de sitôt de la mémoire de ceux qui en avaient été les témoins, n’offrait rien de comparable. À vrai dire, les funérailles de Marchand devaient dépasser en pompes mêmes celles de Cartier, de Chapleau et de Mercier, et devenir l’apothéose de cet homme qui fut de son vivant l’incarnation de la bonté, de la droiture et de l’honneur. »
Jean-Claude Germain rappelle que « lors du service funèbre chanté à la Basilique Notre-Dame de Québec par l’archevêque de la Vieille Capitale, Monseigneur L -N. Bégin, ce fut l’archevêque de Montréal, Monseigneur Paul Bruchési, qui prononça l’oraison funèbre, le même Bruchési, d’ailleurs, qui trois ans auparavant, avait soumis Marchand à un chantage odieux et n’avait pas hésité d’aller jusqu’à invoquer une fausse lettre du Pape pour l’obliger de sursoir à son projet de créer un ministère de l’Instruction publique. “L’éloge de l’homme d’État qui vient de mourir, dit alors Monseigneur Bruchési en commençant son homélie, est déjà fait par le peuple de notre province, par ses partisans et ses adversaires. D’un mot, il caractérise sa vie. Cet éloge, vous l’avez entendu dans les cercles intimes du foyer et dans les réunions publiques ; vous l’avez entendu dans la presse protestante comme dans la presse catholique, et il m’est permis de le répéter dans ce temple : Monsieur Marchand était un parfait honnête homme !” »
Cependant, cette oraison funèbre ne fut pas bien accueillie de tous. Selon Gérard Bergeron, elle créa « une ambiance regrettable sur l’événement. […] Pour faire court, écoutons encore Robert Rumilly : “Le jeune archevêque n’avait pas oublié le projet du ministère de l’Instruction publique […]. Il glissa dans l’éloge de Marchand des réserves sur certains projets, sur certaines mesures… ‘Cela n’empêche pas, reconnut l’archevêque, que ses intentions étaient droites et qu’il n’ait eu recours qu’à des moyens honorables.’ Madame Marchand empêcha son gendre, Dandurand, de faire un éclat. Le jeune sénateur repartit, furieux, pour Montréal, n’admettant pas qu’on garnisse ‘d’épines la couronne mortuaire de Marchand”. »
Après le service, une longue procession suivit la dépouille mortelle de Marchand au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec, où il est inhumé. Le monument funéraire est orné d’une plaque de bronze où se découpe la tête en profil de l’illustre défunt et porte les inscriptions « Vir probus », « Félix Gabriel Marchand 1832-1900 premier ministre du Québec 1897-1900 ».
Alex Tremblay Lamarche précise qu’il « en aurait probablement été autrement s’il n’en avait été que du désir des citoyens de Saint-Jean puisque plusieurs souhaitaient voir leur député inhumé en leur ville, mais les circonstances imposent une sépulture dans la capitale. Le choix du cimetière est réfléchi. Notre-Dame-de-Belmont est à l’époque le lieu de sépulture des personnalités politiques, littéraires et économiques les plus en vue de la capitale. On y compte déjà plusieurs maires (René-Édouard Caron, Ulric-Joseph Tessier, etc.), quelques-uns des artistes les plus influents du milieu du XIXe siècle (Théophile Hamel, Antoine Dessane, etc.) et quelques hommes de lettres bien connus (François-Xavier Garneau, Henri Faucher de Saint-Maurice, etc.). Il n’est donc pas surprenant qu’on opte pour ce cimetière et qu’on y choisisse un emplacement particulièrement bien situé pour offrir au défunt un dernier repos digne de ce nom. »
Alex Tremblay Lamarche spécifie qu’il « faut toutefois attendre 1905 avant qu’un monument funéraire ne soit érigé sur le lot. La stèle de granit gris clair est commandée par le sénateur Raoul Dandurand, gendre du défunt, et quelques amis. C’est le sculpteur Louis-Philippe Hébert qui hérite du contrat. Le choix d’Hébert n’est pas anodin : il est au début du XXe siècle celui vers qui les pouvoirs publics et les élites se tournent le plus fréquemment pour réaliser des monuments commémoratifs à la gloire de personnages historiques (Charles-Michel de Salaberry, George-Étienne Cartier, Paul Chomedey de Maisonneuve, etc.) ou de défunts qu’on souhaite porter aux nues. Dans une entrevue donnée à La Patrie, Hébert confie que la tombe se veut tant un hommage à l’homme “de grande culture intellectuelle” qu’était Marchand qu’au poète en lui. Hébert a incrusté dans la pierre un médaillon de bronze représentant Marchand de profil qu’il a surmonté de l’inscription “Vir Probus” qu’on peut traduire par “homme honnête”. »
Alex Tremblay Lamarche explique que « cette épitaphe, qu’on peut traduire par homme honnête ou honnête homme, peut autant être comprise comme une référence au caractère intègre de Marchand qu’à ses allures de gentilhomme. L’ambiguïté est intéressante puisque la figure de l’homme honnête qu’il incarne n’est pas incompatible avec cette idée d’homme intègre pourfendant corruption et patronage. Ses contemporains et les journaux de son temps sont d’ailleurs nombreux à souligner ses manières recherchées, son exquise politesse et sa prestance. Il impose le respect. S’il compte des adversaires politiques, on ne lui connaît pas d’ennemis et tous s’entendent pour reconnaître son caractère supérieur. Même en son absence, lorsqu’on parle de lui, on ne peut s’empêcher de le faire avec considération ».
Alex Tremblay Lamarche mentionne que « l’aisance avec laquelle il s’exprime est aussi un signe du milieu dont il est issu. Dans les grandes familles, on cultive le beau et on recherche les effets dramatiques dans ses conversations. “Avoir de l’esprit”’, c’est être capable de mener une conversation spirituelle tout en y glissant ici et là quelques jeux de mots et plaisanteries. Félix-Gabriel Marchand en est conscient et n’hésite pas à glisser un calembour à l’occasion sans en abuser. Cela lui permet de faire mouche à tout coup lorsqu’il est attaqué sur la scène politique. La Presse rapporte d’ailleurs que “son éloquence disserte” lui a valu d’être surnommé le “rossignol du parlement” par ses compatriotes. En plus de clouer le bec avec élégance à ses adversaires, l’éloquence qu’il déploie en Chambre et en campagne électorale renforce sa réputation de gentilhomme auprès de ses pairs. »
VIR PROBUS




Pressentant sa mort prochaine, Marchand s'adresse à ses électeurs de Saint-Jean pour les remercier de leur appui soutenu et leur demander d'appuyer Laurier lors de la campagne électorale fédérale, de même que son successeur à la barre du gouvernement provincial
Lettre de Félix-Gabriel Marchand aux amis de Saint-Jean quelques jours avant sa mort. 20 septembre 1900.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Photographie de Félix-Gabriel Marchand et sa famille sur la rue Ste-Ursule à Québec peu de temps avant sa mort. 1900.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Photographies de la résidence située au 25 de la rue Ste-Ursule, à Québec, où est décédé le premier ministre Félix-Gabriel Marchand. 2022.
Collection Dave Turcotte

Dessin de la résidence du Dr Arthur Simard, gendre de Félix-Gabriel Marchand, située au 25 de la rue Sainte-Ursule, à Québec, où est décédé le premier ministre. Journal Le Soleil. 29 septembre 1900.
Collection Lionel Fortin

Dessin illustrant les milliers de citoyens venus rendre un dernier hommage à Félix-Gabriel Marchand devant le Parlement. Journal Le Soleil. 29 septembre 1900.
Collection Lionel Fortin

Dessin de Félix-Gabriel Marchand exposé en chapelle ardente dans la salle de l'Assemblée législative du Québec. Journal Le Soleil. 29 septembre 1900.
Collection Lionel Fortin

Photographie du Parlement de Québec orné de tentures de deuil suite au décès du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. 28 septembre 1900.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Fonds Lucien Lemieux


Photographies illustrant les milliers de citoyens rendant un dernier hommage à Félix-Gabriel Marchand devant le Parlement. 28 septembre 1900.
Archives de la Ville de Québec

Photographie du cortège funèbre de Félix-Gabriel Marchand quittant le Parlement. 28 septembre 1900.
Archives de la Ville de Québec



Photographies du cortège lors des funérailles d'État du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. 28 septembre 1900.
Archives de la Ville de Québec
Fonds Louis Lachance

Photographie représentant un char du cortège, devant l'Hôtel de Ville de Québec, pour les funérailles de Félix-Gabriel Marchand. 28 septembre 1900.
Archives de la Ville de Québec

Photographie représentant l'arrivée du cortège à la basilique Notre-Dame-de-Québec pour les funérailles de Félix-Gabriel Marchand. 28 septembre 1900.
Archives de la Ville de Québec

Photographie de la basilique Notre-Dame-de-Québec, lors des funérailles d'État de Félix-Gabriel Marchand. 28 septembre 1900.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Fonds Lucien Lemieux

Lieu de sépulture du premier ministre Félix-Gabriel Marchand au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Québec. 1975.
Collection Lionel Fortin


Lieu de sépulture du premier ministre Félix-Gabriel Marchand et de membres de sa famille au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Québec. 2021.
Collection Dave Turcotte
Modèle 3D du lieu de sépulture du premier ministre Félix-Gabriel Marchand au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Québec. 2014
Création Charles-Olivier Roy

Plâtre de l'artiste Louis-Philippe Hébert servant pour la stèle funéraire du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. 1905 ou avant.
Musée national des beaux-arts du Québec
Don de Martine Brault-Genest
Photographe Patrick Altman
Revue de presse de l'annonce du décès du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 26 septembre 1900.
Journal Le Soleil
Revue de presse des funérailles d'État du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 27 septembre 1900.
Journal Le Soleil
Revue de presse des funérailles d'État du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 28 septembre 1900.
Journal Le Soleil
Revue de presse des funérailles d'État du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 29 septembre 1900.
Journal Le Soleil
Revue de presse des funérailles d'État du premier ministre Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Soleil. 2 octobre 1900.
Journal Le Soleil


Portraits des premiers ministres du Québec Félix-Gabriel Marchand et Simon-Napoléon Parent.
Collection Dave Turcotte

Simon-Napoléon Parent est conseiller municipal du quartier Saint-Vallier au conseil municipal de Québec de 1890 à 1894, maire suppléant en 1892, puis maire du 2 avril 1894 au 12 janvier 1906. Il est élu député libéral dans Saint-Sauveur en 1890. Il est réélu sans opposition en 1892, en 1897, et, sans opposition, en 1900 et en 1904. Il est nommé commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries dans le cabinet Marchand du 26 mai 1897 au 3 octobre 1900. Suite au décès de Félix-Gabriel Marchand, il devient premier ministre du 3 octobre 1900 au 21 mars 1905. Au sein de son propre cabinet, il est commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries du 3 octobre 1900 au 2 juillet 1901 et commissaire des Terres, Mines et Pêcheries du 2 juillet 1901 au 23 mars 1905 ainsi que trésorier intérimaire du 8 juillet au 6 octobre 1903. Il démissionne à titre de premier ministre le 21 mars 1905, à la suite d'une fronde de trois de ses ministres : Lomer Gouin (celui qui va lui succéder comme premier ministre), Adélard Turgeon et William Alexander Weir. Il démissionne de son siège de député le 5 septembre 1905.
Discours du premier ministre Simon-Napoléon Parent sur la question des droits de coupe sur le bois à pulpe prononcé à l'Assemblée législative de Québec. Ce document est offert avec les compliments de Cyrille Fraser Delâge. 25 avril 1903.
Collection Dave Turcotte
Je me souviens
Lieux de mémoire
Découvrez « virtuellement » les régions du Québec à travers la vie de nos premiers ministres. Cette carte interactive vous fera découvrir où ils sont nés, où ils ont habités, étudiés, travaillés ainsi qu’où ils sont décédés et enterrés. Elle indique aussi les quelques musées à visiter, les monuments en leur honneur ainsi que les lieux rappelant leur mémoire par la toponymie. Cette carte est loin d’être exhaustive. Elle sera toujours en développement.
Légende de la carte interactive

JE ME SOUVIENS

Photographies de panneaux de voies de communication et de lieux rendant hommage au premier ministre Félix-Gabriel Marchand.
Collection Dave Turcotte


Série de timbres à l'effigie de ponts couverts patrimoniaux dont le pont Félix-Gabriel Marchand situé à Mansfield-et-Pontefract. Postes Canada. 17 juin 2019.
Collection Dave Turcotte


Photographies de l'inauguration du pont Félix-Gabriel Marchand situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Journal Le Canada Français. 28 février 1966.
Musée du Haut-Richelieu
Collection Journal Le Canada Français
Photographe Ken Wallett

Œuvre illustrant un œil de douze personnages qui ont marqué l'histoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu installée sur le mur arrière du palais de justice dans le parc Félix-Gabriel Marchand. L'œil de Marchand se situe dans la troisième colonne, l'œil du milieu.
Photographie de l'œuvre Premiers regards de l'artiste Michel Goulet. Technique mixte, acier inoxydable, 1994.
Photographe Émilie Gaudreault

Félix-Gabriel Marchand figure sur l'énorme banc long de 200 pieds dans le parc des Éclusiers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Photographie d'une section de l'œuvre Ligne du temps évoquant l'histoire de la navigation sur la rivière Richelieu de l'artiste Pascale Hébert. Métal découpé, 2018.
Collection Dave Turcotte

Œuvre monumentale de 20 x 80 pieds avec effet 3D représentant des faits et figures marquants de l’histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu dont Félix-Gabriel Marchand. Elle est située dans le parc Gerry-Boulet de la ville.
Photographie de l'œuvre 1666 – 2016 de l'artiste Mika et de la muraliste Joëlle Thébault. 2016.
Collection Dave Turcotte

Publicité du 5 à 7 hommage à Félix-Gabriel Marchand dans le cadre de la campagne de financement pour la création du monument à la mémoire de l'ancien premier ministre. Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. 2016.
Collection Dave Turcotte

Maquette du monument de Félix-Gabriel Marchand réalisée par le sculpteur Roger Langevin. 2016.
Collection Dave Turcotte
Photographe Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Installation du monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand par le sculteur Roger Langevin et son équipe. 2016.
Collection Dave Turcotte
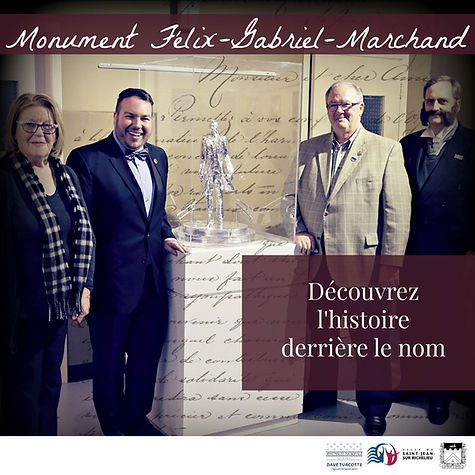

Nicole Poulin, présidente de la Société d'histoire du Haut-Richelieu, Dave Turcotte, députée de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec, Michel Fecteau, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Félix-Gabriel Marchand (François Lafrenière, comédien).
Carrés-web sur le monument de Félix-Gabriel Marchand. 2016.
Collection Dave Turcotte

Invitation à l'inauguration du monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand. 2016.
Collection Dave Turcotte



Nicole Poulin, présidente de la Société d'histoire du Haut-Richelieu, Dave Turcotte, députée de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec, Michel Fecteau, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Roger Langevin, sculpteur de l'œuvre.
Inauguration du monument de Félix-Gabriel Marchand réalisé par le sculpteur Roger Langevin. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 25 septembre 2016.
Collection Dave Turcotte
Photographies du monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand réalisé par le sculpteur Roger Langevin. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 2016.
Collection Dave Turcotte
Cahier spécial sur le monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand. Journal Le Canada Français. 27 octobre 2016.
Collection Dave Turcotte




Série de cartes postales et de capsules sur Félix-Gabriel Marchand et sa fille Joséphine. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 2013.
Collection Dave Turcotte

Livre Félix-Gabriel Marchand de l'auteur Lionel Fortin. Éditions Mille Roches. 1979.
Collection Dave Turcotte

Catalogue de l'exposition Félix-Gabriel Marchand : l'histoire derrière l'homme présenté par le Musée du Haut-Richelieu, en collaboration avec Dave Turcotte, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Musée du Haut-Richelieu. 2016.
Collection Dave Turcotte

Carton promotionnel de l'exposition Félix-Gabriel Marchand : l'histoire derrière l'homme présenté par le Musée du Haut-Richelieu, en collaboration avec Dave Turcotte, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Musée du Haut-Richelieu. 2016.
Collection Dave Turcotte



Photographies de l'exposition Félix-Gabriel Marchand : l'histoire derrière l'homme présenté par le Musée du Haut-Richelieu, en collaboration avec Dave Turcotte, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. 2016.
Musée du Haut-Richelieu

Buste de Félix-Gabriel Marchand par l'artiste Alexandre Carli. 1889.
Musée national des beaux-arts du Québec
Photographe Musée du Haut-Richelieu
Sources
Livres
Bédard, Louise (2021). Le Canada Français, 160 ans d'histoire. Saint-Jean-sur-Richelieu : Le Canada Français.
Bergeron, Gérard (1997). Révolutions tranquilles à la fin du XIXe siècle. Montréal : Éditions Fides.
Commission de la Capitale nationale du Québec (1999). Je me souviens. Les monuments funéraires des premiers ministres du Québec. Québec : Commission de la Capitale nationale du Québec.
Corbo, Claude (2015). L'Échec de Félix-Gabriel Marchand. Une interprétation en forme dramatique. Montréal : Del Busso Éditeur.
Desnoyers, Marilou (2017). Le Haut-Richelieu : des trésors d'eau, de terre et de feu. Saint-Jean-sur-Richelieu : Musée du Haut-Richelieu.
Fortin, Lionel (1979). Félix-Gabriel Marchand. Saint-Jean-sur-Richelieu : Éditions Mille Roches.
Germain, Jean-Claude (1977). Les Faux Brillants de Félix-Gabriel Marchand. Paraphrase. Montréal-Nord : VLB Éditeur.
Guay, Jean-Herman et Serge Gaudreau (2018). Les élections au Québec : 150 ans d’une histoire mouvementée. Québec : Les presses de l’Université Laval.
Hamelin, Marcel (1967). Les mémoires du sénateur Raoul Dandurand (1861-1942). Québec : Les Presses de l'Université Laval.
Lacoursière, Jacques (1996). Histoire populaire du Québec. De 1841 à 1896. Montréal : Éditions du Septentrion.
Lacoursière, Jacques (1997). Histoire populaire du Québec. De 1896 à 1960. Montréal : Éditions du Septentrion.
Lacoursière, Jacques (1997). Monsieur le Président. Les orateurs et les présidents depuis 1792. Québec : Publications du Québec.
Lacoursière, Jacques, Jean Provencher et Denis Vaugeois (2015). Canada-Québec, synthèse historique 1534-2015. Québec : Éditions du Septentrion.
Lamarche, Jacques (1997). Les 27 premiers ministres. Montréal : Éditions LIDEC.
Linteau, Paul-André, René Durocher et Jean-Claude Robert (1979). Histoire du Québec contemporain. Québec : Les Éditions du Boréal express.
Livernois, Jonathan (2021). Entre deux feux. Parlementarisme et lettres au Québec (1763-1936). Montréal : Les Éditions du Boréal.
Piazza, François et coll. (1980). Le Mémorial du Québec Tome IV 1890-1917. Montréal : La Société des éditions du Mémorial.
Rumilly, Robert (1940-1969). Histoire de la province de Québec I à XI. Montréal : Éditions Bernard Valiquette.
Tremblay Lamarche, Alex (2014). La mixité culturelle au sein des élites québécoises au XIXe siècle : l’exemple de la famille Marchand, 1791-1900. Québec : Université Laval.
Tremblay Lamarche, Alex (2017). Félix-Gabriel Marchand : l'histoire derrière l'homme. Saint-Jean-sur-Richelieu : Musée du Haut-Richelieu.
Articles
Bélair-Cirino, Marco et Dave Noël (2018, 14 décembre). « Le Conseil législatif du Québec, rempart contre l’autoritarisme ». Journal Le Devoir (Montréal).
Desnoyers, Marilou (2022, 7 avril). « Un trésor de 125 ans dans notre musée régional ». Journal Le Canada français (Saint-Jean-sur-Richelieu).
Desnoyers, Marilou (2022, 17 mars). « Quand les féniens voulaient envahir le Canada ». Journal Le Canada français (Saint-Jean-sur-Richelieu).
Desnoyers, Marilou (2022, 10 mars). « Hortense Tugault : la bienfaitrice de l'Hôpital Saint-Jean ». Journal Le Canada français (Saint-Jean-sur-Richelieu).
Lachaussée, Catherine (2020). « 12 demeures de premiers ministres à découvrir dans le Vieux-Québec ». Radio-Canada (Montréal).
Lefebvre, Jean-Jacques (1978, janvier). « Félix-Gabriel Marchand (1832-1900), notaire, 1855, premier ministre du Québec, 1897 ». La Revue du Notariat, volume 80, numéro 6 (Montréal).
Tremblay Lamarche, Alex (2016). « L'héritage méconnu de Félix-Gabriel Marchand (1832-1900) ». Cap-aux-diamants, numéro 126, été 2016 (Québec).
Sites
Assemblée nationale du Québec (Félix-Gabriel Marchand)
Assemblée nationale du Québec (Gabriel Marchand)
Assemblée nationale du Québec (Double mandat)
Dictionnaire biographique du Canada
Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Société du patrimoine politique du Québec
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Wikipédia (Félix-Gabriel Marchand)
Wikipédia (Joséphine Marchand)
.jpg)




.jpg)



.jpg)
.jpg)










