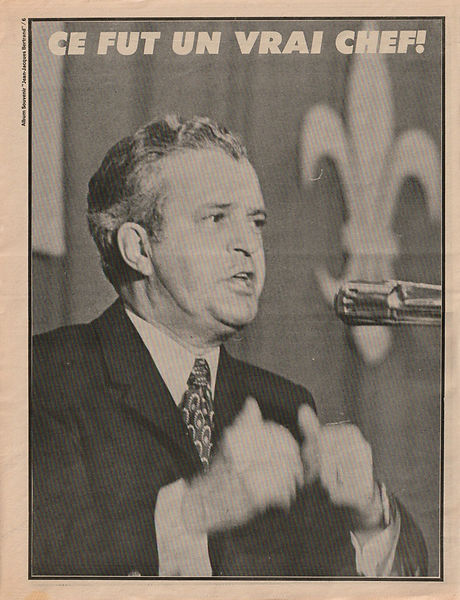Jean-Jacques Bertrand


21e premier ministre du Québec
2 octobre 1968 au 12 mai 1970
Union nationale
Le 2 octobre 1968, Jean-Jacques Bertrand devient premier ministre du Québec. En plus de ce 55e anniversaire, l’année 2023 marque aussi les 50 ans de son décès. Bien qu’il fût ministre des Terres et Forêts, de la Jeunesse, du Bien-être social, de l’Éducation, de la Justice, des Affaires intergouvernementales et brièvement des Finances, on se souvient peu de son mandat de premier ministre. Il faut dire que ce dernier fut de courte durée entre Daniel Johnson père et Robert Bourassa. Bertrand est d’ailleurs le dernier chef de l’Union nationale à occuper la fonction de premier ministre du Québec. Cette exposition vous permettra d’en apprendre davantage sur ce premier ministre méconnu.
Bonne visite !
L’homme
Jean-Jacques Bertrand est né à Sainte-Agathe-des-Monts, le 20 juin 1916. Il est le fils de Bernadette Bertrand et de Lorenzo Bertrand, chef de gare et télégraphiste. D’ailleurs, la circonscription comprenant sa ville natale dans les Laurentides porte son nom depuis 1992.
Pierre Godin raconte que Bertrand « vient d’une famille libérale demeurée imperméable aux sirènes du nationalisme québécois. La règle politique du “rouge de père en fils” ne s’appliquera pas à Jean-Jacques Bertrand. Son père, Lorenzo Bertrand, était libéral depuis toujours. Chef de gare du petit village laurentien de Sainte-Agathe, on le reconnaissait à deux traits précis : sa ponctualité et son bilinguisme. Le train partait toujours à l’heure et dans les deux langues ! Comme tous les cadres des chemins de fer du début du siècle, Lorenzo Bertrand tirait une grande fierté de son bilinguisme, fierté qu’il transmit à son fils. Il lui légua également sa couleur politique qui était le rouge.
Un jour, la compagnie ferroviaire transféra Lorenzo Bertrand à Farnham où on avait un urgent besoin d’un chef de gare bilingue capable de faire démarrer les trains à l’heure. Jean-Jacques grandit donc dans une région libérale à dominance anglophone. Le “bleu”, il ne le voyait qu’au ciel. Un tel legs aurait dû le pousser à faire carrière à Ottawa ou encore avec les libéraux provinciaux. Mais il n’en fut rien. Les hasards de sa carrière d’avocat et les flèches de Cupidon le dirigèrent, au contraire, vers l’Union nationale. »
Du rouge au bleu
Pierre Godin rappelle qu’en « 1942, le conseiller législatif Louis-Arthur Giroux […] se sent débordé. Il lui faut un assistant pour son étude de Sweetsburg, à côté de Cowansville et Maximilien Caron, doyen de la Faculté de droit à l’Université de Montréal, lui conseille, au cours d’une rencontre, un jeune avocat prometteur, Me Jean-Jacques Bertrand.
Devenir l’associé du conseiller Giroux, c’est se relier directement à Maurice Duplessis. Le conseiller (que ses amis surnomment “Ti-Louis”) est un drôle de pistolet. C’est un affamé de la politique qui néglige le droit, dépense beaucoup et se mêle de toutes les élections. Au scrutin général du 24 août 1931, il est candidat conservateur dans Brome, aux côtés de Duplessis et de Camillien Houde. Battu par cent voix seulement, Me Giroux demeure néanmoins l’un des compagnons d’armes de Duplessis jusqu’à la formation de l’Union nationale en 1935-1936, mais il renonce alors à briguer les suffrages. Une fois au pouvoir, Duplessis paye sa dette de reconnaissance envers “Ti-Louis” en lui faisant cadeau du siège de conseiller législatif du district de [Wellington].
Pratiquer le droit avec un avocat aussi en vue que Me Giroux constitue indéniablement la filière idéale pour un jeune avocat talentueux que les débats de palais vont attirer de moins en moins. Jean-Jacques Bertrand ne fera pas fausse route en acceptant le poste, il se liera à la dynastie des Giroux qui domine la vie politique du comté de Missisquoi depuis le début du siècle. »

Louis-Arthur Giroux est un conseiller législatif et le beau-père de Jean-Jacques Bertrand. « Louis-Arthur est le fils de François-Xavier-Arthur Giroux qui pratiquait le droit avec George Barnard Baker au tournant du siècle. Au moment où Harry Baker se retrouve dans les tranchées en 1915, le jeune Louis-Arthur est engagé comme secrétaire du lieutenant-gouverneur du Québec, d’allégeance conservatrice. Après avoir étudié à Farnham, sa ville natale, et à Saint-Hyacinthe, il est alors inscrit en droit à l’Université Laval de Québec. Membre du Barreau en 1918, il quitte Québec pour revenir à Sweetsburg pratiquer dans l’étude de son père pendant une dizaine d’années puis avec un autre associé en 1928. À partir de cette date, il s’investit aussi dans la politique locale, comme conseiller municipal de 1928 à 1945 et président de la commission scolaire de 1932 à 1935. Il est également cofondateur de l’Association du Barreau rural en 1938. L’année précédente, il avait été nommé au Conseil législatif par Duplessis, douce vengeance pour son père, deux fois défait comme candidat conservateur dans la circonscription provinciale de Missisquoi. Sa division de Wellington recouvre le centre des Cantons-de-l’Est. Jusqu’à son décès prématuré à l’âge de 52 ans, Louis-Arthur siégera à la Chambre haute du Québec, laquelle sera abolie par son gendre Jean-Jacques Bertrand en 1968. » - Trois grandes familles de parlementaires issues des Cantons-de-l’Est
Photographie de Louis-Arthur Giroux.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Fonds J. E. Livernois Ltée

Macaron du candidat conservateur Louis-Arthur Giroux dans Brome. Parti conservateur du Québec. 1931
Provenant d'une collection privée
Pierre Godin relate que « Le premier de la lignée, Me [François-Xavier-Arthur] Giroux avait tenté à plusieurs reprises de se faire élire au fédéral sous une étiquette bleue que délavait un peu plus chaque élection perdue. D’une fois à l’autre, il empruntait ou hypothéquait sa maison afin de récolter l’argent nécessaire à sa campagne. Le destin voulut qu’il mourût sans avoir jamais goûté aux délices du pouvoir. Dans ce Québec des années 1900, placé sous l’hégémonie rouge, il eut mieux valu pour lui tirer sa poudre aux moineaux que de solliciter un mandat conservateur. Son épouse Eugénie, surnommée Lady Giroux par les villageois, souffrait, elle aussi, du virus bleu. Depuis l’imposition de la conscription par le gouvernement conservateur de Borden, en mai 1917, il était assez mal vu, au Québec, de s’afficher avec les tories à moins d’être particulièrement résistant. Lady Giroux n’était pas plus masochiste qu’une autre, mais elle avait tout simplement le courage de ses convictions. Quand, en 1930, le chef conservateur R. B. Bennett fut élu premier ministre du Canada en dépit du “Rappeliez-vous 1917 !” des libéraux, Lady Giroux accrocha sa photographie sur un mur vieillot de sa maison. Élue présidente des Femmes conservatrices du Canada, l’indomptable militante n’hésitait pas, en temps de campagne électorale, à se coiffer d’un voile noir, célèbre dans le canton, et à faire du porte-à-porte pour démolir la propagande libérale.
Le conseiller Louis-Arthur Giroux ne fut pas plus heureux en politique que son père. Mais il eut la satisfaction de fonder une belle famille qui comptait une jolie fleur baptisée Gabrielle. C’était écrit dans le ciel : Jean-Jacques Bertrand s’éprit de la fille de son patron ». Le 14 octobre 1944, à Sweetsburg (Cowansville), Jean-Jacques Bertrand épouse Gabrielle Giroux, fille de Juliette Bolduc. Le couple Bertrand-Giroux donne la vie à sept enfants : Andrée, Jean-François, Suzanne, Pierre, Louise, Louis-Philippe et Marie.


Photographies du couple Giroux-Bertrand avec trois de leurs enfants à la résidence familiale. 13 août 1966.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Antoine Desilets
Pierre Godin ajoute : « Une bonne fée présidait au déroulement de la carrière du futur député de Missisquoi. Les portes du pouvoir s’ouvraient devant lui, il n’avait qu’à suivre la pente. Ce qu’il fit docilement, avec l’appui de son beau-père. En 1946, au moment même où un autre jeune avocat, Daniel Johnson, se lance à l’assaut du comté de Bagot, Jean-Jacques Bertrand et sa jeune épouse s’installent dans la maison ancestrale de Sweetsburg dont Gabrielle vient d’hériter, au 769 de la rue Principale. »


Photographies du couple Giroux-Bertrand à la résidence familiale située au 769 de la rue Principale à Cowansville. 13 août 1966.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Antoine Desilets
Jacques Gagnon déclare que « bien qu’ils constituent l’une des plus petites régions du Québec, les Cantons-de-l’Est n’en sont pas moins le berceau de trois grandes familles de parlementaires qui ont laissé leur marque tant à Québec qu’à Ottawa. » La famille Giroux-Bertrand en est une. En plus du premier ministre Jean-Jacques Bertrand, son épouse, Gabrielle (Giroux) Bertrand, est députée de Brome-Missisquoi à la Chambre des communes du Canada de 1984 et 1993. Leur fils, Jean-François Bertrand, est député de Vanier de 1976 à 1985 et ministre dans les gouvernements péquistes de René Lévesque et Pierre Marc Johnson. Sans oublier Louis-Arthur Giroux, le père de son épouse Gabrielle, est conseiller législatif de la division de Wellington (Sherbrooke) de 1937 jusqu’à son décès en 1945.

Gabrielle (Giroux) Bertrand est députée fédérale et épouse de Jean-Jacques Bertrand. Elle est élue députée du Parti progressiste-conservateur du Canada dans Brome—Missisquoi en 1984 et réélue en 1988. Elle ne se représente pas en 1993. Elle est secrétaire parlementaire du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de 1984 à 1986 et du ministre de la Consommation et des Corporations de 1986 à 1987.
Photographie de Gabrielle (Giroux) Bertrand. Janvier 1970.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photo Gaby (Gabriel Desmarais)

Jean-François Bertrand est ministre et le fils de Jean-Jacques Bertrand. Il est élu député du Parti Québécois dans Vanier en 1976 et réélu en 1981. Il est adjoint parlementaire au ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement à compter du 1er mars 1978. Il est leader parlementaire adjoint du gouvernement du 3 octobre 1978 au 12 mars 1981. Il est ministre des Communications dans le cabinet Lévesque du 30 avril 1981 au 3 octobre 1985 et dans le cabinet Johnson (Pierre Marc) du 3 octobre au 12 décembre 1985. Il est leader parlementaire du gouvernement du 23 février 1982 au 5 mars 1984 et leader parlementaire adjoint du 12 mars 1984 au 23 octobre 1985. Il est ministre responsable de l'Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels du 29 septembre 1982 au 3 octobre 1985. Il est défait en 1985. Il es élu chef du Progrès civique de Québec le 29 mai 1989. Il est candidat défait à la mairie de Québec le 5 novembre 1989. Il est candidat du Bloc Québécois défait dans Brome-Missisquoi à l'élection partielle fédérale du 14 février 1995. Il est conseiller politique au cabinet de Lucien Bouchard, chef du Bloc Québécois, en 1995.
Affiche du candidat péquiste Jean-François Bertrand dans Vanier. Parti Québécois. 1976
Collection Dave Turcotte
Études
Le jeune Jean-Jacques débute ses études au Collège Sacré-Cœur à Sainte-Agathe, puis il se rend au Juvénat des Oblats à Ottawa et obtient son baccalauréat ès arts au Séminaire de Saint-Hyacinthe tout comme les premiers ministres Gédéon Ouimet, Joseph-Adolphe Chapleau, Honoré Mercier et Daniel Johnson père.
À ce sujet, Pierre Godin affirme qu’à « la faveur des séances de la Cour civile et criminelle du séminaire, Johnson avait fait la connaissance de l’étudiant Jean-Jacques Bertrand. Tous deux ignoraient alors qu’ils se retrouveraient dans le même parti durant plusieurs années et que les caprices de la fortune politique tantôt les rapprocheraient, tantôt les opposeraient. Bertrand ne fit qu’une année au séminaire de Saint-Hyacinthe, soit les belles-lettres. Mais il avait commencé son cours classique à l’Université d’Ottawa où l’étude du grec ne figurait pas au programme et il eut tant de difficultés avec cette langue qu’il décida, à la fin de l’année, de retourner à Ottawa pour faire ses deux années de philosophie. »
Pierre Godin prétend qu’au « collège, Bertrand ne mâchouillait pas de cailloux comme Démosthène pour améliorer son élocution. Il avait des habitudes plus intimistes. Ce n’était pas devant la mer en furie qu’il déclamait à haute voix, mais au cabinet d’aisances… quand il s’y croyait seul. De sa voix la plus forte, l’étudiant récitait ses prières ou ses leçons en détachant de façon exagérée chaque syllabe, chaque mot. Avec un tel procédé, le jeune Bertrand agaçait ses pairs, mais acquérait du même coup une parfaite maîtrise de l’art oratoire. »
Il poursuit ses études en droit aux universités d’Ottawa et de Montréal. Doué, il est décoré du Mérite universitaire par l’Université de Montréal. En terminant ses études à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, il est présenté ainsi dans le journal Le Quartier latin : « Type : Un Descartes sensible. Logique jusque dans l’erreur. Crinière de lion. Idéal : Un Mirabeau canadien. Debater à la Chambre des communes. Passe-temps : Se faire aller les mâchoires. Organiser des congrès. »
En 1941, il est admis au Barreau de la province de Québec, un an après son futur collègue Daniel Johnson père. Il établit sa pratique à Sweetsburg où il devient le jeune associé de Me Louis-Arthur Giroux, son beau-père. Plus tard, il s’associe à Me Gérard Turmel, puis aux avocats Jacques Meunier et Gilles Mercure. Le 14 juin 1950, il est créé conseil en loi du roi.
Cowansville
Impliqué dans sa communauté, Jean-Jacques Bertrand est membre du conseil d’administration de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et il préside la Chambre de commerce des jeunes de Cowansville en 1946 et en 1947. Il agit à titre de directeur de la Compagnie d’expansion industrielle de Cowansville. Il est secrétaire-trésorier des corporations municipale et scolaire de Sweetsburg de 1942 à 1948. Son service public lui donne surement le goût d’aller plus loin et de faire le saut lui-même en politique active.
Même lorsqu’il occupe les plus hautes fonctions, Jean-Jacques Bertrand demeure toujours enraciné à son coin de pays. Pierre Godin explique que « Bertrand, c’est un homme simple qui a horreur de la ville. Il se sent bien chez lui à la campagne ou à la mer. Son comté de Missisquoi, il en a fait le centre de sa vie pour lui et sa famille de sept enfants. » Pierre Godin ajoute : « Sa répulsion pour Montréal est si forte qu’il n’arrête pas de dire à ses proches quand il y vient : “Je ne comprends pas que vous puissiez vivre ici !” Homme sans façon, Bertrand accorde aussi peu d’importance à l’apparat. Il s’habille peu ou mal. Contrairement à Johnson, il n’aime pas les bains de foule. Par exemple, l’idée d’entrer au Club Renaissance, alors qu’il s’y déroule une grande réception, le terrorise. Il faut le prendre par le bras. »

Photographie de Jean-Jacques Bertrand se reposant dans son jardin à Cowansville. 29 avril 1970.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Paul Henri Talbot
L'HOMME

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec son épouse Gabrielle. 23 août 1966.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Michel Gravel

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec son épouse Gabrielle. Janvier 1970.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photo Gaby (Gabriel Desmarais)

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec sa fille Marie. 17 juin 1966.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Michel Gravel

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec son épouse Gabrielle et leurs sept enfants. Vers 1970.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Fonds L'Action catholique

Photographie du cabinet des avocats Louis-Arthur Giroux et Jean-Jacques Bertrand situé sur la rue Principale à Sweetsburg (Cowansville).
Société d’histoire de Cowansville


« La variété de couleurs et de matériaux, le plan au sol asymétrique, les nombreux volumes, les saillies et les avancées confirment le style éclectique du bâtiment. La résidence est située dans un environnement d’arbres matures représentatifs de la région. Le plus connu de ses propriétaires est l’ancien premier ministre du Québec de 1968 à 1970 : Jean-Jacques Bertrand. L’intérieur du portique de la maison Giroux-Bertrand est aménagé et révèle des pratiques propres au XIXe siècle. Le plancher est recouvert de lattes alors que d’autres, plus étroites, composent le plafond. Les épis de faîtage ouvragés ajoutent une touche de raffinement à la décoration d’ensemble. » - Circuit d'histoire et de patrimoine de la ville de Cowansville
Photographies de la maison de Jean-Jacques Bertrand et de son épouse Gabrielle (Giroux) Bertrand située au 769 de la rue Principale à Cowansville ainsi que de son panneau d'interprétation.
Collection Dave Turcotte

Gabrielle (Giroux) Bertrand est la première et la seule épouse de premier ministre québécois à avoir été élue députée à la Chambre des communes. À l’Assemblée nationale du Québec, c’est Lisette Lapointe, épouse de Jacques Parizeau, qui est la première et la seule élue.
Photographie de la bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand à Cowansville.
Collection Dave Turcotte

Exemplaire du journal annonçant l'élection de Jean-François Bertrand à titre de président de l'Association générale des étudiants du Séminaire de Saint-Jean en 1965. il est aussi vice-président aux affaires extérieures pour la Fédération des associations générales des étudiants des collèges classiques du Québec en 1965 et président pour la région Richelieu–Rive-Sud de l'Union générale des étudiants du Québec en 1966.
Page une du journal L'Aiglon du Séminaire de Saint-Jean. Mars 1965.
Collection Dave Turcotte
Généalogie de Jean-Jacques Bertrand
Lignée directe
de Jean Bertrand
à Jean-Jacques Bertrand
1. Jean Bertrand
n. 00-00-1667 La Ferrière-Airoux, Vienne, France d. 00-10-1718 Montréal
Charlotte Bérard m. 23-09-1697 Montréal
n. 20-07-1674 Sorel d. 27-09-1751 Montréal
[fille de Jean Brard et Charlotte Coy]
2. Jacques Bertrand
n. 05-09-1699 Montréal d. 10-01-1771 Montréal
Marie Louise Dumouchel m. 19-09-1729 Montréal
n. 19-08-1710 Montréal d. 16-04-1761
[fille de Paul Dumouchel et Marie Louise Tessier]
3. Louis-Michel Bertrand
n. 29-09-1737 Montréal d. 18-01-1808 Rigaud
Marie Josephte Boyer m. 10-08-1778 Vaudreuil
n. 07-02-1741 Sainte-Anne-de-Bellevue d. 00-05-1805 Rigaud
[fille de Jean-Étienne Boyer et Josephe Hunault]
Charlotte Bertrand m. 06-06-1763 La Prairie
[fille de Paul Bertrand et Charlotte Longtin]
4. Antoine Bertrand
n. 00-00-1780 Vaudreuil
Marie Josephe Cholette m. 11-01-1802 Vaudreuil
n. 12-01-1785 Vaudreuil d. 08-07-1836 Rigaud
[fille de Sébastien-Hyacinthe Cholette et Angélique-Madeleine Roy]
Pélagie Séguin m. 16-01-1837 Rigaud
n. 30-01-1779 Vaudreuil d. 16-04-1864 Vaudreuil
[fille de Louis-Amable Séguin et Pélagie Léger]
5. Julien-Vital Bertrand
n. 27-04-1814 Rigaud
Antoinette Séguin m. 07-02-1842 L'Orignal, Ontario
n. 25-12-1815 Rigaud
[fille de Hyacinthe Séguin et Monique Villeneuve]
6. Julien-Honoré Bertrand
n. 00-00-1843
Élise Mathieu m. 17-10-1870 Ottawa, Ontario
n. 00-00-1851
[fille de Jean-Baptiste Mathieu et Angélique Rochon]
7. Lorenzo Bertrand
n. 08-02-1876 d. 15-12-1941 Farnham
Bernadette Bertrand m. 22-07-1908 Ottawa, Ontario
n. 08-03-1885 Sainte-Scholastique d. 03-06-1971 Sainte-Agathe-des-Monts
[fille de Olivier Bertrand et Basilice Neveu]
Anne-Bella ??? m.
8. Jean-Jacques Bertrand
n. 20-06-1916 Sainte-Agathe-des-Monts d. 22-02-1973 Montréal
Marie-Thérèse-Gabrielle Giroux m. 14-10-1944 Sweetsburg
n. 00-00-1920
[fille de Louis-Arthur Giroux et Juliette Bolduc]
LÉGENDE
n. Naissance
d. Décès
m. Mariage
Merci à Gérard Héroux
pour la recherche généalogique.

Le député
Élection québécoise de 1948
Très impliqué au Parti conservateur, Louis-Arthur Giroux, le beau-père de Bertrand et conseiller législatif meurt en fonction en 1945. Il serait à l’origine de l’adhésion de Bertrand à l’Union nationale. Étant plutôt progressiste Bertrand aurait pu être tenté par le Parti libéral. Il fait le saut en politique active et se porte candidat unioniste à l’élection de 1948. Il affronte le député libéral sortant Henri-A. Gosselin.
Guay et Gaudreau expliquent que « lorsque la Chambre est dissoute, en juin 1948, Duplessis compte sur 52 députés contre 33 pour le Parti libéral d’Adélard Godbout et 5 indépendants, alors qu’un siège est vacant. Autre signe de stabilité, les chefs Duplessis et Godbout se font face pour la quatrième fois consécutive lorsque la campagne se met en branle le 9 juin. C’est du jamais-vu et du jamais réédité en politique québécoise en ce qui a trait à ceux qui dirigent le gouvernement et l’opposition officielle. »
Marcel Labelle affirme que « c’est auprès des électeurs nationalistes que Duplessis va marquer un grand coup. En plus de s’opposer à Ottawa au nom de l’autonomie du Québec lors de la conférence fédérale-provinciale, Duplessis adopte, en janvier 1948, le drapeau fleurdelisé pour la province de Québec. Il est vu comme le grand défenseur du Québec contre les visées centralisatrices d’Ottawa. »
Les résultats sont catastrophiques pour Adélard Godbout, souvent décrit comme le « valet d’Ottawa » tout le long de la campagne. Le gouvernement de Maurice Duplessis est réélu lors de l’élection du 28 juillet 1948. L’Union nationale fait élire 82 députés avec 51 % du vote et le Parti libéral ne fait élire que 8 députés avec 36 % du vote. Il y a deux députés indépendants. Jean-Jacques Bertrand est pour sa part élu député de l’Union nationale dans la « traditionnellement bilingue » circonscription électorale de Missisquoi dans les Cantons-de-l’Est.

Henri-A. Gosselin est conseiller municipal à Farnham de 1924 à 1927, maire de Lawrenceville en 1927 et maire de Farnham de 1932 à 1938. Il est élu député du Parti libéral du Québec dans Missisquoi en 1939. Il est réélu en 1944, mais défait en 1948 par Jean-Jacques Bertrand. En 1949, il est élu député du Parti libéral du Canada dans Brome—Missisquoi. Il meurt en fonction en 1952.
Photographie du député Henri-A. Gosselin.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Résultats de l'élection québécoise de 1948 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Les deux font la paire
Pierre Godin soutient qu’après « 1948, les deux anciens collègues du séminaire de Saint-Hyacinthe et de la Faculté de droit se côtoient une fois de plus sur le parquet de l’Assemblée législative. Dès leurs premières années de session, à l’ombre d’un chef qui aime les tenir tous deux en laisse, une émulation, qui deviendra parfois de l’antagonisme, commence à s’emparer d’eux. Dans les cercles politiques de la capitale, on parle rarement de Daniel Johnson sans mentionner aussitôt Jean-Jacques Bertrand. C’est une habitude. Comme si l’un était le jumeau de l’autre ou sa copie conforme. Ils forment une paire de “jeunes qui promettent” dans un parti où cette qualité fait terriblement défaut. Mais le député de Bagot, qui préférerait faire cavalier seul, finit par en avoir plus qu’assez d’être continuellement mis en parallèle avec Bertrand et il ne se gêne pas pour répéter à ses intimes : “Je l’aime bien, Jean-Jacques, mais pourquoi faut-il qu’il soit nommé, lui aussi, quand je le suis ?” […]
Duplessis n’attise pas le feu de leur rivalité : quand il donne à l’un, il donne l’équivalent à l’autre. Certes, le Chef se reconnaît davantage en Johnson en qui il a vite discerné le titre de politicien d’avenir. “Ah ! Le p’tit maudit !” Laisse-t-il parfois échapper devant son secrétaire Roger Ouellet, quand le député de Bagot a fait un bon coup. Néanmoins, il aime bien le côté moraliste de Bertrand, sa candeur qu’on prendrait parfois pour de la naïveté, son refus des compromis faciles. Mais ce sont surtout ses morceaux d’éloquence qui le font vibrer. Pour lui, Jean-Jacques Bertrand, c’est saint Jean Bouche d’or. Il trouve que c’est un excellent orateur et ne se prive pas de le faire savoir à son entourage. Hommage surprenant, car le Chef est avare de compliments. »

Photographie de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Vers 1965.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Fonds L'Action catholique
Élection québécoise de 1952
Guay et Gaudreau mettent ainsi en contexte l’élection de 1952 : « Entourés de plus de 80 élus de l’Union nationale, cibles des railleries du premier ministre Maurice Duplessis, les 8 députés élus du Parti libéral en 1948 ressemblent à un groupe d’assiégés à l’Assemblée législative. Après le départ du chef Adélard Godbout, puis l’intérim de George Carlyle Marler, les libéraux se tournent le 20 mai 1950 vers le député fédéral de Joliette-L’Assomption-Montcalm, Georges-Émile Lapalme, pour leur donner un nouvel élan. Ce politicien de 43 ans est élu à l’unanimité, les autres candidats se désistant avant la tenue du vote. Il ne perd pas de temps avant de lancer une première salve contre le gouvernement : “Dans le parti bleu de Québec, on se préoccupe d’enrichir les favoris : les autres ne comptent pas”. »
Guay et Gaudreau rapportent : « Comme en 1948, le programme libéral est axé sur le thème de la justice sociale : “Être libéral c’est être socialement juste.” Plusieurs volets de cette politique sont développés : assurance maladie, allocation de maternité, enseignement primaire gratuit, etc. Les libéraux aimeraient également que les matières premières soient transformées davantage au Québec. Dans le même souffle, ils dénigrent le gouvernement sortant. Les problèmes dans le logement, les lois jugées anti-ouvrières et les privilèges accordés aux entreprises exploitant le minerai de l’Ungava — pour “une cenne la tonne” — sont au cœur de leurs attaques. Les libéraux s’en prennent aussi à l’intégrité de l’Union nationale, évoquant la corruption, la situation de sa caisse électorale et l’obsession anticommuniste qui ne serait “qu’un écran de fumée”. »
Guay et Gaudreau ajoutent : « Dans la foulée du slogan Laissons Duplessis continuer son œuvre, il fait un inventaire détaillé des réalisations de son gouvernement. Construction de routes, d’écoles, d’hôpitaux, baisse de la dette et avancées dans l’électrification rurale sont en relief dans ce discours qui fait aussi une place de choix à l’autonomie provinciale. Imageant son propos en parlant de la “tente d’oxygène fédérale”, le premier ministre va jusqu’à affirmer : “La grande question de l’heure, c’est la conservation de nos droits. C’est une question de vie ou de mort.” Ce thème permet à Duplessis de condamner une fois de plus l’attitude des libéraux provinciaux face à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale. Il vise également à placer Lapalme, qui a siégé à la Chambre des communes de 1945 à 1950, sur la défensive. Celui-ci est dépeint par ses adversaires comme une “marionnette” du Parti libéral fédéral dont certains membres, mais pas le premier ministre Louis Saint-Laurent, sont engagés dans la campagne. Les unionistes ne se privent pas non plus de ridiculiser l’inexpérience de Lapalme, qu’ils décrivent comme un radical ayant reçu l’appui des communistes, ce que nient libéraux… et communistes ! »
Le gouvernement unioniste de Maurice Duplessis est réélu lors de l’élection du 16 juillet 1952. L’Union nationale fait élire 68 députés avec 50 % du vote et le Parti libéral, 23 députés avec 46 %. Il y a un député indépendant. Bertrand est réélu dans la circonscription de Missisquoi avec la plus grande majorité de toute sa carrière politique.
Le 17 décembre 1954, Bertrand est nommé adjoint parlementaire au ministre des Terres et Forêts et au ministre des Ressources hydrauliques. C’est John Samuel Bourque qui a la charge de ces deux ministères à ce moment.

Résultats de l'élection québécoise de 1952 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Élection québécoise de 1956
La campagne de 1956 est pratiquement la même que celle de 1952. Les deux chefs, les thèmes et les pratiques électorales, peu de choses ont vraiment changé. Guay et Gaudreau rappellent que « Malgré ses 66 ans, le premier ministre Maurice Duplessis semble bien installé pour guider son parti vers une quatrième victoire consécutive et une cinquième en tout, avec celle de 1936. Le chef libéral Georges-Émile Lapalme tente pour sa part de tirer profit des progrès accomplis lors des élections de 1952. D’abord, une partielle dans Montréal-Outremont, le 9 juillet 1953, lui permet d’entrer finalement à l’Assemblée législative. Les libéraux du Québec s’attaquent aussi à l’un de leurs talons d’Achille, soit la perception qu’ils sont inféodés aux libéraux fédéraux. Déjà amorcée la séparation des organisations provinciale et fédérale s’amplifie. Sur le plan organisationnel, la Fédération libérale provinciale est fondée le 4 novembre 1955 à Montréal. Cette nouvelle structure se veut “autonome par rapport à l’organisation libérale fédérale et démocratique dans son fonctionnement et son financement”. »
Bertrand prend du galon dans le parti. Lors de cette campagne, Robert Rumilly raconte qu’il « prononce de bons discours bien préparés, fleuris de compliments au chef. Il appelle Duplessis le successeur de Mercier, qui a formé le parti national pour défendre l’autonomie de la province. »
Le gouvernement de Maurice Duplessis est réélu lors de l’élection du 20 juin 1956. L’Union nationale fait élire 72 députés avec 51 % des votes et le Parti libéral, 20 députés avec 44 % des votes. Il y a un député indépendant.

Résultats de l'élection québécoise de 1956 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
LE DÉPUTÉ

Caricature d'Aline Cloutier illustrant Jean-Jacques Bertrand. Entre 1950 et 1959.
Collection Aline Cloutier
1948

L'Union nationale mise sur le slogan : Duplessis donne à sa province en rappelant leurs nombreuses réalisations. Le tout nouveau fleurdelisé est aussi largement utiliser dans leur promotion.
Publicité de l'Union nationale. Journal La Patrie. Page 57. 25 juillet 1948.
Collection Dave Turcotte

Le Parti libéral dénonce vivement les « dons » de l’Union nationale pour tenter d’acheter les électeurs.
Publicité du Parti libéral du Québec. Journal La Presse. 24 juillet 1948.
Collection Dave Turcotte

Le Parti libéral fait la promotion de son programme progressiste tout en se dissociant du communisme.
Publicité du Parti libéral du Québec. Journal La Presse. 17 juillet 1948.
Collection Dave Turcotte
1952


Affiche du chef libéral George-Émile Lapalme. Parti libéral du Québec. 1952.
Collection Dave Turcotte
1956




Affiche du chef libéral George-Émile Lapalme. Parti libéral du Québec. 1956.
Collection Dave Turcotte
Le ministre
Nommé ministre des Terres et Forêts
Après avoir été l’adjoint parlementaire au ministre des Terres et Forêts pendant près de 4 ans, il devient à son tour ministre des Terres et Forêts dans le cabinet Duplessis. Il est assermenté le 30 avril 1958. Pierre Godin croit que si Duplessis « élève le député de Missisquoi au rang de ministre, c’est, bien sûr, parce qu’il l’en juge capable, mais c’est aussi parce qu’il veut encore une fois témoigner sa reconnaissance à Louis-Arthur Giroux. Duplessis n’oublie jamais ceux qui l’ont soutenu dans ses revers de fortune. En épousant Gabrielle Giroux, Bertrand a rejoint le clan des favoris du Chef. »
Le jour même, Daniel Johnson fait lui aussi son entrée au cabinet. Leur destin sera intimement lié tout au long de leur carrière politique. Pierre Godin explique ainsi le contexte de cette nomination. « Le 30 avril, Duplessis soulage son ministre des Finances, Johnny Bourque, du ministère des Terres et Forêts et des Ressources hydrauliques. Mais à qui confier le portefeuille libéré ? À [Daniel Johnson] ou à Jean-Jacques Bertrand, tout aussi apte que lui à assumer des responsabilités ministérielles ? Avec la sagesse d’un Salomon, Duplessis coupe la poire en deux. Une première moitié, les Ressources hydrauliques, va à Daniel Johnson et la seconde à Jean-Jacques Bertrand. Avec ses 41 ans bien sonnés, le nouveau ministre des Terres et Forêts devient le benjamin du cabinet. Daniel Johnson est de deux ans son aîné.
Johnson et Bertrand, c’est une véritable injection de sang neuf dans un corps ankylosé par la routine. Après 15 ans de pouvoir, le cabinet Duplessis tient du musée : la majorité des membres du Conseil des ministres ont en effet dépassé depuis fort longtemps la fleur de l’âge. Les deux nouveaux venus font figure de louveteaux dans une bergerie de vieux moutons fatigués. Ils tranchent également sur une députation sans envergure et renommée pour sa servilité et son anonymat. Tous les deux sont dans les bonnes grâces du Chef, mais pour des raisons différentes. Chez Johnson, Duplessis recherche la ruse et le zèle du croisé ; chez Bertrand, la sincérité et surtout une belle éloquence. »
Robert Rumilly mentionne que « Johnson et Bertrand ont commencé leur carrière politique en même temps. Ce sont deux personnalités intéressantes — et différentes, Daniel Johnson, bon organisateur d’élections, a de l’entregent, du charme et de l’ardeur et de l’astuce au combat. Jean-Jacques Bertrand, sincère, tolérant et scrupuleux, refuserait un compromis susceptible de lui assurer la victoire. Tous l’estiment et lui connaissent de jolies qualités, mais non pas celles d’un chef politique, Duplessis dit [d’eux] : “J’ai nommé un fin renard et un rhétoricien.” »
Pierre Godin rappelle que « la carrière de Jean-Jacques Bertrand ressemble comme un calque à celle du député de Bagot. Le premier rejoint le second d’abord au séminaire de Saint-Hyacinthe, puis à la Faculté de droit de l’Université de Montréal où il s’inscrit une année plus tard. Reçus tous deux avocats, l’un et l’autre manifestent un goût marqué pour l’action politique. Le prétoire ne leur suffit pas. Johnson devance Bertrand au parti, puis à l’Assemblée législative où ils sont élus respectivement en 1946 et en 1948. On dirait deux Mohicans se suivant à la trace. Mais l’éclaireur possède sur le chasseur une avance qui ne diminue pas. Ils ont beau emprunter les mêmes sentiers, s’arrêter aux mêmes étapes, séjourner dans les mêmes campements, le premier a toujours une lune d’avance sur le second. Le parallélisme est même géographique : leurs circonscriptions sont presque voisines. Enfin, les deux ministres ambitionnent de diriger un jour l’Union nationale. Pareille trajectoire ne peut que les pousser, un jour ou l’autre, à s’entredévorer… »
Benoit Gignac ajoute dans Le Destin Johnson que leurs « épouses viennent toutes deux de la bourgeoisie. Ils ont tous deux été attirés par la prêtrise au séminaire de Saint-Hyacinthe [...]. Autre ressemblance, mais impossible à déceler à cette époque : le fils de Jean-Jacques Bertrand, Jean-François, fera lui aussi de la politique et deviendra ministre avec Pierre Marc Johnson sous le gouvernement du Parti québécois. [...] Malgré ces nombreux points communs, ils n’ont pas la même approche ni le même style. Bertrand est plus flamboyant. C’est un orateur au style ampoulé, qui deviendra peu à peu caricatural. On dit aussi qu’il est idéaliste et moraliste. Johnson est plus populiste, moins affecté, plus stratégique et pragmatique. »

Caricature de Normand Hudon titrée : Mode d'automne, la ligne Bertrand. Entre 1958 et 1960.
Don d'Arlette Hudon
Une limousine ?
Pierre Godin rapporte que Johnson et Bertrand croient qu’un ministre doit avoir une limousine. « Leurs fonctions exigent qu’ils puissent se déplacer vite et loin. Après tout, c’est pour mieux servir la population, non ? Peut-être, mais Maurice Duplessis n’est pas du tout d’accord. Ses ministres ne doivent pas avoir l’air de pachas ! Le gouvernement dispose de quelques voitures officielles et la coutume veut qu’on se les partage. Il n’est absolument pas question de voir chacun des ministres rouler carrosse aux frais de la princesse ! Un jour, le chef du Service des achats du gouvernement, Alfred Hardy, reçoit deux réquisitions inhabituelles. Les nouveaux ministres Johnson et Bertrand lui demandent, le premier une Oldsmobile, le second une Buick. Et avec tout le grand luxe, s’il vous plaît : radio, bar et tous les “gadgets” possibles ! Hardy décroche le téléphone et demande à Duplessis ce qu’il doit faire.
- Refuse-les, répond ce dernier sans hésiter.
- Avec plaisir, monsieur le Premier ministre.
- Fred, ajoute Duplessis, signe toi-même le refus. Ne leur dis pas que c’est moi qui ai dit non et rappelle-moi après.
Le Chef veut connaître la réaction de ses nouveaux bras droits. Ceux-ci ne tardent pas à entrer en communication avec le fonctionnaire et s’étonnent de son refus. Johnson ne fait pas trop d’histoires, mais Jean-Jacques Bertrand, qui a un caractère primesautier, éclate :
- Ce n’est pas un fonctionnaire qui va décider ! On va aller en haut lieu !
- Allez-y, monsieur le ministre. Moi, j’ai pris mes responsabilités. J’ai fait mon devoir ! Réplique Alfred Hardy
- Je ne tolérerai pas d’impertinences de la part d’un fonctionnaire ! proteste encore Bertrand avant de raccrocher.
L’affaire se termine là en ce qui concerne Johnson. Le patron du Service des achats rappelle Duplessis et lui raconte ce qui s’est passé. Le Chef écoute et commente d’un ton incisif :
- Ces deux-là, je les ai nommés ministres et ils croient qu’ils le sont !
[…]
C’est finalement le trésorier du parti, Gérald Martineau, qui procure sa Buick à Bertrand. Martineau préfère le député de Missisquoi à Johnson dont il a deviné l’ambition dévorante. Il accepte les arguments que lui fait valoir le ministre des Terres et Forêts : la distance, ses revenus plutôt maigres, sa famille nombreuse. Bertrand est un homme simple, un avocat de campagne que l’argent laisse raisonnablement indifférent. Contrairement à certains de ses collègues, il ne patauge pas dans des combines susceptibles de grossir son modeste salaire de ministre de la Couronne. Il commet cependant une maladresse en demandant à Martineau de payer également les assurances. Le grand argentier se fâche : “Après un tel cadeau, tu pourrais au moins payer la police d’assurance !” Les rapports entre Martineau et Bertrand se refroidiront après cet incident, car Martineau, comme Duplessis, catalogue rapidement les hommes. »

Photographie de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand embarquant dans un avion. Entre 1966 et 1968.
Assemblée nationale du Québec.
Collection Alain Lavigne
Photographe : André Hébert
La mort du Chef
Le 7 septembre 1959, le premier ministre Maurice Duplessis décède subitement à Schefferville. C’est le ministre Paul Sauvé qui assume la succession. Bertrand conserve son ministère. Pierre Godin avance qu’en « moins de vingt-quatre heures, Sauvé passe à l’action avec une équipe sensiblement modifiée. Daniel Johnson conserve son ministère. La veille, la presse s’était demandée s’il n’accèderait pas à un ministère plus important, celui du Bien-Être social et de la Jeunesse, occupé sous Duplessis par nul autre que le nouveau Premier ministre. Eh bien, non ! Sauvé conserve son portefeuille en plus de sa nouvelle charge. Pas de promotion pour ce Johnson qui a osé parler d’un congrès au leadership ! Comme Duplessis, Sauvé reconnaît au ministre des Ressources hydrauliques l’étoffe d’un futur chef de gouvernement, mais il est agacé par son impatience. Quelques semaines après son investiture, Paul Sauvé révèle au ministre des Affaires municipales, Paul Dozois : je ne ferai pas plus de deux termes. Mais avant de quitter, je vais préparer mon successeur. Ce sera Jean-Jacques Bertrand. »
Guay et Gaudreau relatent que « Paul Sauvée incarne une volonté de changement de plus en plus palpable. Sans désavouer Duplessis, il martèle le mot “Désormais”, adopte une attitude moins autoritaire que son prédécesseur et exprime de l’intérêt pour faire avancer des dossiers qui traînent, comme celui du financement des universités, un vieux différend opposant Québec et Ottawa. Même s’il siège depuis près de 30 ans à l’Assemblée législative, Sauvé, qui n’a que 52 ans, est en quelque sorte un “homme politique nouveau”. La transition est bien accueillie. En décembre 1959, un sondage favorable au premier ministre fait même craindre le pire à l’ex-chef libéral Georges-Émile Lapalme : “Paul Sauvé nous balayait presque tous.” »

Photographie des funérailles du premier ministre Maurice Duplessis. Perspectives. Page 3. 10 octobre 1959.
Collection Dave Turcotte
À la mort de Paul Sauvé le 2 janvier 1960 d’une crise cardiaque, plusieurs collègues sollicitent Bertrand pour assumer la relève. Daniel Johnson tente d’obtenir des appuis, mais sa candidature ne semble pas fédérer bon nombre de députés. Bertrand est toujours perçu comme le chef de l’aile progressiste du parti. Il décline l’offre et laisse la place à Antonio Barrette. Peut-être en signe de remerciement, ce dernier nomme Bertrand ministre de la Jeunesse et ministre du Bien-être social le 8 janvier 1960. L’encyclopédie canadienne précise qu’étant « donné qu’il n’y avait pas de ministère de l’Éducation à l’époque, la Jeunesse est un ministère prestigieux, qui avait été dirigé par Paul Sauvé de 1944 à 1960. »

Page une du journal Le Soleil. 4 janvier 1960.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Publicité de Rosemount Industries Ltée rendant hommage aux deux premiers ministres décédés et soulignant la nomination du nouveau premier ministre Antonio Barrette. Journal Montréal-Matin. Page 9. 11 janvier 1960.
Collection Dave Turcotte
Pierre Godin raconte d’ailleurs que « le jour de la prestation de serment du nouveau Cabinet, Daniel Johnson n’affiche pas la mine patibulaire d’un mauvais perdant. “M. Johnson : le sourire malgré tout !” titre La presse. Pourtant, le nouveau Premier ministre lui administre une bonne taloche en confiant à son rival, Jean-Jacques Bertrand, le prestigieux ministère de Paul Sauvé. Un ministre sans portefeuille, Jacques Miquelon, succède à Bertrand aux Terres et Forêts. Pauvre Daniel ! Sa hâte d’arriver à ses fins le met en marge des honneurs. Les fleurs et les promotions sont pour Bertrand. “On prédit à ce jeune et talentueux ministre un rôle de premier plan dans le nouveau gouvernement”, souligne avec un malin plaisir Pierre Laporte (alors journaliste) qui, malgré son attachement à Johnson, ne se prive pas d’user d’un soupçon d’arsenic. »
Ce qui est le cas. Bertrand devient un proche du premier ministre Antonio Barrette. Cependant, ce gouvernement est usé par le pouvoir et n’a peu de temps pour se renouveler avant la prochaine élection.

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec Antonio Barrette. 1960.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Élection québécoise de 1960
Guay et Gaudreau soulignent que « Sauvé était un choix logique à la succession de Duplessis, les avis sont plus partagés quant à l’identité de son remplaçant. De fait, la nomination d’Antonio Barrette, un sexagénaire à l’image conservatrice, ministre du Travail depuis 1944, crée de la bisbille au sein du parti. Selon le journaliste Pierre Godin, peu après son intronisation, “sa galère tangue dangereusement sous les coups sournois que se portent mutuellement la vieille garde duplessiste et les éléments réformateurs”. De son côté, le Parti libéral a aussi un nouveau chef depuis 31 mai 1958. Il s’agit de Jean Lesage, un ex-ministre libéral fédéral qui a succédé en mai 1958 à Georges-Émile Lapalme. Lapalme demeure au sein du parti alors que Lesage, qui ne siège pas à l’Assemblée législative, se lance dans une tournée provinciale et fait paraître en septembre 1959 un livre, Lesage s’engage, dans lequel il résume son projet politique. Âgé de 47 ans, ce dernier, que le politologue Vincent Lemieux décrit comme n’étant pas “un idéologue, mais un intuitif”, donne une image de fraîcheur face à Barrette, un avantage qui aurait été moins marqué devant Sauvé. »
Guay et Gaudreau expliquent que « la campagne électorale est lancée peu après l’émission du décret d’élections, le 27 avril 1960. Sous le thème C’est le temps que ça change, Lesage défend le 6 mai un programme en 53 points concocté par Lapalme. Reprenant l’angle d’une plus grande justice sociale, il prévoit l’instauration de l’assurance hospitalisation et la gratuité scolaire à tous les niveaux, incluant l’université. On envisage aussi la création d’un ministère des Richesses naturelles et d’un autre des Affaires culturelles, d’un Conseil d’orientation économique ainsi que le règlement de vieux contentieux avec le fédéral : “J’en fais mon affaire des pensions de vieillesse.”
Plutôt que de miser sur un programme, Barrette s’appuie sur le bilan de l’Union nationale, au pouvoir depuis 1944. Le 9 mai 1960, La Presse titre : “Au programme libéral, l’UN opposera ses réalisations.” Le nouveau chef vante la politique d’autonomie provinciale ainsi que la gestion serrée des gouvernements unionistes, insistant sur leurs réalisations : électrification rurale, croissance économique, construction de routes, d’écoles et d’hôpitaux, etc. Bien qu’il aborde aussi des questions en suspens comme l’assurance hospitalisation, “le grand monsieur de la politique” cherche surtout à se situer en ligne droite avec les grands chefs du passé — “Duplessis, Sauvé, Barrette” — : “Je vais continuer dans la route tracée par mes prédécesseurs. Mais ayant une personnalité différente, je pourrai prendre des moyens différents.” Une publicité de l’Union nationale est même coiffée du titre “Deux hommes, une pensée”, en référence à Duplessis et Barrette. Le second n’a cependant ni le flair ni l’habileté du premier. »
Guay et Gaudreau ajoutent que « des révélations relatives à une offre financière de 3 800 $ faite par l’organisateur unioniste Joseph-D. Bégin à Honoré Pelletier, un cultivateur de Saint-Pacôme, pour qu’il change d’allégeance politique, ont aussi un certain retentissement. L’affaire se retrouve en première page du Devoir, journal en guerre avec l’Union nationale, avec une photographie du chèque ! Cette controverse s’ajoute à un moment donné à une autre : un cambriolage présumé dans le bureau de Lapalme. Elles incitent Lesage à parler de “banditisme” et des “saletés électorales du régime”. Ces histoires arrivent dans un terrain miné, le gouvernement étant déjà écorché par la publication, le 27 avril, du livre Le chrétien et les élections. Les abbés Gérard Dion et Louis O’Neill y déplorent le laxisme ambiant en matière de mœurs électorales. Peu de temps auparavant, le journaliste Pierre Laporte avait pour sa part lancé un ouvrage critique à l’endroit du premier ministre : Le vrai visage de Duplessis. »
Le gouvernement unioniste d’Antonio Barrette est défait lors de l’élection du 22 juin 1960. Le Parti libéral fait élire 51 députés avec 51 % des votes et l’Union nationale, 43 députés avec 46 % des votes. Il y a un député indépendant. Le premier ministre Lesage est assermenté le 5 juillet 1960. C’est la fin du long règne de l’Union nationale.

Résultats de l'élection québécoise de 1960 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
LE MINISTRE

Invitation à un diner en l'honneur de l'Honorable Jean-Jacques Bertrand, ministre des Terres et Forêts. 1958.
Collection Dave Turcotte
Don de Réal Fortin

Photographie du premier ministre Paul Sauvé accompagné de collègues dont Daniel Johnson et John Samuel Bourque à sa droite et Jean-Jacques Bertrand, second à sa gauche. 1959.
Collection Claude Gosselin

Photographie du premier ministre Maurice Duplessis accompagné de ses successeurs Paul Sauvé et Antonio Barrette.
Collection Alain Lavigne
1960

Publicité misant sur les trois grands chefs de l'Union nationale. Union nationale. 1960.
Collection Alain Lavigne

Publicité de la grande assemblée libérale de fin de campagne du 20 juin 1960 à Montréal. Parti libéral du Québec. 1960.
Collection Partis politiques.
Assemblée nationale du Québec.

L'opposition
Vien et Lapointe rappellent que « lorsque l’Union nationale perd le pouvoir le 22 juin 1960, l’évolution sociale et politique du Québec exige une réorganisation globale des forces dans le sens de la démocratisation des structures. Conscients de cette nécessité, les députés et conseillers législatifs de l’Union nationale prévoient la tenue d’un congrès à la chefferie, congrès qui permettra aussi une réorganisation nouvelle du parti. Lors d’un caucus à Montréal, le 22 octobre 1960, parlementaires et militants mettent au point également l’opération “Association de comté”. Dans un but évident de démocratisation de l’Union nationale, il est décidé qu’une association sera fondée dans chacun des 95 comtés ; sa première tâche sera de désigner les délégués qui participeront au congrès plénier de septembre. »
Bertrand tarde avant de se lancer dans la course ce qui donne une longueur d’avance à Johnson ayant débuté sa campagne au printemps. Pierre Godin écrit : « Si seulement le député de Missisquoi pouvait mettre fin à ses hésitations ! Tout ce qu’il sait dire à ceux qui le pressent de relever le gant, c’est “noui”. Pourtant, la bourgeoisie de l’Union nationale est derrière lui et il le sait. Quant à la députation, elle n’attend qu’un signe sans équivoque de sa part pour se ranger, dans son ensemble, sous sa bannière réformiste. »
Congrès de 1961
Le 13 août 1961, Bertrand se lance finalement. Il ne reste qu’environ un mois pour faire la campagne. Pierre Godin décrit que « dans les jours qui suivent, son organisation se met en branle. Moins bien nantis que le clan Johnson, les organisateurs se contentent, comme quartier général, de modestes bureaux situés rue Sainte-Catherine est, de biais avec le Café Saint-Jacques. On n’a pas encore les moyens de se payer le Reine-Elizabeth [comme le fait Johnson] ! Il a fallu aider Jean-Jacques Bertrand à faire le saut. Seul, il n’y serait pas arrivé. Bertrand, c’est un ténébreux, un inquiet qui manque totalement de confiance en lui et pour qui deux avis valent mieux qu’un. Il aime et déteste à la fois le monde de la politique dont il craint certaines facettes, celle de l’argent par exemple. Durant la campagne, il passera son temps à répéter à ses organisateurs : “Attention les gars ! Il ne faut pas que j’aie de dettes ! J’ai une famille !”. »
Pierre Godin présente les deux opposants ainsi : « Le député de Missisquoi est le verso du député de Bagot. Autant le premier est introverti, autant le second est extraverti. Autant le premier est désintéressé, autant l’ambition dévore le second. Bertrand n’affiche même pas ces petits défauts de l’homme politique, qui se voient à l’œil nu chez Johnson : aimer la politique plus que tout, savoir faire preuve d’opportunisme, être à l’aise avec les gens comme le poisson dans l’eau — défauts sans lesquels on ne saurait faire carrière en politique ! Bertrand se distingue encore de son opposant à la direction de l’Union nationale par son mépris de la politicaillerie, de toutes ces petites manigances souvent sordides dans lesquelles le député de Bagot est passé maître. Il ne possède pas non plus son habileté politique : comme un mauvais boxeur, il se découvre devant l’adversaire qui en profite pour cogner. S’efforcer, comme Johnson, de retenir par cœur le prénom ou le nom de famille de chacun de ses électeurs n’offre pour lui aucun intérêt. Ni le fait de passer des heures ou des jours à jongler avec des questions d’organisation électorale, comme Johnson en a l’habitude, pour ne pas dire la manie. Ce sont là, pour Bertrand, des tics relevant de la politique politicienne. »
Pierre Godin avance que si Bertrand « s’est finalement décidé, lui aussi, à enfiler les gants de boxe et à monter dans le ring, c’est également parce qu’un groupe de parlementaires, pressés de nettoyer une fois pour toutes la basse-cour unioniste, lui ont fait valoir que les réformistes du parti devaient avoir leur candidat, tout comme les nostalgiques du duplessisme avaient trouvé le leur en Daniel Johnson. Aux yeux de députés comme Claude Gosselin, Armand Maltais ou Paul Dozois, le seul homme jouissant d’une image politique vierge et d’une envergure suffisante pour conduire à bon port le frêle esquif de la réforme s’appelle Jean-Jacques Bertrand. »
Pierre B. Berthelot raconte que « Johnson est vu comme le favori. Candidat de la continuité, proche de l’esprit de Maurice Duplessis, l’ancien ministre des Ressources hydrauliques avait passé l’année 1961 à préparer le terrain, serrant les mains de milliers d’organisateurs et de membres nostalgiques du Chef, encore attachés aux valeurs d’entreprise privée et de religion catholique qu’il défendait si ardemment. Cependant, il ne trouvera pas beaucoup d’appuis chez ses collègues. De son côté, Jean-Jacques Bertrand se présente comme le candidat de la réforme, dans le même sillon que Paul Sauvé. De réputation impeccable, il reçoit l’appui de la veuve de Sauvé, de plusieurs journalistes, des plus jeunes membres et des éléments urbains du parti. Toutefois, il hésite longtemps avant de se lancer dans cette course et attend à un mois du congrès avant de confirmer sa candidature.
Bertrand préconise des réformes ambitieuses et une refonte complète du parti afin de prendre ses distances avec l’époque de Duplessis, promettant d’éliminer l’influence du patronage et de certains intérêts particuliers dans le parti. Il veut aussi libérer l’Union nationale de l’emprise de gens comme Gérald Martineau et Jos.-D. Bégin et créer des structures plus ouvertes, s’éloignant de la tradition du chef tout-puissant, dirigeant avec “une main de fer dans un gant velours”. Daniel Johnson, lui, ne s’oppose pas en principe aux réformes proposées par Bertrand, mais évite de trop se prononcer sur le sujet, croyant plutôt que les changements nécessaires ont déjà été faits. Johnson se concentre plutôt sur le Parti libéral, l’attaquant avec un ton agressif rappelant beaucoup Duplessis. Il dénonce l’interventionnisme, la déconfessionnalisation des écoles, les dépenses et les politiques “gauchistes” de René “Castro” Lévesque. La lutte s’engage entre les deux clans unionistes. Des partisans de Bertrand ne font pas confiance à Johnson à cause de sa mauvaise réputation et de son style trop proche de celui de Duplessis. Ils craignent que leur parti ne revienne jamais au pouvoir, s’il est élu chef. À l’opposé, les partisans de Johnson répondent que, bien que Bertrand soit un homme intègre, avec des idées neuves, il était trop bon garçon — trop inoffensif — pour affronter un adversaire aussi coriace que Jean Lesage et reprendre le pouvoir “dans le plus bref délai”. »
Pierre Godin émet que « comme Hamlet, l’avocat de Sweetsburg finit toujours par succomber au rôle que lui assignent non seulement la fatalité politique, mais également son entourage — son épouse Gabrielle, notamment. En digne fille du conseiller législatif Louis-Arthur Giroux, la femme de Bertrand a attrapé au berceau le virus de la politique. Elle a de l’ambition pour deux. C’est elle qui tient la main de Jean-Jacques Bertrand depuis ses premiers pas dans la carrière et qui l’a initié aux arcanes d’un métier pour lequel il ne ressentait, à l’origine, aucune attirance. En 1948, Bertrand ne voulait pas être député de Missisquoi. Il l’est devenu. En 1958, Bertrand n’ambitionnait pas un poste ministériel. Il a été nommé ministre des Terres et Forêts. Son attitude ambiguë lors de la démission de Barrette et ses hésitations à se laisser présenter comme candidat au congrès de septembre [1961] témoignent encore de ses tourments d’homme partagé entre ses rêves personnels et les attentes de son entourage, de sa famille, de son épouse. Les décisions de Bertrand portent la double marque du devoir et de l’influence de Gabrielle. Le jour où la presse a parlé de lui comme du chef possible de l’Union nationale, les johnsonistes ont pris un malin plaisir à insinuer que Gabrielle menait son mari par le bout du nez ! Ce que Gabrielle veut, Jean-Jacques le veut, laissait-on entendre pour discréditer l’autorité de celui-ci. En réalité, la compétence politique de Gabrielle Giroux l’impose à son mari comme conseillère. De plus, le couple est très uni — les époux Bertrand sont bien ensemble. Aussi, loin de pâtir de l’influence de sa femme, Bertrand accorde, au contraire, beaucoup d’importance à ses opinions. »

Photographie du couple Giroux-Bertrand. 29 avril 1970.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Paul Henri Talbot
Lors du lancement de sa campagne le 13 août 1961, Pierre Godin relate que « Bertrand s’enflamme. Son œil est pétillant quand il révèle à ses deux mille partisans, massés dans une salle surchauffée de l’école Sainte-Thérèse à Cowansville, les principales articulations d’un programme axé d’abord et avant tout sur la démocratisation de l’Union nationale. “Je constate un système et je veux le corriger !” Lance Bertrand en suivant le texte préparé par Maurice Giroux, frère de sa femme. Dans le clan Bertrand, on est conscient des périls qui guettent celui qui, au nom de la réforme et de l’épuration, se voit contraint de dénoncer le système de favoritisme attribué par l’adversaire libéral à son propre parti. […] “Je suis membre d’un parti politique et non un juge”, commence Bertrand. “Il ne peut être question de condamner des hommes. L’histoire fera cette besogne. Je n’ai pas le droit d’éclabousser ceux qui, à leur façon, ont pensé servir leur province et leur parti. Cependant, il ne saurait encore moins être question de passer l’éponge sur des pratiques néfastes. L’heure du courage, de la sincérité et de la lucidité est arrivée !” »
Pierre Godin croit que Bertrand a « les moyens de sa politique de renouveau, car sa réputation ne s’en va pas à vau-l’eau comme celle de Johnson. Politicien sans peur et sans reproche, Bertrand peut prêcher la vertu. Il ne se fait pas faute de rappeler à son auditoire : “Les libéraux ne peuvent rien me reprocher…”. Le député de Missisquoi se veut le “candidat de l’opinion publique”. Son passé politique ? Un livre ouvert ! Il en sera de même pour l’avenir du parti si les militants entérinent sa réforme. Comment s’articule-t-elle, cette réforme ? Le renouvellement de l’Union nationale doit toucher aux cadres et aux structures, mais aussi aux principes fondamentaux. D’abord, une démocratisation qui amènera les militants et les citoyens à prendre une part active aux mécanismes politiques et qui transformera les diverses instances du parti en des centres vivants d’action politique. Ne plus copier le passé et ne plus se figer dans l’immobilisme, mais faire enfin une place de choix à la génération montante et aux femmes. Il faut donc contrer le pouvoir absolu de la gérontocratie qui préside depuis trop d’années aux décisions de l’Union nationale. Et la caisse électorale de Gérald Martineau ? Il faut la lui enlever, sans l’abolir cependant, car “à moins d’une loi spéciale, la caisse électorale est nécessaire”. Néanmoins, il faut en arriver à une réduction draconienne des dépenses électorales par une loi qui fixera un maximum. Il faut aussi diminuer radicalement les dons de “gros financiers” et confier la caisse du parti à des fiduciaires. »
Pour ce qui est du contenu, Bertrand et Johnson s’opposent sur presque tous les grands débats de l’heure. Sur la question du patronage, à compétence égale, Bertrand « ne voit pas pourquoi on n’encouragerait pas nos amis ». Johnson s’y oppose fermement. Pour la question du rôle de l’État, Johnson dénonce vivement l’étatisation et les « les gauchistes socialisants qui font plier Lesage et qui ont usurpé le pouvoir ». Il est pour la libre entreprise. Bertrand est loin d’être un « réactionnaire ». Il affirme : « Notre but est de conquérir notre libération économique. L’individualisme doit, ici, céder le pas au travail collectif, ordonné, voulu, dirigé. L’État doit intervenir dans tous les domaines où l’initiative privée a échoué. »

Page une du journal Le Devoir. 14 août 1961.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Pierre Godin prétend que « le député de Missisquoi médite depuis peu sur une question aussi importante, à ses yeux, que la réforme interne de l’Union nationale. C’est la révision constitutionnelle, thème auquel les états-majors des partis politiques commencent à s’intéresser avec la montée du nationalisme. À ce sujet, Bertrand est en avance sur Johnson et sur Lesage. Il est le premier à proposer pour le Québec un statut particulier au sein de la Confédération. Il [propose] : “Nous devons chercher à faire reconnaître la souveraineté entière du Québec dans tous les domaines où la Constitution nous y autorise et aussi dans les domaines qui s’imposeront comme essentiels à notre plein développement. En conséquence, notre but ne doit pas se limiter à la récupération de droits acquis. Il doit viser aussi à en conquérir de nouveaux.” »
Selon Pierre Godin, « Daniel Johnson, c’est ce type de politicien qui fait florès à chacune de ses randonnées électorales, en dépit de l’image du vilain gravée par les médias dans les subconscients. Son approche ne laisse personne indifférent. Il charme et désarme ceux qui, dans la foule, se préparent à formuler des objections. Johnson rencontre chacun sur son terrain et possède l’intelligence du contact humain. À un intellectuel, il parle en intellectuel, à un ouvrier en ouvrier et à un rural en rural. Dès qu’on lui donne la main, “Danny Boy” s’estompe. Mais le député de Bagot a beau être doué, il fait face à une formidable armada. Au début du mois de septembre, le vent tourne à son désavantage. Bertrand avec son regard triste d’épagneul qui s’anime dès qu’il s’aperçoit qu’on se sent bien en sa compagnie, Bertrand avec ses airs de jeune collégien en vacances, Bertrand qui vous regarde droit dans les yeux comme le boy-scout qui attend sa corvée, Bertrand, après seulement quinze jours de campagne, sème la consternation dans le clan adverse. »
Les médias en ajoutent. André Laurendeau dit : « Son discours à Cowansville ne ressemble aucunement à ceux que débitent d’ordinaire les partisans de l’Union nationale. C’est un texte rafraîchissant. » et Gérard Filion : « Il possède une réputation de bon sens et de sagesse. On ne l’a jamais regardé comme un arriviste. Surtout, il se pose en réformateur ; sa victoire aurait le sens d’une restauration de l’Union nationale. » Pierre Godin écrit : « Même l’organe officiel de l’Union nationale, le Montréal-Matin, penche trop du côté de Bertrand. Johnson s’en plaint auprès de la direction du quotidien. […] Bertrand, un mythe ? Bertrand, une créature des médias ? Les journalistes ne se posent même pas la question. Dans le paysage désolant de l’Union nationale, ils ont cru apercevoir un homme neuf qui expose des idées neuves, sans louvoyer comme “Danny Boy”. Séduits par ce personnage qui respire la candeur et l’honnêteté, les journalistes oublient de jauger sa valeur. On colle à Bertrand l’image d’un réformateur et d’un duplessiste réactionnaire. »

Page trois du journal Le Devoir. 5 septembre 1961.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Les 21, 22 et 23 septembre 1961, l’Union nationale tient ce premier congrès au Colisée de Québec. Les 2 000 délégués ont une triple responsabilité : choisir un nouveau chef, choisir un nouveau programme et donner des structures plus démocratiques au parti. En tout, six candidats se présentent. Deux retiennent l’attention : Jean-Jacques Bertrand et Daniel Johnson. On compte également les candidats Yves Gabias (député de Trois-Rivières), Maurice S. Hébert (avocat de Montréal), Raymond Maher (avocat de Québec, défenseur de Wilbert Coffin lors de son procès) et Armand Nadeau (maire de Sherbrooke). Gabias et Hébert ont retiré leur candidature juste avant le vote.
Vien et Lapointe expliquent qu’il « faut bien avouer que pour certains délégués, la lutte passionnante, haletante même, que se livrent le député de Bagot et celui de Missisquoi suscite un intérêt plus vif que l’étude des résolutions qui seront présentées le lendemain au cours de l’assemblée générale. Jusqu’à la dernière minute, jusqu’au dévoilement du nom de l’élu, la tension est grande : nul ne peut prédire les derniers résultats. »
Benoit Gignac rapporte ainsi, dans Le Destin Johnson, les écrits de Louis La Rochelle : « Le congrès s’ouvre le 21 septembre. Dans la soirée, les congressistes entendent les hommages qu’on rend aux mânes du parti. Le lendemain, on dit qu’ils s’occupent à débattre du nouveau programme. La nuit du 22 au 23, qu’on a décrite à tort comme une “nuit des longs couteaux”, est au contraire bien agréable. Les états-majors des deux candidats rivalisent de délicatesses à l’égard des congressistes. Dans les chambres d’hôtel, l’alcool coule à flots et mille et une douceurs sont offertes. Au petit matin, des inconnus font circuler dans les couloirs du Château Frontenac un éditorial du Devoir qui flétrit le nom de Johnson et qui exprime une nette préférence pour la candidature de Bertrand. En après-midi, les deux candidats s’exécutent sur le parquet du congrès. Daniel Johnson prononce un discours vigoureux, tout entier dirigé contre le gouvernement libéral dont il accuse les membres de “s’être sauvés en Europe”. Il attaque les idées “socialistes” du gouvernement et dénonce le principe selon lequel les gouvernements doivent enlever de l’argent à tout le monde, même aux pauvres, pour en donner à tout le monde, même aux riches. Jean-Jacques Bertrand se préoccupe surtout de l’avenir du parti. “La démocratie, criera-t-il, nous en avons soif !” »
Vien et Lapointe décrivent que « le samedi 23 septembre, 13 000 personnes attendent avec impatience, au Colisée de Québec, les résultats lorsque, à 10 heures du soir, M. Jean Rivard annonce élu chef de l’Union nationale le député de Bagot Me Daniel Johnson. Il obtenait la faveur des délégués par 1 006 voix alors que Me Jean-Jacques Bertrand en récoltait 912, que le maire de Sherbrooke, Me Armand Nadeau, en recueillait 24 et que l’avocat Raymond Maher se contentait de deux voix. […] Le scrutin a duré deux heures et demie et 1 944 délégués ont déposé leur bulletin. » Bien que Johnson ait débuté sa campagne plusieurs mois avant Bertrand, il n’obtient qu’une majorité de 94 sur ce dernier.
Très déçu, Jean-Jacques Bertrand se rallie tièdement au vainqueur, cachant mal son amertume. Malgré son impatience de voir Johnson réformer le parti, Bertrand réitère au fil des mois, comme il le peut, son appui au chef. Les médias entretiennent la rumeur que Bertrand, avec le maire de Montréal Jean Drapeau et même le ministre libéral René Lévesque, allait former un nouveau parti indépendantiste. Bertrand fédéraliste convaincu n’a ni le goût ni l’énergie. Le doute est semé malgré tout.

Photographie de Jean-Jacques Bertrand (à gauche) et René Lévesque (à droite).
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Paul Henri Talbot

Photographie de Jean-Jacques Bertrand et son épouse Gabrielle à côté de Jean Drapeau, maire de Montréal. 29 août 1969.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Réal St-Jean
Élection québécoise de 1962
Pierre Godin raconte que « les élections ne sont pas encore engagées que Bertrand donne déjà du fil à retordre au chef unioniste. Roger Ouellet, passé au service de celui-ci, a convoqué tous les députés par télégramme. Un seul n’a pas daigné accuser réception : Bertrand. Il boude toujours dans son coin et hésite à se porter candidat. […] Bertrand est au bord de la retraite politique. »
Guay et Gaudreau rappellent que « deux semaines après avoir consulté ses ministres les 4 et 5 septembre 1962 lors d’une rencontre au lac à l’Épaule, dans la réserve faunique des Laurentides, le premier ministre libéral Jean Lesage annonce la tenue d’élections précipitées pour le 14 novembre. Sa justification : “demander au peuple du Québec un mandat péremptoire pour unifier les réseaux d’électricité de la province…” »
Pierre Godin ajoute : « Après l’annonce des élections, Jean Bruneau, qui aspire à la candidature dans Chambly contre Pierre Laporte, se rend chez Bertrand à Cowansville. On est à la veille du caucus de Matane. Gabrielle Giroux pense comme Bruneau : son Jean-Jacques ne doit pas fausser compagnie à son chef, malgré leurs différends. Bertrand se fait prier, puis cède comme toujours. À vingt-trois heures, il saute dans sa voiture avec Bruneau. Destination : le Château Frontenac où l’attend Daniel Johnson. Le député de Missisquoi veut connaître sa position au sujet de la nationalisation. Bertrand conduit comme un fou, passe à soixante miles à l’heure à travers Cowansville, se fait arrêter par la police, attrape une contravention puis file à toute vitesse vers la capitale provinciale. À une heure, les deux hommes prennent un verre avec Johnson. On cause de tout et de rien, puis Bruneau, se sentant de trop, se retire. Au petit matin, Bertrand revient dans la chambre où dort son compagnon, le tire de son sommeil et lui dit d’une voix pâteuse : “J’embarque ! Je serai candidat !”
Bertrand et son chef ne sont pas sur la même longueur d’onde au sujet de la nationalisation. Le premier l’accepte, le second, non. Mais Johnson lui a fait part du compromis qu’il soumettra au caucus de Matane. Bertrand peut s’en accommoder. Après un petit déjeuner avec Bruneau, le député de Missisquoi part pour Matane avec Johnson — sans brosse à dents ni rasoir ! À l’auberge Belle Plage, en bordure d’une mer déjà glaciale en cette fin de septembre, les thèses de Bertrand et de Johnson s’affrontent. […] Bertrand résume sa pensée : il faut dire oui à la nationalisation et forcer ainsi les libéraux à répondre de leur administration. Approuver l’étatisation, c’est jouer un bon tour à Lesage et le priver d’une partie de ses arguments, en plus de soutenir une mesure qui correspond aux intérêts nationaux des Québécois. Lesage doit craindre un oui unioniste, fait remarquer Bertrand. »
Guay et Gaudreau concluent que les unionistes sont « partagés sur la question de la nationalisation. Daniel Johnson adopte un compromis. Sous son gouvernement, deux compagnies seraient absorbées : la Northern Quebec Power et la Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent. La population se prononcerait ensuite par référendum sur le sort des neuf autres entreprises concernées. Cet enjeu, qui semble populaire, constitue une épine pour Johnson. En même temps qu’elle présente le premier programme en bonne et due forme de son histoire, le 24 octobre, l’Union nationale tente donc d’attirer l’attention sur le mandat libéral qui se termine. Sa carte maîtresse est la critique de la hausse des impôts et des taxes ainsi que des dépenses gouvernementales : “Ce n’est pas l’élection de la nationalisation, c’est l’élection de la taxation.” Afin de venir en aide aux contribuables touchés, Johnson s’engage à élever le seuil des exemptions d’impôt aux plus faibles revenus et à adopter un salaire minimum de 1 $ l’heure. »


Billet de 1 $ faisant la promotion de l'engagement électoral unioniste d'adopter le salaire minimum à 1 $ de l'heure. Union nationale. 1962.
Collection Dave Turcotte
Selon Guay et Gaudreau : « Au début de la campagne, les résultats demeurent imprévisibles. L’éclosion d’un présumé scandale le 3 novembre, l’affaire du vol des “faux certificats d’électeurs”, va cependant plomber les chances de l’Union nationale. Celui qui en est au centre, l’organisateur unioniste André Lagarde, sera éventuellement acquitté. Cette controverse place néanmoins les troupes de Daniel Johnson dans une situation inconfortable. Les fantômes du “vieux régime duplessiste” ne sont jamais bien loin, comme la rappelé le 1er août le premier rapport de la commission Salvas, chargée d’enquêter sur le favoritisme et la corruption sous le gouvernement unioniste, de 1944 à 1960. Il n’est pas facile de revamper l’Union nationale dans ce contexte. D’autant plus que, malgré la présence de 41 nouveaux candidats, celle-ci reste près des recettes qui ont fait son succès ».
Bertrand n’aide pas non plus à faire baisser la pression sur Johnson. Pierre Godin rapporte « “Coup de théâtre chez les étudiants de l’Université de Montréal, titre La Presse du 17 octobre. Jean-Jacques Bertrand déplore la démagogie de son chef.” Émoi chez les partisans unionistes. Quel croc-en-jambe au chef ! En pleine campagne électorale ! Pourtant, Bertrand a été plus habile que ça : il a mis Johnson et Lesage dans le même panier. À un étudiant qui le priait de commenter l’utilisation que faisait son chef de la religion, il a répondu : “Je dis qu’il se fait des déclarations teintées de démagogie dans les deux camps.” “Vous admettez donc que monsieur Johnson est un démagogue ?” Reprends l’étudiant, impulsif. Bertrand élève la voix et réplique en détachant chaque syllabe : “Comme monsieur Lesage, qui ne cesse de répéter par toute la province que l’Union nationale est un parti de traîtres et de lâches parce que nous n’adoptons pas l’étatisation dans notre programme.” Au début de la campagne, Bertrand est parti du pied gauche à cause de son appui à la nationalisation. Ses prises de position subséquentes au sujet des caisses électorales cachées ou de la pureté démocratique ont ajouté à l’épaisseur de la glace qui existe déjà entre lui et son chef. Bertrand passe son temps à faire l’éloge de Paul Sauvé, à associer son nom à la réforme et à la lutte contre le favoritisme. Un jour, à Bedford, il met son parti en garde (et son chef par ricochet) : “Ou bien les partis accepteront de se réformer ou bien ils tomberont.” Bertrand prend bien garde de toujours associer les libéraux aux unionistes et Lesage à Johnson quand il pose au redresseur de torts. Personne n’est dupe. Sa cible est le chef qui, parfois, s’emporte et lâche à ses collaborateurs : “Bertrand, je mets ça dehors !” Sa colère tombe vite, car Johnson connaît très bien les risques d’une pareille opération. »
Le 11 novembre a lieu le premier débat des chefs télévisé au Canada. Guay et Gaudreau précisent que « Lesage arrive frais et dispos, alors que Daniel Johnson a consacré peu de temps à sa préparation. Résultat : alors que ce dernier avait besoin d’une bonne prestation pour convaincre l’électorat, il semble plutôt nerveux face à un Jean Lesage qui, selon la plupart des journalistes, offre une meilleure performance. »
Le gouvernement libéral de Jean Lesage est réélu lors de l’élection du 14 novembre 1962. Obtenant son meilleur résultat depuis 1927, le Parti libéral fait élire 63 députés avec 56 % des votes et l’Union nationale, 31 députés avec 42 % des votes. Il y a un député indépendant.

Résultats de l'élection québécoise de 1962 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Pierre Godin constate que « paradoxalement, ce n’est pas le chef vaincu, mais plutôt Jean-Jacques Bertrand qui tient le loup par les oreilles au lendemain de la défaite. Ses élans vertueux l’ont poussé, durant la campagne, à dénoncer son chef. Il s’est même rangé dans le camp libéral en appuyant, sans équivoque, la nationalisation. Le ressentiment grandit contre lui. Pour plusieurs militants, il est le principal responsable de la défaite. Il a sacrifié les intérêts électoraux de l’Union nationale à sa mission de réformateur. »
Pierre B. Berthelot explique que « cette deuxième défaite fait très mal à l’Union nationale. Depuis le congrès de 1961, tout allait de mal en pis. Des partisans de Jean-Jacques Bertrand ne s’étaient toujours pas ralliés à Daniel Johnson après sa victoire, le jugeant encore trop rattaché au passé. Certains d’entre eux avaient même ouvertement appuyé les mesures des libéraux (notamment la nationalisation de l’hydroélectricité). Des problèmes d’argent et d’organisation avaient aussi forcé l’Union nationale à ne pas présenter des candidats aux élections partielles qui s’étaient tenues après la course à la chefferie — renforçant son image de parti en déroute. Pour tenter de trouver une solution, un nouveau congrès est convoqué en décembre 1962. Lors de l’événement, une dizaine de députés rencontrent Daniel Johnson en privé pour lui exposer leurs problèmes. Ils lui demandent d’abandonner son style de chef jugé dépassé, trop agressif — trop à la Duplessis. Johnson remercie ses députés pour leurs suggestions, mais n’en tiendra pas compte. »

Photographie de Jean-Jacques Bertrand. 13 août 1966.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Antoine Desilets
Bertrand au fédéral ?
Pierre Godin soutient que « les conservateurs fédéraux se cherchent un chef de file québécois, le nouvel organisateur du parti pour le Québec, le sénateur Jacques Flynn, caresse un grand rêve : ressusciter le Parti conservateur d’avant Duplessis. Vu d’Ottawa, l’avenir de l’U.N. paraît insignifiant. Duplessis avait raison quand il disait : “L’Union nationale mourra avec moi”. La discorde Bertrand-Johnson est en train de tuer le parti. Il faut donc, selon le sénateur Flynn, réformer au plus vite l’aile conservatrice du parti fédéral. Quel chef idéal ferait Bertrand ! À Ottawa, le nom de Johnson est maintenant tabou. Entre lui et Diefenbaker, les ponts sont coupés […]. L’honnêteté intellectuelle de Bertrand et son excellente réputation politique le désignent d’emblée pour être l’intermédiaire et le paravent francophone. C’est vrai qu’il n’a pas l’étoffe d’un vrai leader, l’ambition, le goût des manœuvres et des coulisses ou des palabres de congrès, mais cette faiblesse n’est pas irrémédiable.
Le 21 novembre, la Presse canadienne diffuse une nouvelle étonnante : Jean-Jacques Bertrand a accepté de rallier le cabinet du premier ministre Diefenbaker. À titre de ministre associé de l’Agriculture, il aura la responsabilité des questions agricoles pour tout l’Est du Canada. On précise même que le député de Missisquoi briguera les suffrages dans la circonscription de Stanstead, lors des prochaines élections fédérales qui sont imminentes. Le lendemain, Douglas Fisher, le bouillant député néo-démocrate qui repousse et aime à la fois le Québec, interroge le chef tory. Pour toute réponse, il reçoit un sourire tremblotant du parkinsonien Diefenbaker. De son côté, Bertrand nie la rumeur.
L’avocat de Sweetsburg s’est ravisé après être venu à un cheveu de faire le saut au fédéral. […] L’étoile politique de John Diefenbaker est à son déclin, après seulement quatre années de pouvoir. Ses chances de réélection sont trop minces pour que Bertrand joue avec lui son va-tout. Il va plutôt placer son chef au pied du mur sur la question du renouveau de l’Union nationale. Ses déboires électoraux auront peut-être enfin indiqué à Johnson l’inefficacité politique de ses épouvantails duplessistes.
Le 7 décembre, à une semaine du caucus, Bertrand tire dans le dos du chef absent. Le Hamlet de la scène provinciale, comme l’ont baptisé les journalistes, abat son jeu. Ce sera le renouveau ou sa démission ! “Johnson a un an pour répondre à mon ultimatum”, dit-il à Richard Daignault, de La Presse, qu’il a fait venir chez lui à Cowansville. Un an est la dernière limite, précise le député en accompagnant ses paroles d’un geste qui en dit long sur son impatience. Il est clair que si rien ne semble vouloir bouger dans le parti, il faudra agir beaucoup plus tôt, peut-être au bout de cinq ou six mois. […]
Bertrand sème le vent, il récolte la tempête. La veille du caucus, le quotidien La Presse titre : “On en veut à Bertrand.” La presse, en général, a fait grand état de sa mise en demeure. “C’est un coup bas !” ont dit aux reporters certains députés incapables de contenir plus longtemps leur impatience. Bertrand, le Lévesque de l’Union nationale ? On commence à le chuchoter dans le parti en remarquant cependant : “Qu’il lutte pour ses idées avec le parti, pas contre. Même René Lévesque n’a jamais fait ça !”
“Qu’il se range ou qu’il parte !” s’exclament certains. Et des vieux routiers de renchérir : “Bertrand, c’est un pur qui accuse tout le monde sans rien prouver et au moment où ça va mal dans le parti.” Comme Lévesque, il paraît prêt à compromettre l’avenir de sa formation pour imposer ses idées. Il veut le renouveau, dit-on, mais lequel ? Il ne l’a jamais précisé. Bertrand, c’est un pékinois qui jappe, mais ne mord pas et plusieurs aimeraient bien qu’il se taise. C’est aussi un éternel boudeur qui se sent persécuté. […]
À l’ouverture du caucus au Club Renaissance de Québec, le terrain est plus brûlant pour le contestataire Bertrand que pour le chef vaincu aux urnes. Bertrand est arrivé à la réunion une quinzaine de minutes avant Johnson. Il a tout de suite senti que la soupe est chaude. Au rez-de-chaussée, dans le hall du club, il y a la foule des jours J : photographes et journalistes supputent avec les organisateurs l’issue de l’affrontement Johnson-Bertrand. Le chef prend la parole le premier. Il a l’air parfaitement serein. Il analyse d’abord les grandes causes de la défaite, met l’accent sur les problèmes d’organisation à résoudre et fait appel à l’unité et à la bonne volonté de tous […].
Le débat s’engage et tourne vite à la polémique entre pro-Johnson et les pro-Bertrand. La vapeur monte dans la salle. L’Union nationale va-t-elle éclater ? Le caucus dure depuis à peine trente minutes que déjà, au rez-de-chaussée, un organisateur se promène parmi les journalistes en disant : Bertrand va quitter le parti. C’est une question de minutes… En haut, la tension est à son comble. Le député de Missisquoi a demandé la parole. Il explique d’un ton implacable ce qui le sépare de Johnson : personnalité, style, conception de la politique. Bertrand parle d’une voix forte et éloquente ; quand il est ému, il bute parfois sur une syllabe qu’il reprend en élevant légèrement le ton. Il exige que la direction du parti soit collégiale. Dans son esprit (et dans celui de Paul Dozois), le parti devrait être dirigé par un triumvirat composé de Johnson, de lui-même et de Dozois.
Bertrand dénonce ensuite vertement une résolution mijotée par certains députés et dont l’objectif est de le censurer. On l’a averti, avant le caucus, que des partisans de Johnson, imbus de la philosophie du “chef unique et absolu”, allaient soumettre à l’approbation des députés une motion voulant “que personne ne soit autorisé à parler au nom du parti sans que le texte ait été, au préalable, soumis à l’attention du chef”. “Je ne peux continuer à militer dans un parti qui m’impose de telles conditions”, lance soudainement Bertrand. “Je remets donc ma démission !”
Députés et candidats défaits restent bouche bée. On s’attendait à du brasse-camarade en règle et à des prises de bec acerbes entre le chef et son rival ; on s’attendait à tout, mais pas à ce que Bertrand jette sa démission sur la table. Pourtant, Johnson ne paraît pas du tout surpris. Il retire ses lunettes et dit, feignant l’étonnement : a-t-il quelqu’un ici qui veut imposer le silence à mon lieutenant ? Dans la salle tendue, des voix font : “non… non…” Johnson regarde Bertrand : “Votre décision est-elle irrévocable ?” “Oui, elle est irrévocable !” Répond l’enfant terrible avant de se rasseoir.
L’intervention du chef déclenche un feu roulant de suppliques politiques sur l’air de “Jean-Jacques, ne nous fais pas cela !” […] Mais c’est surtout la magistrale envolée (“Si vous partez, c’est la fin de l’Union nationale…”) de Gabriel Loubier, nouveau député de Bellechasse, qui le fait chavirer. Celui-ci lui demande également de se ranger, une fois pour toutes, sous la bannière du chef élu par le congrès. Homme sensible et droit comme une épée malgré ses improvisations souvent maladroites, Jean-Jacques Bertrand revient sur sa décision : “Je ne maintiens pas ma démission”, dit-il sous les applaudissements nourris du caucus. […]
Le manœuvrier hors pair nommé Daniel Johnson vient tout simplement de rouler son lieutenant et celui-ci n’y a vu que du feu. Avant le caucus, Johnson a en effet appris que Bertrand se présenterait avec sa lettre de démission en poche. Ses proches lui avaient mis en tête que le caucus le tiendrait responsable de la défaite électorale et que le chef exigerait son départ à la suite de son ultimatum. Aussi, Bertrand voulait-il aller au-devant des coups en démissionnant. Fidèle à la maxime de Louis XI — celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner —, Johnson simule la surprise, fait retirer la motion de censure envisagée par certains députés et ne commet surtout pas l’erreur de museler Bertrand. Il le laisse se vider cœur. […]
Pendant le dîner qui suit le caucus, les deux protagonistes de ce mariage de raison qui dure depuis près de quinze ans font la paix, une fois de plus. Johnson consultera plus fréquemment Bertrand qui s’engage, en retour, à modérer désormais ses propos. Accord combien fragile — l’avenir le prouvera. »

Cette photographie a été prise à l'adoption d'une loi d'urgence afin de permettre la reprise du service des traversiers entre Québec et Lévis lors de l'ouverture et de la prorogation de la session spéciale (5e session de la 27e législature) du 22 octobre 1965.
Photographie du chef de l'opposition Daniel Johnson parlant avec son député Jean-Jacques Bertrand à l'Assemblée législative du Québec. Photo moderne enrg. 1965.
Collection Assemblée nationale du Québec
Assises de 1965
Pierre B. Berthelot affirme que « les changements commencent en décembre 1964. Loin des regards indiscrets, Daniel Johnson se réunit avec ses députés dans un hôtel à Mont-Gabriel, dans les Laurentides, afin de discuter d’une nouvelle orientation pour le parti, plus au diapason avec l’opinion publique et le nouveau nationalisme montant. Les débats sont très vifs. Les reproches faits au chef sont particulièrement durs. Après de longues discussions, Daniel Johnson finit par se réconcilier avec Jean-Jacques Bertrand et ses partisans, mettant fin à des années de conflits. Avec son autorité retrouvée, Daniel Johnson accepte cependant une nouvelle réalité. Johnson confie alors à ses collègues Mario Beaulieu et Marcel Masse la tenue d’un événement qui marquera un tournant dans l’histoire de l’Union nationale, et qui amorcera sa remontée : les assises de 1965. »
Les 19, 20 et 21 mars 1965, l’Union nationale tient de grandes assises d’orientation à Montréal. Albert Gervais décrit ce congrès ainsi : « Un triduum idéologique qui met l’Union nationale à l’heure de la modernité. Un tournant décisif pour le parti, qui propose à tout le Québec une plate-forme politique calquée sur les espoirs et les aspirations des Québécois. Trois mille militants discutent en ateliers, puis en sessions plénières, sur les questions et problèmes d’une société en profonde mutation. Toutes les séances de délibérations sont ouvertes à la presse qui, agréablement étonnée, fait largement écho à ce qui se passe dans l’Union nationale. […] Des intervenants issus d’horizons les plus variés de la pensée québécoise répondent à l’invitation du parti, et leur message est franc, parfois même provocant. C’est de cette marmite d’opinions et des résolutions qui émaneront de cette retraite doctrinale que le parti élaborera son menu électoral. Fouetté par le succès inespéré de ces assises et par les éléments de réforme qu’il y décèle, Jean-Jacques Bertrand ajoute encore à l’enthousiasme des participants par une profession solennelle de fidélité au parti et au chef. »
Jacques Benjamin ajoute que ce « congrès ne devait pas être perçu comme une foire, l’entrée de l’hôtel Reine-Élisabeth aurait l’air d’une bibliothèque, et les journalistes ne devraient pas trouver plus de dix délégués à chaque bar de l’hôtel au moment des séances de travail. Il fallait donner l’image d’assises sérieuses. Mario Beaulieu (conseiller de Daniel Johnson) insista sur ce point : il s’agissait d’un congrès où, pour la première fois, un parti se réunissait pour d’autres raisons que la nomination d’un leader. “C’est pas un party, crisse, passez le mot”, répétait-il à ses collaborateurs. On ferait du hall d’entrée une bibliothèque, “parce que, dans une bibliothèque, instinctivement on baisse la voix”. La librairie Leméac ferait un étalage de “livres sérieux” (ouvrages économiques, politiques) ; de plus, des discours des leaders du parti seraient polycopiés et disposés sur des étagères. […] Il exigea en outre que les délégués assistent aux séances de travail. […] Des membres influents du parti avaient été chargés de rappeler aux délégués qui s’attardaient aux bars que “Daniel (Johnson) ne veut pas donner mauvaise impression”. »

Photographie de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand accompagnés du ministre Paul Dozois au micro et de Mario Beaulieu. Entre 1961 et 1968.
Collection Roger Ouellet

Photographie de la réconciliation entre Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand lors des Assises. 21 mars 1965.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Jean-Yves Létourneau
Élection québécoise de 1966
« En 1962, le premier ministre du Québec, Jean Lesage, fait de la nationalisation de l’électricité un enjeu électoral… et il gagne son pari. Quatre ans plus tard, il adopte une stratégie semblable. Cette fois-ci, il demande l’appui de la population du Québec dans la bataille qu’il s’apprête à livrer contre le gouvernement fédéral sur la délicate question d’un nouveau partage de la fiscalité. Confiant, Lesage affirme être assuré que les Québécois le porteront au pouvoir une troisième fois. Mais voilà, la situation est différente de celles de 1960 et de 1962. La belle unanimité qui régnait au sein du Parti libéral lors des deux élections précédentes s’est dissipée. Les députés vedettes René Lévesque et Paul Gérin-Lajoie demeurent en retrait. Aussi impressionnantes soient-elles, les réformes réalisées par le gouvernement libéral depuis 1960 ont coûté extrêmement chères. Par conséquent, la dette par habitant a plus que doublé au Québec en à peine quelques années, ce qui vaut à Lesage le surnom de “Ti-Jean la taxe”. Enfin, les Libéraux sont accusés de “vouloir sortir les crucifix des écoles” après que quelques-unes des recommandations du quatrième tome du rapport Parent sur l’éducation soient rendues publiques.
Le parti de l’Union nationale, le grand adversaire du Parti libéral, a tiré des leçons des défaites de 1960 et de 1962. Elle se réorganise, se rajeunit, et son chef, Daniel Johnson, a plus d’aplomb. Son slogan lors de la campagne de 1966 est “Québec d’abord” et son programme est en partie axé sur l’affirmation du Québec. » - Exposition Le début d’un temps nouveau du Musée québécois de la culture populaire
L’élection de 1966 marque le début de la présence de partis indépendantistes dans le paysage électoral québécois : le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), dirigé par Pierre Bourgault et le Ralliement national (RN), dirigé par Roger Jutras et Laurent Legault. Avec ces nouveaux partis et le fameux livre « Égalité ou indépendance » de Daniel Johnson, c’est sans doute la première fois où la question nationale s’invite autant dans une élection québécoise. Johnson va même jusqu’à déclarer : « S’il s’avère un jour que l’indépendance reste la seule option compatible avec l’épanouissement normal de la nation canadienne-française, je serai d’accord, ce jour-là, avec ceux qui prêchent cette solution. »
Fédéraliste convaincu, cette nouvelle donne fait hésiter Bertrand à se représenter. Pierre Godin écrit : « Depuis les assises de mars 65, Jean-Jacques Bertrand file doux. Il a mis l’épaule à la roue pour la relance du parti et l’élaboration du programme. Il s’est rallié, bien sûr, mais, entre lui et Johnson, le malaise persiste. Bertrand éprouve encore parfois l’envie de brûler la politesse à son chef et de se retirer définitivement sur ses terres. Sa démission, si elle survenait avant les élections, priverait automatiquement l’Union nationale de la moindre chance de battre les rouges. Il a si souvent juré, dans le passé, de partir le jour où son chef trahirait sa promesse de démocratiser le parti qu’en le faisant à un tel moment il torpillerait la toute nouvelle crédibilité politique de Johnson. […] Mais ce n’est pas encore cette fois que Jean-Jacques Bertrand pourra réaliser son grand rêve d’une vie tranquille à la campagne, loin des marais de la politique. Contre toute attente, en effet, ce sera Antonio Barrette, chef démissionnaire et déchu de 1960, qui le forcera, en quelque sorte, à se présenter pour défendre son intégrité. […] L’entourage du chef a appris entre les branches que le livre, qui réserve, paraît-il, de très mauvaises surprises à Bertrand et peut-être même à Johnson, sera lancé en pleine campagne électorale. Une belle vengeance, quoi ! Barrette n’a jamais digéré la façon cavalière dont l’avaient traité les hautes instances du parti, en 1960. On peut donc tout craindre de son livre ! Quant au député de Missisquoi, s’il choisit de prendre sa retraite politique, n’aura-t-il pas l’air de fuir ? »
Bertrand fait donc le choix de briguer de nouveau les suffrages dans sa circonscription de Missisquoi. Contrairement aux rumeurs, les mémoires de Barrette furent un pétard mouillé. Elles sont vite oubliées.
Guay et Gaudreau rapportent : « Comme les libéraux, Johnson parle de construire une autre université francophone et d’abolir le Conseil législatif. Il veut aussi récupérer de l’argent à Ottawa, exigeant 100 % de l’impôt sur le revenu, sur les entreprises et des droits de revenu. L’Union nationale a tiré des leçons de 1962. […] Tout en tendant des perches aux Montréalais, Johnson cherche aussi à rallier les ruraux, son électorat traditionnel, qui se “sentent subitement négligés par un gouvernement dont les assises populaires et les grandes politiques visent d’abord les villes”. Ses promesses, comme celle de hausser le seuil pour les exemptions d’impôt, et ses discours s’adressent particulièrement à eux, aux travailleurs à faibles revenus et aux conservateurs sociaux. […] Pour l’électorat ciblé par l’Union nationale, la création du ministère de l’Éducation et les changements au système d’enseignement sont aussi de grands enjeux. Évoquant le spectre de l’explosion des coûts, le “péril jaune” (une allusion aux autobus scolaires qui amènent les enfants dans les écoles) ainsi que la perspective de “sortir le crucifix des écoles”, Daniel Johnson somme le premier ministre de se prononcer sur les tomes 4 et 5 du rapport Parent dont le contenu est dévoilé en pleine campagne. En plus de se défendre de déconfessionnaliser le réseau scolaire, Lesage réplique : “Certains répètent que l’éducation coûte cher. Mais rien ne coûte plus cher que l’ignorance.” »
Guay et Gaudreau analysent ainsi cette élection : « Les analystes ne s’emballent pas pour cette élection […] et cette campagne “plutôt terne” au cours de laquelle aucun des chefs de parti n’a réussi à lancer et à exploiter une idée maîtresse qui colle à la réalité quotidienne… Aussi, plusieurs téléspectateurs s’étonnent lorsque, le 5 juin au soir, ils assistent à une soirée électorale passionnante. Le résultat reste en effet dans la balance pendant plusieurs heures avant que la surprise ne devienne officielle. »
Le gouvernement libéral de Jean Lesage est défait lors de l’élection du 5 juin 1966. L’Union nationale fait élire 56 députés avec 41 % des votes, le Parti libéral, 50 députés avec 47,2 % des votes et deux députés indépendants sont élus. Le vote indépendantiste, divisé entre le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) et le Ralliement national (RN), est de 8,8 %.
L’écart entre le nombre de députés unionistes et libéraux est bien plus serré que celui du nombre de votes qui favorise largement le Parti libéral. Tellement, que le premier ministre Jean Lesage remet en doute, pendant quelques jours, l’issu du résultat de cette élection. Jean Lesage se rend finalement au verdict populaire et Daniel Johnson est assermenté premier ministre du Québec le 16 juin 1966.
...
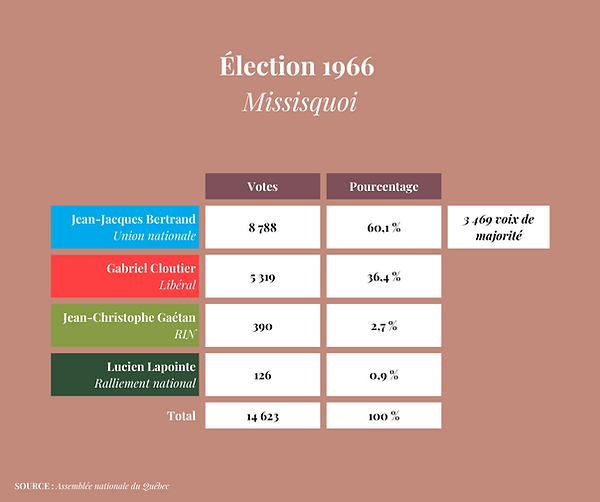
Résultats de l'élection québécoise de 1966 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
L'OPPOSITION
1960

Mosaïque des députés de l'Assemblée législative du Québec. 1960.
Collection Dave Turcotte
1961


Disque de la chanson-thème du congrès de l'Union nationale des 21, 22 et 23 septembre 1961.
Collection Dave Turcotte



Dépliant « Vers l'avenir !!! On ne se trompe pas avec Bertrand » du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1961.
Assemblée nationale du Québec
Fonds Jacques et François Trépanier

Pochette d'allumettes du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1961.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Macaron du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1961
Provenant d'une collection privée

Macarons du candidat à la chefferie Daniel Johnson. Union nationale. 1961
Provenant d'une collection privée

Macaron du candidat à la chefferie Daniel Johnson. Union nationale. 1961.
Collection Dave Turcotte

Macarons du candidat à la chefferie Armand Nadeau. Union nationale. 1961
Provenant d'une collection privée

Photographie des candidats à la chefferie Jean-Jacques Bertrand, Daniel Johnson et Armand Nadeau. 1961.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
Photographe : André Hébert
1962

Photographie de Jean-Jacques Bertrand faisant un discours lors d'une assemblée électorale. 1962.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Yves Beauchamp

Publicité de l'Union nationale. Journal La Tribune. Page 5. 12 octobre 1962.
Collection Dave Turcotte

Publicité de l'Union nationale. Journal Le Soleil. Page 13. 10 novembre 1962.
Collection Dave Turcotte

Publicité du Parti libéral du Québec. Journal L'Écho de Louiseville. 25 octobre 1962.
Collection Dave Turcotte

Mosaïque des députés de l'Assemblée législative du Québec. 1962.
Collection Dave Turcotte
1963

Selon Wikipédia, « À l'Assemblée législative du Québec en mars 1963 le député Jean-Jacques Bertrand dépose une motion « en vue de constituer un comité spécial pour préparer la convocation des États généraux canadiens-français ». Déjà, en 1962, il avait fait inscrire au programme électoral de son parti, l'Union nationale, son intention d'organiser des États généraux. Voulant aussi occuper le terrain de l'orientation nationale, le Parti libéral de Jean Lesage, alors au pouvoir à Québec, instaure un Comité parlementaire sur la constitution. Il s'agissait à la fois de damer le pion à Bertrand et à l'Union nationale, en plus de s'assurer que des questions aussi graves que l'avenir de la nation soient débattues par les élus du peuple et non par des associations communautaires non élues. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale voit lui aussi d'un mauvais œil la motion de Jean-Jacques Bertrand. Le RIN accuse l'Union nationale de vouloir plaire aux sociétés nationales et aux corporations et d'agir avec des visées purement électoralistes. »
Page une du journal Le Temps. Volume 24, numéro 10. 14 mars 1963.
Collection Dave Turcotte

Discours prononcé le 8 mai 1963 à l'Assemblée législative par Jean-Jacques Bertrand concernant la formation d'un comité spécial.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
1965


Rubans d'un participant aux Assises générales de l'Union nationale des 19, 20 et 21 mars 1965 à Montréal.
Collection Dave Turcotte
1966

Publicité de l'Union nationale. Journal Le Soleil. 4 juin 1966.
Collection Dave Turcotte

Publicité de l'Union nationale. Journal Dimanche-Matin. 5 juin 1966.
Collection Dave Turcotte

L'écart entre le nombre de députés unionistes et libéraux est bien plus serré que celui du nombre de votes qui favorise largement le Parti libéral. Tellement, que le premier ministre Jean Lesage remet en doute, pendant quelques jours, l'issu du résultat de cette élection.
Une du journal La Presse. 6 juin 1966.
Journal La Presse
Le gouvernement
Nommé ministre de l'Éducation
Nommé ministre de la Justice
Jean-Jacques Bertrand est assermenté ministre de l’Éducation et ministre de la Justice le 16 juin 1966. Le premier ministre Johnson lui ajoute la charge de vice-président du Conseil exécutif le 17 juin 1966. Bertrand agit donc à titre de ce qu’on qualifie aujourd’hui de « vice-premier ministre ». Au fil du temps, Johnson considère que Bertrand néglige l’important ministère de l’Éduction. Dans les faits, Bertrand s’intéresse davantage au ministère de la Justice. Le 31 octobre 1967, Johnson procède à un remaniement et soulage ses vétérans, dont Jean-Jacques Bertrand. C’est le notaire Jean-Guy Cardinal, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal qui hérite de l’Éducation. Pierre Godin relate que « Jean-Jacques Bertrand s’est définitivement assagi et se consacre entièrement à la Justice. Ses relations avec le chef se sont améliorées. Il confie même à des intimes comme Jean Bruneau, l’un de ses conseillers : « Ça va bien avec Daniel. Tout est oublié. Je fais un bon second, mais peut-être n’aurais-je pas fait un bon premier comme lui. » »






Ces photographies sont extraites d'un album souvenir qui aurait appartenu à l'un des ministres du cabinet de Daniel Johnson.
Photographies de l'assermentation du conseil des ministres du premier ministre Daniel Johnson et d'un rassemblement pour célébrer l'occasion. 1966.
Collection Dave Turcotte
L’Université du Québec
C’est à titre de ministre de l’Éducation que Jean-Jacques Bertrand met la table à ce qui deviendra l’Université du Québec. C’est à titre de premier ministre du Québec qu’il concrétisera ce projet. Il est important de souligner la contribution de Jean-Guy Cardinal qui sera ministre de l’Éducation dans les derniers mois du gouvernement Johnson ainsi que durant le mandat du gouvernement Bertrand.
Stéphanie Massé explique que « lors d’une séance du Conseil supérieur de l’éducation à l’automne 1967, le ministre Jean-Jacques Bertrand énonce les deux priorités suivantes : la formation des maîtres et l’enseignement supérieur. Un comité directeur est constitué avec, en outre, le mandat de “prévoir l’intégration de la formation des maîtres à l’appareil universitaire, de prévoir la création d’une nouvelle université de langue française à Montréal, d’étudier la création de centres universitaires à Trois-Rivières, Chicoutimi et Rimouski”. »
Maintenant devenu premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand dépose, le 5 décembre 1968, le projet de loi 88 sur l’Université du Québec. Stéphanie Massé précise que c’est « lors de la deuxième lecture, le 9 décembre, qu’il livre à la Chambre un discours substantiel dans le cadre duquel sont posés les jalons de ces nouvelles universités, et universités nouvelles, qu’il s’autorisera à déclarer comme “celles de l’an 2000”. »
Stéphanie Massé ajoute : « Au crépuscule de la Révolution tranquille, dans une population québécoise qui marque un retard important en termes de fréquentation scolaire et dont l’accroissement démographique pendant les années 50 s’est accéléré, ces établissements nouveaux d’enseignement et de recherche publics, laïcs et hors des grands centres allaient permettre à des générations nouvelles d’accéder à des études supérieures, de poursuivre des aventures intellectuelles et de doter le Québec d’un bassin grandissant et diversifié de matières grises essentielles au plein déploiement de toutes les sociétés humaines. »
Stéphanie Massé donne la parole au premier ministre Bertrand, à l’aide d’extraits de son allocution prononcée le 9 décembre 1968 à l’Assemblée législative. En voici quelques-uns divisés en thématiques :
« En proposant à la Législature l’adoption du bill 88 portant sur la création de l’Université du Québec, le gouvernement a conscience de poser un acte capital pour le développement du système scolaire et pour le progrès de la société québécoise tout entière. »
Les raisons qui motivent le gouvernement
« La création de l’Université du Québec coïncide avec le début d’une explosion démographique considérable au niveau universitaire, par suite des grands progrès réalisés au cours des dernières années au niveau secondaire et au niveau collégial. Au cours des dix prochaines années, les inscriptions au niveau universitaire doubleront, passant de 45 000 à 90 000. Pour absorber ce grand nombre d’étudiants, il est clair qu’il faille créer de nouvelles universités. En même temps, il faut envisager la décentralisation géographique des services d’enseignement supérieur dans la Mauricie, le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent. Enfin, la création de l’Université du Québec coïncide avec l’opération de rapatriement de la formation des maîtres dans des institutions universitaires ayant une assise plus large, une activité plus diversifiée et des ressources plus considérables que celles des écoles normales actuelles. »
L’organisation interne décentralisée de l’UQ : l’importance de l’ancrage régional
« En proposant cette décentralisation interne, nous n’avons pas en vue uniquement des objectifs d’efficacité administrative. Nous voulons permettre et assurer un réel enracinement des unités constituantes dans leur propre milieu géographique, économique, social et culturel. L’on voit ici la ressemblance quant à l’organisation avec ces collèges d’enseignement général et professionnel que nous avons créés l’an dernier [les CÉGEPS]. Nous voulons permettre et assurer une participation directe des milieux intéressés à l’administration et au développement des services d’enseignement supérieur de l’Université du Québec, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, à Rimouski, à Montréal, par exemple. »
Les universités de l’an 2000 : de nouvelles universités qui sont des universités nouvelles…
« Cependant, nous voudrions que ces nouvelles universités soient également des universités nouvelles, construites et organisées selon des règles correspondant aux besoins des étudiants, des professeurs et des chercheurs tels qu’on peut les identifier en cette seconde moitié du vingtième siècle. »
« Il est certain — et tous en conviendront — que le fait de préparer la création de nouvelles universités permet d’envisager des formules nouvelles, des formules originales, un mode d’organisation interne plus souple, qui tiennent compte de la rapidité et de l’évolution des connaissances et de leur mode de transmission. On note, par exemple, chez de nombreux universitaires de tous les pays la volonté de se dégager de la structure traditionnelle des facultés, issues d’une époque où les universités constituaient des fédérations d’écoles professionnelles. »
« Les universités que nous établirons au cours des prochaines années seront celles de l’an 2000. Elles accueilleront, compte tenu du développement du système scolaire et de l’éducation permanente, de nouveaux types d’étudiants. »
Trois fonctions
« D’abord, le premier cycle. Ce cycle sera caractérisé par deux traits principaux. Le très grand nombre des inscriptions, d’une part, la diversité importante des orientations des étudiants. De plus, le premier cycle universitaire sera le lieu, au cours des prochaines années, d’innovations dans les programmes correspondant à de nouvelles catégories de diplômés, répondant à de nouveaux débouchés sur le marché du travail. »
« Deuxièmement, les études graduées. Au niveau des études graduées, par ailleurs, on nous recommande, en plus de la recherche qui s’effectuera dans les départements, l’aménagement de centres de recherche groupant des équipes multidisciplinaires de professeurs auxquels participeraient directement les étudiants en cours de maîtrise ou de doctorat. »
« Troisièmement, l’éducation permanente. En ce qui concerne l’éducation permanente, nos groupes de travail font valoir qu’elle marquera de plus en plus les activités et l’organisation interne des universités. Contrairement à la situation qui prévaut actuellement, la clientèle de l’éducation permanente ne sera pas uniquement à la recherche d’un premier diplôme universitaire. […] Autrement dit, l’on abandonnera l’éducation des adultes de type récupération pour passer à l’éducation permanente de type perfectionnement. »
Une organisation académique inouïe
« En éliminant le cadre rigide des facultés comme on les connaît à l’heure actuelle dans plusieurs universités, nous voulons surtout assurer une mobilité horizontale des professeurs et des étudiants. En proposant que le département constitue la cellule de base de l’université, nous voulons permettre surtout aux professeurs de former des équipes de chercheurs et d’enseignants réunis par un intérêt commun dans une discipline donnée. En proposant la structure modulaire, nous voulons offrir aux étudiants de premier cycle une structure d’encadrement susceptible de développer leur sentiment d’appartenance et leur motivation. »
Conclusion
« L’Université du Québec est un organisme qui marquera l’avenir de la collectivité québécoise. Dans l’immédiat, elle permettra de créer de nouveaux établissements universitaires, de décentraliser en diverses régions les services d’enseignement supérieur, de donner à la formation des maîtres un cadre nouveau, un souffle nouveau et un statut universitaire et d’aménager au Québec l’université nouvelle dont nous avons besoin pour répondre aux exigences de notre développement.
À moyen terme, l’on peut envisager que l’Université du Québec réalisera plus que cela.
Elle peut devenir l’un des plus importants de nos instruments collectifs de développement, comme le sont l’Hydro-Québec, la Société générale de financement, la Caisse de dépôt et placement. Dès le départ, il faudra compter que le dynamisme des universités constituantes, nouveaux établissements en plein développement, apportera à l’Université du Québec un élan considérable.
Mais l’on doit aussi envisager que l’Université du Québec prépare la mise sur pied d’instituts de recherche à vocation provinciale. Ceux-ci pourront devenir le point d’appui des activités de recherche du gouvernement, des entreprises et de toutes les universités qui voudraient y collaborer.
M. le Président, si l’Université du Québec pouvait réussir à constituer le point de jonction du monde universitaire, de l’entreprise et du gouvernement, à propos de recherches qui engagent l’avenir du Québec elle aura apporté une contribution capitale à l’édification d’un Québec fort et dynamique. »
Le 18 décembre 1968, le projet de loi 88 est adopté à l’unanimité des parlementaires après neuf jours de débat. L’Université du Québec est née avec trois constituantes — l’UQAM (Montréal), l’UQAC (Chicoutimi) et l’UQTR (Trois-Rivières). Avec le temps, sept autres vont s’ajouter : ENAP (École nationale d’administration publique) et INRS (Institut national de la recherche scientifique) en 1969 ; UQAR (Rimouski) en 1973 ; ÉTS (École de technologie supérieure) en 1974 ; UQO (Outaouais) en 1981 ; UQAT (Abitibi-Témiscamingue) en 1983 ; l’Université TÉLUQ en 1992.
Cependant, Lucia Ferretti écrit que « l’Université du Québec est née à la fin d’une époque », « Dès 1970, en effet, poursuit-elle, le gouvernement du Québec propose à la société québécoise un modèle de développement en rupture profonde avec celui qui avait dominé les années 60 et conduit à la création d’un réseau public décentralisé d’établissement d’enseignement supérieur. Voué au “progrès du Québec” plutôt qu’à la promotion nationale des francophones, le nouveau gouvernement [de Robert] Bourassa accorde moins de foi que ses prédécesseurs unioniste et libéral aux grandes institutions publiques, à l’éducation, au développement régional et aux intellectuels, et davantage à l’entreprise privée, à la santé, aux projets hydroélectriques d’envergure et aux milieux d’affaires. À peine née, c’est donc sans soutien que l’Université du Québec doit assumer ses missions fondamentales ».


Photographies de Jean-Jacques Bertrand en rencontre avec les supérieurs des collèges classiques. 13 octobre 1966.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Réal St-Jean
Vive le Québec libre !
Moment marquant de cette époque est l’Expo 67 et la visite en grande pompe du président français. Peu friand du protocole et de la diplomatie, la visite du général Charles de Gaulle n’enthousiasme guère Bertrand. Il l’est encore moins après son célèbre « Vive le Québec libre ! » qu’il prononce sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal le 24 juillet 1967. Il est cependant nécessaire de préciser que Bertrand représente une circonscription où 30 % des électeurs sont anglophones. Cette déclaration n’a clairement pas la même résonnance pour les francophones et les anglophones du Québec.
LE GOUVERNEMENT

Photographie de Jean-Jacques Bertrand.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
Photographe : Majo (Harvey Majeau)

Photographie officielle de Jean-Jacques Bertrand. 1966.
Collection Assemblée nationale du Québec
Photographe : Cecile Weedon


Photographies du Palais de justice de Cowansville, situé dans la circonscription de Jean-Jacques Bertrand et qui porte son nom.
Collection Dave Turcotte

Photographie de presse illustrant un homme installant des drapeaux du Québec et de la France devant l'Assemblée législative du Québec en vue de la visite du général Charles de Gaulle. 21 juillet 1967.
Collection Dave Turcotte

Photographie de presse illustrant des attroupements le long de la visite du général Charles de Gaulle sur le chemin du Roi. 24 juillet 1967.
Collection Dave Turcotte

Photographie de presse illustrant la visite du général Charles de Gaulle sur le chemin du Roi à Donnacona le 24 juillet 1967 en présence du premier ministre québécois Daniel Johnson. C'est rendu à Montréal qu'il prononce son célèbre Vive le Québec libre !
Collection Dave Turcotte

Le premier ministre
Ayant une santé fragile, Daniel Johnson réfléchit à sa succession. Après une de ses crises cardiaques, Johnson a laissé entendre à quelques intimes : « Bertrand pour la transition, puis Cardinal ». Pour tenter d’en finir avec sa convalescence, Johnson se rend dans les Bermudes en septembre 1968 pour se remettre en forme. Pierre Godin avance qu’avant « de rentrer au Québec, il fait venir Mario Beaulieu à Hamilton (capitale des Bermudes). Au cours du dîner pris en commun, le chef demande à brûle-pourpoint : “Si je mourais, qui me remplacerait ?” Beaulieu avale sa bouchée de travers, réfléchit quelques instants, puis répond : “Masse est trop jeune. Cardinal manque d’expérience. Les vieux du parti comme Maurice Bellemare ne les accepteront jamais. Le seul qui peut vous remplacer, c’est encore Jean-Jacques Bertrand”. [Johnson répond] : “Bertrand va parler à un dîner-causerie au Club Renaissance. Peux-tu prendre l’avion tout de suite et aller le présenter en mon nom aux militants ?” L’ancien chef de Cabinet attrape le premier avion et arrive au Club Renaissance juste à temps pour s’exclamer : “Je viens de rencontrer le premier ministre, il y a trois heures. Il m’a demandé de saluer l’un de ses grands amis, un homme qui comprend et connaît les problèmes du Québec, monsieur Jean-Jacques Bertrand !” Applaudissements. Daniel Johnson vient de désigner son dauphin. En cas de disparition prématurée et selon le vœu même du chef, Bertrand assurera l’intérim. C’est on ne peut plus clair ! »
À l’automne 1968, le premier ministre Daniel Johnson est attendu sur la Côte-Nord pour inaugurer le barrage Manic-5.
Conrad Black explique que Daniel Johnson « avait la même faiblesse physique que Paul Sauvé et mourut dans son sommeil d’une crise cardiaque à Manicouagan, le 26 septembre 1968. Il avait cinquante-trois ans. Si les circonstances de sa mort rappelèrent celle de Sauvé, l’environnement physique rappelait celle de Duplessis. Ce jour-là, Johnson était censé inaugurer le gigantesque barrage Manicouagan 5. Le barrage fut subséquemment nommé d’après le premier ministre décédé. Le dernier soir de sa vie, Daniel Johnson se rendit à la taverne des ouvriers sur le site du barrage où on le photographia donnant simultanément la main à Jean Lesage et à René Lévesque qui au lendemain de la défaite de 1966 avait finalement admis qu’il était séparatiste et avait fondé un parti basé sur ce choix. À cette rencontre, Johnson s’exclama sur un ton badin : “Je vous unis” voulant dire que les deux s’entendaient au moins dans leur opposition à Johnson. Ce barrage coûteux, aux voûtes gracieuses, Manic 5 comme on l’appelait, d’une longueur de 4 300 pieds et d’une hauteur de 660 pieds était un projet à la réalisation duquel les trois hommes avaient contribué. Il devint un symbole populaire du Québec nationaliste, pour ne pas dire narcissique, création de la soi-disant Révolution tranquille des années soixante. Des automobiles “Manic” et des cigarettes “Manic” connurent un bref succès. Le nom de ces produits était plus à propos que ne l’imaginaient probablement leurs créateurs enthousiastes.
Avec la mort de Daniel Johnson, la cause nationaliste passa par défaut de la droite, qui l’avait faite sienne depuis Mercier en passant par [Henri] Bourassa, [Lionel] Groulx et Duplessis, à la gauche et à René Lévesque. Au moment de l’inhumation de Johnson, Jean-Jacques Bertrand, […] déclara : “Dieu tout-puissant, nous te confions aussi à l’histoire de ton peuple, de ta province et de ton pays où ta mémoire sera honorée pour toujours. Que Dieu soit avec toi Daniel. Tu as été un bon Canadien et un fidèle Québécois.” »
Selon Pierre B. Berthelot, « cette mort subite est un terrible choc pour le monde politique québécois. Encore une fois, l’Union nationale perdait son chef à un moment critique de l’histoire. Avec sa mort s’envolait également la position développée dans Égalité ou indépendance. À partir de ce moment, les problèmes vont s’abattre non seulement sur l’Union nationale, mais sur le Québec en entier. L’ironie de l’histoire amène parfois des adversaires à se succéder l’un l’autre, dans un effort commun. Comme Sauvé après Duplessis, ici encore, l’homme de la réforme succédait à l’homme de la tradition, Jean-Jacques Bertrand, qui avait longtemps combattu Johnson pour mener à bien la réforme de l’Union nationale, se retrouvait maintenant aux commandes du parti. Toutefois, il faisait face à une impasse. Contrairement à Johnson, Bertrand n’avait pas formulé sa propre réponse à la question nationale. Il se retrouvait donc à défendre une position qui, en fait, n’était pas la sienne. Si Johnson était d’abord un nationaliste et un conservateur ensuite, dans cet ordre, Bertrand était d’abord un conservateur et un nationaliste ensuite. De plus, contrairement à Johnson et Duplessis, Bertrand était un homme qui n’aimait pas l’affrontement et qui cherchait à régler les conflits plutôt qu’à les exploiter. Voulant éviter de ferrailler avec un adversaire aussi coriace que Pierre Elliott Trudeau, Bertrand préféra se concentrer sur d’autres dossiers. »

Page une du journal The Gazette. 27 septembre 1968.
Collection Dave Turcotte
Nommé premier ministre du Québec
Jean-Jacques Bertrand est nommé chef intérimaire de l’Union nationale le 2 octobre 1968 et devient, par la même occasion, premier ministre du Québec. Le nouveau cabinet Bertrand est essentiellement le même que celui de son prédécesseur. Au fil du mandat, trois ministères s’ajoutent toutefois à ceux qui sont déjà en place, soit les ministères de l’Immigration, des Communications et de la Fonction publique. Pendant son mandat de premier ministre, Bertrand occupe la fonction de ministre de la Justice et ministre des Affaires intergouvernementales du 2 octobre 1968 au 23 juillet 1969. Il est aussi brièvement ministre des Finances du 18 au 23 juillet 1969.

Malgré la mention, Jean-Jacques Bertrand est bel et bien le 21e premier ministre du Québec et non le 25e.
Page 22 du magazine Perspectives. 23 novembre 1968.
Collection Dave Turcotte
Extrait de l'émission spéciale de Radio-Canada sur l'assermentation de Jean-Jacques Bertrand. 2 octobre 1968.
Youtube
Cabinet de Jean-Jacques Bertrand, 21e premier ministre du Québec, le 2 octobre 1968 :
Premier ministre et président du Conseil exécutif
BERTRAND, Jean-Jacques - 2 octobre 1968
Vice-président du Conseil exécutif
CARDINAL, Jean-Guy - 11 décembre 1968
Affaires culturelles
TREMBLAY, Jean-Noël - 2 octobre 1968
Affaires intergouvernementales
BERTRAND, Jean-Jacques - 2 octobre 1968
MASSE, Marcel - 23 juillet 1969
Affaires municipales
LUSSIER, Robert - 2 octobre 1968
Agriculture et Colonisation
VINCENT, Clément - 2 octobre 1968
Communications
LEBEL, Gérard - 23 décembre 1969
Éducation
CARDINAL, Jean-Guy (Conseil législatif) - 2 octobre 1968
Famille et Bien-être social
CLOUTIER, Jean-Paul - 2 octobre 1968
Finances
DOZOIS, Paul - 2 octobre 1968
BERTRAND, Jean-Jacques - 18 juillet 1969
BEAULIEU, Mario - 23 juillet 1969
Fonction publique
COURNOYER, Jean - 23 décembre 1969
Immigration
GABIAS, Yves - 3 décembre 1968
BEAULIEU, Mario - 28 mars 1969
Industrie et Commerce
BEAUDRY, Jean-Paul - 2 octobre 1968
Institutions financières, Compagnies et Coopératives
DOZOIS, Paul - 2 octobre 1968
GABIAS, Yves - 10 octobre 1968
BEAULIEU, Mario - 29 avril 1969
MALTAIS, Armand - 23 juillet 1969
Justice
BERTRAND, Jean-Jacques - 2 octobre 1968
PAUL, Rémi - 23 juillet 1969
Revenu
JOHNSTON, Raymond Thomas - 2 octobre 1968
Richesses naturelles
ALLARD, Paul-Émile - 2 octobre 1968
Santé
CLOUTIER, Jean-Paul - 2 octobre 1968
Secrétaire provincial (aboli le 1er janvier 1970)
GABIAS, Yves - 2 octobre 1968
PAUL, Rémi - 10 octobre 1968
Solliciteur général
MALTAIS, Armand - 10 octobre 1968
Terres et Forêts
GOSSELIN, Claude-Gilles - 2 octobre 1968
Tourisme, Chasse et Pêche
LOUBIER, Gabriel - 2 octobre 1968
Transports et Communications (voir Communications ainsi que Transports)
LIZOTTE, Fernand - 2 octobre 1968
Transports
LIZOTTE, Fernand - 21 janvier 1970
Travail (voir Travail et Main-d'oeuvre)
BELLEMARE, Maurice - 2 octobre 1968
Travail et Main-d'oeuvre
BELLEMARE, Maurice - (18 décembre 1968)
COURNOYER, Jean - 12 mars 1970
Travaux publics
RUSSELL, Armand - 2 octobre 1968
Voirie
LAFONTAINE, Fernand-Joseph - 2 octobre 1968
Ministres d'État
BOIVIN, Roch - 2 octobre 1968
BOUDREAU, Francis - 2 octobre 1968
CHARBONNEAU, Edgar - 2 octobre 1968
MASSE, Marcel - 2 octobre 1968
MATHIEU, François-Eugène - 2 octobre 1968
MORIN, Jean-Marie - 2 octobre 1968
GAGNON, François - 23 décembre 1969

Photographie du caucus des députés de l'Union nationale sous Jean-Jacques Bertrand. 3 octobre 1968.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
Photographe Jean Boisvert
Bertrand a sa résidence principale à Cowansville dans sa circonscription. Lorsqu’il devient premier ministre, il choisit d’habiter au Montmorency, situé au 165, Grande Allée Est. C’est un immeuble d’appartements très moderne construit en 1963. C’est en quelque sorte une rupture avec ces prédécesseurs unionistes Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barette, Daniel Johnson père qui avaient tous choisi le Château Frontenac.

Photographie de l'immeuble Le Montmorency, résidence du premier ministre Jean-Jacques Bertrand.
Collection Dave Turcotte
Le style Bertrand
O’Neill et Benjamin écrivent que « la pratique du pouvoir sous Jean-Jacques Bertrand a été marquée de deux caractéristiques principales : au sein de chaque ministère, l’exercice réel de l’autorité par le ministre ; au gouvernement, l’arrivée du premier vrai mandarin québécois, au sens courant du terme, c’est-à-dire un haut fonctionnaire à la fois influent et très, très discret. À la suite de la mort subite de M. Daniel Johnson le 26 septembre 1968, M. Bertrand posa, à titre de premier ministre intérimaire, quelques gestes rapides qui révélèrent sa conception de l’exercice du pouvoir (“tout ce qui traîne se salit”, répétait-il souvent). Il remania le Conseil des ministres pour alléger la tâche des “superministres” […]. Par ailleurs, le premier ministre voulut s’assurer que les projets législatifs élaborés sous M. Johnson deviennent lois, et une meilleure répartition des portefeuilles faciliterait la tâche, déclara-t-il. Certains ont cependant noté qu’il s’agissait là — du moins lorsqu’on l’utilisait ailleurs — d’un type d’administration qui se caractérisait par une absence de leadership, ou en tout cas par un premier ministre qui gérait plutôt qu’il n’orientait. En effet, d’autres décisions à plus long terme reflétaient ce type d’administration ou l’expliquaient : M. Bertrand fit adopter par l’Assemblée nationale un amendement à la loi de l’Exécutif, amendement qui créait le poste de secrétaire général du Conseil exécutif, et il nomma à ce nouveau poste son ancien sous-ministre de la Justice, Me Julien Chouinard. Cette nomination eut pour effet d’empêcher les pressions trop directes ou trop soutenues d’un ministre sur le Premier ministre pour faire accélérer les dossiers. Le premier ministre Bertrand s’appuya en effet, d’octobre 1968 à avril 1970, sur une méthode hiérarchique d’administration de l’État. C’est ainsi que les membres du Conseil des ministres s’aperçurent, avec l’arrivée au pouvoir de M. Bertrand, qu’il ne suffisait plus d’aller présenter un projet au premier ministre pour le faire progresser. La collégialité avait été remplacée par un type hiérarchique de gestion : M. Bertrand ne se penchait sur aucun dossier qui n’avait d’abord reçu l’assentiment de Me Chouinard. […] Ce fut une période où l’on parla au Québec, mi-sérieusement mi-à la blague, d’un “premier ministre adjoint”. »
Claude Morin affirme que Bertrand était « plus expéditif que Johnson ». « Avec lui, les choses ne traîneraient pas. Et, en plus, dans ses conversations, il allait droit au but ». Il ajoute « On s’en rendit compte dès les premiers jours : Bertrand était ponctuel. Pas autant que Lesage, là-dessus imbattable, mais incomparablement plus que Johnson. Si bien que le petit monde gravitant autour du premier ministre eut le sentiment de transmigrer dans un autre fuseau horaire. Il fallut, sur-le-champ, adapter nos habitudes de vie à de nouveaux paramètres chronologiques. Bertrand se pointait à son bureau autour de huit heures trente, non vers dix heures trente ou onze heures comme Johnson, à qui d’ailleurs il ne répugnait pas d’y arriver plus tard encore, par exemple au début de l’après-midi. Mais Johnson, une fois solidement installé à son bureau, ne le quittait pas avant le soir, souvent même à des heures avancées de la nuit. Bertrand, lui, estimait que, vers dix-huit heures et hormis une situation anormale, il avait “fait sa journée”. En quoi il n’avait pas tort, vu la quantité de décisions prises pendant ce qu’il appelait les “heures régulières de travail”. Il retournait ensuite chez lui, satisfait du devoir accompli et content de la célérité qu’il avait mise à résoudre des problèmes auxquels Johnson aurait, avec ses conseillers, consacré peut-être des jours de réflexion sans pour autant parvenir à une décision ferme. Car, on le sait, Johnson aimait “y repenser”…
Bertrand, lui, décidait. Vite. J’en eus une multitude d’exemples. Ainsi, tard un après-midi, alors que je n’avais rendez-vous avec lui que le lendemain, il m’appela : — Viens maintenant avec ton dossier. On va le régler tout de suite. Je veux nettoyer mon pupitre avant de partir. Nettoyer son pupitre ? Non, ce n’était pas une figure de style. Il tenait à enlever physiquement de sa table de travail les quelques papiers relatifs à mon affaire qui y seraient demeurés jusqu’au lendemain matin si notre entretien avait eu lieu à l’heure convenue. Il “nettoyait” aussi son pupitre avec ses autres collaborateurs. Bertrand supportait difficilement de laisser en suspens une question qu’il croyait pouvoir résoudre sans retard. “Ne pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire aujourd’hui” était un de ses proverbes favoris. Proverbe pour proverbe, Johnson aurait sûrement préféré “La nuit porte conseil”… À tout prendre, sa façon d’agir me plaisait. »
Claude Morin souligne que « Bertrand était, lui, la transparence ambulante. Je n’ai jamais rencontré d’homme politique aussi aisément “décodable” (une fois comprises une ou deux clefs) et, pour utiliser une expression courante, plus “facile à vivre avec”. […] Il demeure toutefois qu’il était frustré de se voir, en vertu de ses responsabilités, obligé de cacher des choses ou, du moins, de ne pas les divulguer séance tenante. D’emblée, sa préférence allait à la limpidité, nullement parce qu’il voulait faciliter la tâche d’opposants politiques, les fédéraux par exemple ou les libéraux de l’Assemblée nationale, mais parce qu’il estimait que la population avait le droit le plus strict de savoir exactement ce qui se tramait pour être ensuite en mesure de se faire une idée en connaissance de cause. (Incidemment, Bertrand fut toujours un partisan convaincu du recours au référendum comme moyen permettant aux citoyens de se prononcer sur leur avenir collectif ; premier ministre, il commanda même la préparation d’une loi en ce sens, mais n’eut pas le temps de la mener à terme.) De ce point de vue, la transparence souhaitée par lui découlait moins d’une candeur répréhensible chez un personnage aussi haut placé que, je crois, d’un véritable souci démocratique. »



Photographies de Jean-Jacques Bertrand. Photo moderne enrg. Octobre 1969
Collection Assemblée nationale du Québec
Selon Claude Morin : « “Le peuple” ! Cette expression, comme celle de “démocratie”, faisait partie du vocabulaire courant de Bertrand qui l’utilisait naturellement, sans aucune affectation ni prétention. Chez lui, survenant au cours de conversations, de tels mots ne sonnaient pas faux. Il croyait aux réalités qu’ils recouvraient. Mettre la population dans le coup ? L’informer ? Cela, pour lui, allait de soi dans un régime qui se respecte. Peu importait alors que les politiciens au pouvoir fussent desservis par la connaissance des faits exacts. Si toute vérité n’est pas nécessairement bonne à dire, il fallait à Bertrand des raisons fichtrement sérieuses pour la cacher ou même pour en retarder la divulgation jusqu’à un moment jugé opportun par le pouvoir. (C’est d’ailleurs à lui que le Québec doit la création du poste d’ombudsman. Non seulement le citoyen avait, selon lui, le droit de savoir ce que l’État tramait, mais il avait aussi celui de s’en protéger.) »
Bertrand semble avoir eu à quelques reprises des problèmes d’image. O’Neill et Benjamin citent pour exemple lorsqu’il « a choisi de présider aux cérémonies d’inauguration du “nouveau” Forum de Montréal, […]. [La] réception des téléspectateurs ne fut pas des meilleures : M. Bertrand avait été — on n’en doute pas — fort mal conseillé. Des créations d’événements (event creation) requièrent à la fois un sens de la dignité et du théâtre que M. Bertrand n’a jamais possédé. Au Forum, le 2 novembre 1968, le discours comprenait trop de lieux communs, faisait trop sérieux, ne cadrait pas avec l’atmosphère de fête. Bref, ce n’était pas l’endroit pour prononcer un discours de cette nature […]. Les gens avaient d’abord applaudi un premier ministre qui n’était en poste que depuis quelques semaines ; mais, à mesure que les minutes s’écoulaient, les huées s’intensifièrent. De plus, ce qui mit bien des gens mal à l’aise ce soir-là, le premier ministre se comportait comme s’il avait été ivre. Un tel comportement ne peut pas être passé inaperçu aux yeux de son entourage, à l’Hôtel Bonaventure, avant qu’il n’arrive dans l’enceinte du Forum. Ne pouvait-on pas s’assurer que le repas qui précèderait le discours fût “sec”, si effectivement son comportement s’expliquait par “le verre de trop” qu’il avait ingurgité ? »
Claude Morin relate que « De manière générale, on ne peut pas dire que Bertrand faisait de son mieux pour corriger les impressions parfois défavorables que pouvait avoir de lui : il ne faisait pratiquement rien. “J’ai dit ce que j’avais à dire” ou “La population fera la part des choses”, commentait-il lorsqu’on l’informait d’opinions négatives véhiculées dans les médias. Il lui arrivait aussi, en philosophe fataliste, d’ajouter : “Nul n’est prophète en son pays” ».




Photographies d'une conférence de presse de Jean-Jacques Bertrand. Janvier 1969.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Antoine Desilets
Congrès de l’Union nationale
Pierre B. Berthelot explique qu’à « l’automne 1968, le Québec est secoué par un énorme mouvement de contestation. Comme en France, en Allemagne et aux États-Unis, des dizaines de milliers de jeunes, des ouvriers, des fonctionnaires et des groupes militants se mobilisent contre le gouvernement. Les premiers finissants des nouveaux cégeps n’arrivent pas à se trouver de places dans les universités. À Montréal, on ne compte qu’une seule université française (l’Université de Montréal) et les universités de langue anglaise n’admettent pratiquement aucun francophone. Certains tenteront de franciser l’Université McGill — en vain — tandis que d’autres opteront pour l’action directe (Front d’action politique, Mouvement pour l’intégration scolaire, Front de libération du Québec). Cette contestation étudiante, bien plus considérable que celle qu’avait connue Duplessis, prend rapidement une dimension politique. De plus en plus de jeunes s’opposent à l’ordre établi et se revendiquent de la gauche, de la contreculture et du mouvement souverainiste. Cette contestation a ses répercussions au sein de l’Union nationale. Des divisions surviennent entre les partisans et jusque dans le cabinet des ministres. »
O’Neill et Benjamin soulignent qu’en « janvier et mars 1969, M. Bertrand avait pourtant laissé entendre qu’il ne serait pas le leader du parti lors des prochaines élections — à un point tel que trois ou quatre de ses ministres s’attendaient à son retrait de la vie politique ».

Le caricaturiste Normand Hudon nommait Jean-Jacques Bertrand « Pierre-Jean-Jacques » et le dépeignait comme un « niais ».
Caricature de Normand Hudon titrée : La défiance règne. 1969.
Don d’Arlette Hudon
O’Neill et Benjamin soulignent qu’en « janvier et mars 1969, M. Bertrand avait pourtant laissé entendre qu’il ne serait pas le leader du parti lors des prochaines élections — à un point tel que trois ou quatre de ses ministres s’attendaient à son retrait de la vie politique ».
Pour mettre fin à ces spéculations, Bertrand propose plutôt la tenue d’un congrès à la chefferie lors du Conseil national de l’Union nationale du 15 mars 1969. Ce congrès a lieu les 19, 20 et 21 juin 1969 au Colisée de Québec. Bertrand s’y porte candidat afin d’être confirmé dans ses fonctions de chef.
La santé de Bertrand était elle-même fragile. Claude Morin souligne que « moins de trois mois après son arrivée au pouvoir, il avait subi un malaise cardiaque, mais l’événement ne fit pas la manchette. Quoique partisan de la transparence dans l’information, il observait la plus grande discrétion sur ce qui le concernait personnellement. » Le ministre Paul Dozois, qui avait agi à titre de premier ministre intérimaire en septembre et en octobre 1967 sous Daniel Johnson, le redevient en janvier 1969 le temps de la convalescence de Jean-Jacques Bertrand. Selon O’Neill et Benjamin, « c’est Mme Bertrand qui semble-t-il, convainquit son mari de demeurer au poste. Lors de sa période de convalescence à Cowansville, en janvier 1969, M. Bertrand a songé sérieusement à tout abandonner ; sa crise cardiaque l’avait fait réfléchir. L’impact de son épouse, “mieux préparée à ce poste par sa famille et ses études”, parut alors décisif. »
Claude Morin émet que « Bertrand n’était pas du genre cachottier. Ainsi qu’on le dit en termes courants, il ne “tournait pas autour du pot”. Ses confidences sur ses intentions, il me les fit dès notre premier entretien après les funérailles de Johnson, sans sollicitation de ma part (ce n’était quand même pas de mes affaires !), comme s’il voulait aller au-devant des critiques éventuelles sur sa procédure de désignation au poste de premier ministre. Pourtant, vu les événements, elle était correcte, mais Bertrand n’y voyait qu’un pis-aller temporaire : — Je suis un démocrate convaincu, me dit-il, et je veux être choisi autrement que par une petite assemblée de parlementaires. Les électeurs auront éventuellement à trancher. »
Richard B. Holden écrit : « Monsieur Bertrand était [...] fermement convaincu de la nécessité d’une entière démocratisation de tout mouvement politique. Il n’avait jamais accepté totalement la décision du congrès de 1961 et il affirma, en particulier et publiquement, qu’il ne garderait son mandat de premier ministre qu’à la seule condition de recevoir un appui franc et clair de la part de tous les militants du parti, réunis en assemblée générale. Cette prise de position était sans précédent dans l’histoire politique québécoise ».
O’Neill et Benjamin soutienent que « la tenue d’un congrès devenait alors utile pour mater les fiduciaires de la caisse du parti. Ceux-ci reprochaient au premier ministre de ne pas avoir été élu et lui refusaient même le droit de se mêler des questions financières. En ce sens, par conséquent, les responsables de la caisse du parti ont joué indirectement — un plus grand rôle dans la décision de tenir ce meeting. Les autres appuis, enfin, vinrent d’organisateurs plus traditionnels du parti qui percevaient l’arrivée et la montée en flèche de Jean-Guy Cardinal comme incompatible avec “leur” U.N., celle des notables des petites villes de province, partageant des valeurs chères à Maurice Duplessis, conservatrices, populistes, voire anti-intellectuelles. »
Le site internet Bilan du siècle rapporte que « Cardinal mène une campagne dynamique axée sur des thèmes comme la modernisation de l’État, le redressement de l’économie québécoise et la nécessité de mettre de l’ordre dans la fonction publique. Le 21 juin, jour du vote, les débats sont houleux à l’intérieur et à l’extérieur du Colisée puisque 3 000 manifestants provenant de groupes de gauche se frottent aux forces policières. »
Pierre B. Berthelot dit : « Cet événement, qui ne devait être qu’une simple formalité, se transforme en un terrible affrontement entre les factions conservatrices et nationalistes du parti. Bertrand, qui s’attendait à essuyer avec une forte majorité l’humiliation de sa défaite au congrès de 1961, ne reçoit en fin de compte qu’un appui de 57 %. Arrivant tout juste devant son [vice-premier ministre et] ministre de l’Éducation, Jean-Guy Cardinal, Bertrand découvre alors au sein de son propre cabinet un rival très puissant et très populaire, surtout auprès des jeunes […]. Toutefois, au lieu d’essayer de réintégrer les partisans dissidents, Bertrand va choisir de durcir sa position devant tous ceux qui le contestent. »
O’Neill et Benjamin précisent qu’au contraire, « au cours de la campagne, M. Bertrand demanda aux souverainistes de quitter l’Union nationale. M. Johnson avait réussi, lui, à préserver le consensus sur le thème : égalité ou indépendance. »

Photographie du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand et quelques-uns de ses militants. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Fonds Jacques et François Trépanier
Ernest Rainville, photographe




Photographies du congrès de l'Union nationale des 19 au 21 juin 1969.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Paul Henri Talbot
Le mariage civil
Benoit Gignac mentionne que le « 8 novembre [1968], l’Assemblée législative du Québec adopte le projet de loi 77, proposé par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Bertrand. À compter de l’année suivante, les Québécois pourront se marier au palais de justice. L’Église vient de céder une autre partie son grand territoire. Avec la Loi sur le divorce entrée en vigueur le 2 juillet Ottawa, le Québec n’en finit plus de se laïciser et de se libérer. »
Benoit Gignac précise qu’essentiellement, « ce changement législatif permettant le mariage hors de l’Église vise trois groupes d’individus : les non-croyants ; les hindous, bouddhistes et musulmans qui n’ont pas de chefs spirituels au Québec ; ainsi que les divorcés. Mais derrière ces accommodements de nature pratique se trouve la reconnaissance du libre choix des individus de vivre ou non sous le joug d’une Église qui est toujours trop contraignante. Jusque-là, les prêtres étaient à la fois représentants de l’État et de l’Église dans la célébration du mariage. Ce double pouvoir va maintenant leur échapper. »
Benoit Gignac explique qu’avec « le mariage civil, fini les publications de bans, fini l’hypocrisie des fausses déclarations devant Dieu. Dorénavant, un couple pourra faire partie des registres civils de la province sans passer par la formulation de vœux religieux. Malgré quelques déclarations fracassantes de la part de certains ecclésiastiques qui affirment que l’union conjugale souffre de “cancer généralisé”, en 1968, l’Église catholique du Québec ne s’oppose pas au projet de loi 77. »

Photographie de Jean-Jacques Bertrand. 18 mai 1968.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Pierre McCann
Langue française
« Dès le déclenchement de la Révolution tranquille, le nouveau nationalisme québécois s’affirme dans les domaines de la politique, de l’économie, de la littérature et des arts. Il ne tarde pas à se manifester également dans un dossier qui soulève les passions : la question linguistique. Pendant longtemps, le principal souci de la classe politique québécoise en matière d’immigration est que les nouveaux venus soient principalement de religion catholique. Sous l’effet du fléchissement rapide de la natalité de la population canadienne-française dans les années 1960, il est souhaitable que dorénavant les immigrants adoptent la langue française. Mais tel n’est pas toujours le cas. Déjà, dans les années 1950, environ 70 % des enfants des nouveaux Québécois à Montréal fréquentent des écoles anglophones. Cette proportion est encore plus élevée dans la décennie suivante. Dans ce contexte, la survie du fait français au Québec, et principalement dans un Montréal de plus en plus cosmopolite, semble compromise à long terme. » - Exposition Le début d’un temps nouveau du Musée québécois de la culture populaire
Benoît Gignac relate que le « Québec de 1968 est encore endormi face aux défis d’immigration. Jusqu’au milieu des années 1960, les questions de nombre ne s’étaient jamais posées, et les anglophones et allophones de toutes origines arrivant au Québec avaient toujours pu vivre en anglais s’ils le voulaient, sans être “importunés” par les francophones. Quand s’annonce la bataille de Saint-Léonard, les choses changent. Au-delà, donc, de la stricte langue d’enseignement dans les classes se trouve l’enjeu du contrôle de l’immigration par l’éducation. Vaste programme.
Certes, un nouveau ministère de l’immigration vient d’être créé à Québec, ce qui pourrait permettre de gérer ce nouveau phénomène, mais, dans la réalité, cet instrument étatique n’existe pas encore. Devant le vide gouvernemental face à ces questions, en novembre 1967, les commissaires d’école de Saint-Léonard décident donc que les fameuses classes bilingues, mais surtout anglaises, seront remplacées par des classes unilingues françaises où l’anglais sera enseigné comme matière scolaire dans des proportions acceptables, protection de la majorité oblige.
Ils créent ensuite un comité spécial chargé d’étudier la question plus à fond. Ses membres remettent leur rapport en mars 1968, dans lequel ils proposent d’en revenir à un équilibre d’enseignement moitié-moitié dans les deux langues. Personne n’est content. C’est alors que des Italo-Québécois, en furie contre cette proposition brimant leur liberté et leurs privilèges acquis, créent la Saint Leonard English Catholic Association of Parents et réclament des écoles catholiques de langue anglaise. En retour, les francophones créent le Mouvement pour l’intégration scolaire (MIS) qui prône le français comme seule langue officielle d’enseignement dans les écoles. La guerre s’annonce.
En juin, après avoir consulté la population par référendum et obtenu un appui clair en faveur d’écoles où le français aurait priorité, les commissaires décident qu’à partir du mois de septembre, dans toutes les classes de première année du primaire, l’enseignement ne sera donné qu’en français. Les Italo-Montréalais résistent pendant que Québec tergiverse. »
Benoit Gignac ajoute que « malgré les positions prises par les commissaires, lorsque s’ouvre l’année scolaire à Saint-Léonard, on apprend que l’école secondaire Aimé-Renaud va tout de même devenir une école anglophone afin d’accueillir les élèves italiens dont les parents ont décidé qu’ils devaient étudier en anglais. C’est alors qu’appuyés par le MIS, 80 jeunes Canadiens français occupent le bâtiment. Un siège pacifique de quelques jours a lieu et se termine le 5 septembre, après négociation avec le bureau du ministre de l’Éducation. Résultat : l’école restera francophone, et les anglophones seront regroupés dans une école nouvellement construite. Il s’agit d’un compromis qui ne règle rien. La bataille continue de faire rage, et le Parlement de Québec entre dans le jeu. »
Benoit Gignac croit que « ce qui se cachait derrière la bataille de la langue d’enseignement à l’école apparaît soudain de plus en plus clairement. Plus que la protection de la langue proprement dite, c’est toute la recherche d’affirmation du peuple francophone que soulève la bataille de Saint-Léonard, qui s’amorce et qui atteindra un point culminant en 1969. »
Benoit Gignac présente ainsi le Québec à l’automne 1968. « Pendant que les mamans québécoises finissent d’équiper leur marmaille en fournitures scolaires et que les maisons s’emplissent d’odeurs de gomme à effacer et de cuir de sac d’école, l’automne québécois sent le souffre. Les étudiants des nouveaux cégeps et les universitaires commencent à se faire voir et entendre de plus en plus souvent. »
À peine assermenté, Bertrand fait face à une grève générale d’étudiants demandant une 2e université francophone à Montréal. Toujours à l’automne 1968, une grève des pompiers et des policiers de Montréal ainsi qu’une très violente grève à la compagnie de taxi Murray Hill nécessitant l’intervention de l’armée enflamme le Québec.
Claude Morin résume les principes de Bertrand en matière linguistique : « chaque citoyen canadien, présent ou futur, devrait jouir au Québec du droit naturel et inaliénable d’opter, dans l’enseignement comme ailleurs, pour le français ou l’anglais, les deux langues du Canada. C’est ce qu’on appela alors la liberté de choix. Corollaire implicite : les Québécois francophones n’amélioreraient pas leur situation en s’en prenant aux Québécois anglophones. Autrement dit, on ne corrigerait pas une injustice par une autre. Bertrand soupçonnait que sa position perpétuerait non seulement les “droits” des anglophones, mais en même temps leurs privilèges. Il se refusait néanmoins, en conscience, à baliser l’exercice des premiers, même si, de la sorte, il risquait de confirmer les seconds. Il savait sans doute aussi qu’une politique de libre choix nuirait à l’intégration des immigrants à la communauté francophone québécoise, puisque rien n’empêcherait ceux-ci, bien au contraire, de se greffer au courant anglophone dominant au Canada et en Amérique du Nord. Au fond, il aurait aimé que le Québec fît preuve d’une telle générosité à l’égard de ses anglophones actuels ou à venir que le Canada anglais, impressionné, se serait dès lors moralement senti obligé d’étendre la réciproque aux francophones vivant sur son territoire. Il espérait du renoncement pratiqué chez soi l’émergence de la libéralité chez les autres ! »
En décembre 1968, le gouvernement Bertrand dépose le projet de loi 85, favorisant le libre choix de la langue d’enseignement. La grogne est instantanée. Même des députés unionistes s’y opposent voyant un recul pour les francophones. Son gouvernement le retire et crée la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et des droits linguistiques au Québec (Commission Gendron).
Benoit Gignac affirme que « le rapport de M. Gendron rejoindra les nombreux autres ornant les tablettes de la bibliothèque du Parlement. Mais la bataille pour le français, elle, continuera de plus belle. Au printemps suivant (28 mars 1969), il y aura l’importante manifestation pour un McGill français, où quelques dizaines de personnes seront arrêtées. La rentrée scolaire de 1969 sera de nouveau perturbée à Saint-Léonard. Le 10 septembre, 40 personnes seront arrêtées lors d’une marche de protestation. »
Wikipédia rapporte que le 23 octobre 1969, « le gouvernement de Bertrand introduit le projet de loi 63 (Loi pour promouvoir la langue française au Québec) qui garantit explicitement le droit aux parents de choisir la langue d’éducation de leurs enfants. Ce projet, censé renforcer les protections de la langue française, facilitera en réalité le passage vers l’école anglaise. Cette décision extrêmement impopulaire provoquera des émeutes et des manifestations dans le Québec francophone, ainsi que la défection de nombreux militants de l’Union nationale vers le Parti Québécois. » L’affrontement était jusque-là montréalais. Avec ce projet de loi, la colère devient généralisée.
Claude Morin précise que Bertrand « fut estomaqué de la réaction fort négative à son projet ; s’attendait certes à des protestations de groupes nationalistes — “Tant pis, j’agis selon ma conscience”, disait-il, résigné, mais pas aux slogans repris par la foule de dix à vingt mille personnes qui manifesta bruyamment contre le projet de loi devant l’Assemblée nationale. J’avais quitté mon bureau pour voir la manifestation à travers les fenêtres du Salon rouge dans le même édifice. C’était, m’avaient affirmé des policiers, le plus gros rassemblement depuis toujours à se tenir “en face du parlement”. Des manifestants criaient : “Bertrand : traître”. Parmi les quelques spectateurs présents au Salon rouge, je croisai René Lévesque allant fébrilement d’une fenêtre à l’autre, prenant soin de ne pas brûler les tentures avec sa cigarette constamment allumée. Il s’était, avec trois autres députés (Yves Michaud, libéral, Jérôme Proulx, unioniste, et Gaston Tremblay, indépendant), opposé au Bill 63. » Lors de cette manifestation, il y eut 40 blessés et 70 arrestations.
Plusieurs autres manifestations ont lieu. Selon Benoit Gignac dans Le Destin Johnson, même Pierre Marc Johnson, fils du prédécesseur du premier ministre manifeste contre ce projet de loi et par le fait même, contre le parti de son défunt père. O’Neill et Benjamin complètent ainsi : « L’image que l’on retient sans doute, c’est celle d’un citoyen d’East Angus crachant à la figure de M. Bertrand aux applaudissements de trois cents badauds, tandis qu’un autre manifestant était arrêté le même soir “au moment où, brandissait un bâton, il s’apprêtait à assommer le premier ministre”. »
Malgré tout, le projet de loi 63 est adopté en novembre.
Vidéo rappelant les faits et événements qui mènent à l’adoption de la très controversée loi 63. Musée québécois de culture populaire. 2012.
Exposition Le début d'un temps nouveau
Musée québécois de culture populaire

Photo de presse d'une manifestation devant l'Assemblée nationale du Québec contre le projet de loi 85 du gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand. United Press International. 12 décembre 1968.
Collection Dave Turcotte

Affaires intergouvernementales
Vien et Lapointe soulignent que « c’est dans la plus pure tradition du fondateur [l’Union nationale], M. Maurice Duplessis, et de son successeur, M. Paul Sauvé, que Daniel Johnson continue la bataille pour faire reconnaître les droits du Québec en matière de fiscalité. Dans cette même tradition, Me Jean-Jacques Bertrand présente, durant la session 1962-1963, une motion demandant la formation d’un comité parlementaire pour étudier tous les problèmes relatifs à la constitution. Cette motion est elle aussi adoptée unanimement. »
Matthew Farfan avance qu’au « point de vue constitutionnel, [Bertrand] était considéré comme un nationaliste vigoureux et un grand défenseur des droits du Québec. Il percevait le Canada comme un pays de deux cultures et de deux nations. »
Claude Morin écrit : « Dès notre première rencontre […] il m’annonça qu’il avait décidé, comme Lesage et Johnson, de conserverie portefeuille des Affaires intergouvernementales. Ce domaine était, à ses yeux, capital. Après tout, la révision constitutionnelle en cours depuis février 1968 découlait des pressions exercées par lui sur son parti alors qu’il se trouvait dans l’opposition. Il voulait continuer à suivre le dossier de près. Il me fit faire le point sur l’état des relations fédérales-provinciales. Détails à l’appui, j’évoquai les problèmes auxquels l’arrivée de Trudeau comme premier ministre du Canada exposerait désormais le Québec. Autrement dit : “Lesage et Johnson ont eu affaire à Pearson, un anglophone au fond conciliant, mais vous allez devoir vous battre avec un dogmatique, Trudeau, élu par des Québécois en plus”. À ma grande surprise, Bertrand ne prit pas les choses aussi gravement que je l’aurais espéré. Selon lui, avec de la bonne volonté et des concessions réciproques, bien des difficultés s’aplaniraient. Il prononça alors cette phrase qui me laissa songeur : Trudeau et moi, nous sommes tous deux des Canadiens français. Je ne vois donc pas pourquoi nous ne réussirions pas à nous entendre ! … »
Claude Morin raconte que « Bertrand croyait en la nécessité d’instaurer au Canada qu’il appelait un authentique (ou véritable) fédéralisme. Ce régime de gouvernement assurerait le maintien de relations harmonieuses entre francophones et anglophones, car, par définition, il respecterait pleinement l’autonomie des provinces en général et du Québec en particulier. Les pratiques fédérales centralisatrices représentaient, pour Bertrand, des déviations inadmissibles, presque immorales, de l’idée de fédération. Dans cette perspective, il s’opposait à Trudeau moins par nationalisme qu’en vertu de sa conception du fédéralisme. A cet égard, il raisonnait davantage en Canadien français des années 1950 qu’en Québécois de la Révolution tranquille. […] Le fédéralisme de Bertrand ne tolérait pour ainsi dire pas de variantes. Il n’en existait qu’un seul, l’authentique précisément, celui qu’il défendait lui-même, aux caractéristiques peu nombreuses, mais incontestablement nettes et, à vrai dire, quelque peu utopiques. On peut les énoncer sous forme de postulats.
Premier postulat : les provinces étant antérieures au gouvernement central, c’est d’abord à elles qu’il revenait de proposer les réformes dont le régime politique canadien avait grand besoin. Elles jouissaient sur Ottawa d’une primauté qui ressemblait, chez Bertrand, à un droit d’aînesse.
Deuxième postulat : le fédéralisme canadien visait, comme raison d’être initiale, à la sauvegarde permanente de l’autonomie des provinces. D’après Bertrand, c’était là l’“esprit de 1867”, celui des Pères de la Confédération.
Troisième postulat : chaque ordre de gouvernement, fédéral et provincial, était entièrement souverain quant à ses propres attributions. Il devenait donc inadmissible, en saine doctrine, que l’un tentât d’influencer ou d’orienter l’exercice des compétences de l’autre, encore moins qu’il envahît par des moyens détournés ses domaines de responsabilités. Directe ou indirecte, cette façon d’agir représentait un abus de pouvoir doublé d’une perversion de l’idéal fédéraliste.
Quatrième postulat : le fédéralisme canadien résultait d’un pacte conclu entre anglophones et francophones, pour cette raison, les Canadiens français vivant hors du Québec étaient en droit de s’attendre de leurs gouvernements provinciaux à des privilèges semblables à ceux que le Québec reconnaissait à sa minorité anglophone.
[…] En théorie, le fédéralisme souhaité par Bertrand pouvait exister. À condition de ne pas être vicié par des manœuvres partisanes plus ou moins perfides, des rivalités interrégionales plus ou moins égoïstes, des frictions plus ou moins rationnelles entre nationalités ou d’autres accidents de parcours plus ou moins dus à des calculs tactiques d’arrivistes fédéraux, provinciaux ou locaux. Autrement dit : son fédéralisme fonctionnerait dans la mesure où les politiciens seraient tous de bonne foi, gardant vaillamment le cap sur la réalisation de ce que saint Thomas d’Aquin, l’une des autorités parfois invoquées par Bertrand, décrivait comme le bien commun. »
Claude Morin relate que « Bertrand n’exerça pas, sur ses collègues des autres gouvernements, le même charme que Johnson. Tous s’entendaient pour le considérer comme un honnête homme, sympathique, nullement distant, exprimant son point de vue avec clarté, sans aigreur. Personne ne ressentait le besoin de décoder ses sous-entendus, car il n’y en avait pas. Il s’intégra sans difficulté au club des premiers ministres. Avec les membres de la délégation québécoise, ses relations demeurèrent toujours amicales et empreintes de simplicité. »
Claude Morin ajoute : « Comme Lesage, il approuvait mes projets de documents fédéraux-provinciaux aussitôt lus et ne suggérait pratiquement pas de modification. Pas question non plus, comme le faisait Johnson, d’en soupeser chaque mot et d’en évaluer chaque phrase, en soirée et même la nuit, en compagnie d’un patient et respectueux aréopage de collègues et de collaborateurs jetant alternativement un coup d’œil furtif sur l’horloge et un autre, plus attentif, sur les textes à étudier. »
Claude Morin affirme que « Sa vitesse de réaction s’étendait aussi aux réponses aux communications provenant de Trudeau ou d’autres ministres fédéraux. […] Un jour, Mitchell Sharp, devenu ministre des Affaires extérieures du Canada, prétendit, dans une lettre à Bertrand, qu’en vertu de ses responsabilités en matière de politique étrangère le gouvernement fédéral se devait de participer aux conférences internationales francophones sur l’éducation. Autrement dit, lui seul pouvait y parler au nom de l’ensemble du pays. Cette argumentation n’était pas nouvelle, mais la lettre de Sharp laissait sous-entendre que, du moment qu’elle faisait l’objet de pourparlers avec d’autres pays, l’éducation entrait dans la sphère de compétence d’Ottawa. Le Québec avait toujours rejeté cette interprétation.
L’occasion était belle de démontrer à Sharp que, privé de compétence constitutionnelle en éducation, Ottawa n’avait aucun droit, en ce domaine, de parler à la place de quelque province que ce soit, surtout pas du Québec. Je n’ai malheureusement pas retrouvé la réponse de quatre ou cinq pages à laquelle je consacrai plusieurs heures de préparation. L’objectif de cette lettre était de coincer les fédéraux dans une argumentation politico-logique serrée. Bertrand consentirait-il à la signer telle quelle ? On pouvait en douter. Il voudrait certes en modifier les passages les plus polémiques, car elle prenait Ottawa de front à propos d’une question qui avait le don d’irriter Trudeau.
Y ayant ajouté la note : “Que diriez-vous de cette réponse à Sharp ?”, je transmis à Bertrand mon projet prêt pour signature. Vingt minutes plus tard, un messager me rapporta la lettre. Signée et sans autre annotation que : “Fais-en une copie pour mes dossiers”. Un record de diligence. Bertrand s’était-il vraiment rendu compte de la portée de ce qu’il venait de signer ? Comment le savoir ? Une idée : je me rendrais à son bureau de manière routinière et, en entrebâillant sa porte, lui demanderais simplement s’il avait reçu mon projet ; il ignorait peut-être encore qu’un messager me l’avait déjà retourné. Bonne excuse, mine de rien, pour échanger un ou deux mots sur son contenu et sur la réaction prévisible de Trudeau.
— Ta lettre était correcte. Tu vas la recevoir, signée, d’une minute à l’autre, répondit-il. Je décidai d’aller à la pêche : Vous n’avez pas peur que Trudeau monte dans les rideaux, lui répliquai-je, espérant une réaction sur son contenu. Trudeau grimpera dans tous les rideaux qu’il veut. Avec l’éducation, nous sommes en terrain solide. Puis il ajouta, haussant un peu le ton : — Dis donc, t’imagines-tu que je signe sans lire ? Non, jugeai-je séant de préciser, mais je pensais que vous laisseriez mûrir la lettre un ou deux jours, quitte à ce qu’on en reparle. À trop mûrir, on pourrit ! Décréta-t-il, citant Sainte-Beuve. »
Claude Morin déclare : « Aussi m’arriva-t-il d’apprendre de lui, surtout au début, qu’il venait “en principe” de s’entendre avec Trudeau (ou avec quelqu’un d’autre parlant en son nom) sur des questions litigieuses faisant depuis longtemps l’objet de discussions entre fonctionnaires québécois et fédéraux. Ce fut particulièrement le cas en matière de relations internationales. Technique qui m’obligeait, ensuite, à “remonter le courant” pour expliquer à Bertrand que son engagement hâtif mènerait à une modification des positions jusque-là défendues par le Québec. Était-ce bien son intention ? Si oui, fort bien. Sinon… Il était souvent le premier à constater s’être trop avancé dans des conversations qu’il avait jugées, sur le coup, sans conséquence sérieuse et à me demander de corriger le tir, blâmant les fédéraux d’avoir abusé de sa bonne foi. »


Affiches du candidat à la chefferie Pierre-Elliott Trudeau. Parti libéral du Canada. 1968.
Collection Dave Turcotte
La corruption
O’Neill et Benjamin rappellent que « la culture partisane sous-jacente à cette époque allant de la fin de 1968 jusqu’à l’élection d’avril 1970 tient à deux grands traits : l’impression des militants que des gens, présumés membres de la pègre, faisaient des affaires d’or avec le gouvernement, et aussi l’impression que le pouvoir n’appartenait pas au Conseil des ministres, mais à un obscur petit groupe manipulant le premier ministre. […] Cette culture partisane s’alimentait, entre autres, des confidences de ministres en poste qui avouaient ne jamais venir au Club Renaissance de Montréal de peur d’y découvrir des tractations « pas très catholiques » : en voyant le type d’individus qui se trouvaient au rez-de-chaussée, hommes de main des caïds, ils s’imaginaient bien quel genre d’individus se trouvaient à l’étage, en train de brasser des affaires. […] Certes, des contributions financières du monde interlope en échange de protection font partie, dans une certaine mesure, de nos mœurs politiques nord-américaines : il serait naïf de croire à la « propreté » totale des caisses électorales de tous les partis américains, canadiens ou québécois. Mais en dix-huit ans, ce fut sans doute le seul moment où la culture politique québécoise a cru cette présence capable d’exercer une influence certaine sur le pouvoir. Deux témoignages pourraient corroborer cette culture partisane : le premier est tiré du Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec et rappelle des propos tenus par le ministre Jean-Noël Tremblay à la suite du congrès de juin 1969 consacrant le premier ministre Bertrand comme chef du parti aux dépens de Me Jean-Guy Cardinal ; ces propos mentionnaient la présence « de la mafia dans le parti de l’Union nationale du temps ». Le premier ministre Bourassa a également fait état d’un enregistrement en possession de la Sûreté du Québec, dans lequel un des présumés leaders de la pègre montréalaise — qu’il identifie nommément — parlait « de ses amis de l’Union nationale auxquels il ne fallait pas toucher ».
O’Neill et Benjamin avancent que « ce type de climat politique se retrouve chez les militants de la base de l’U.N — qui, à cette époque, parlaient de conjuration contre le premier ministre. En 1968-69 en effet, plusieurs membres du Bureau du premier ministre, demeurés à leurs postes après la mort de M. Johnson, étaient perçus comme hostiles à M. Bertrand. […] Cette impression qu’une clique d’organisateurs politiques détenait la réalité du pouvoir s’est propagée à la suite de certaines réunions du Conseil des ministres. Lors de ces réunions, en effet, des décisions fermes étaient prises, puis totalement ignorées — ce qui irritait particulièrement les ministres les plus touchés. Ils répandirent la rumeur qu’un groupe de l’Union nationale — une demi-douzaine d’organisateurs et de financiers de l’entourage de M. Bertrand — contrôlait toutes les décisions administratives, et même les décisions prises par le Conseil des ministres. On désignait sous le nom de “la main noire” ce groupe d’organisateurs et de financiers, véritables dirigeants de l’Union nationale. »



Photographies de Jean-Jacques Bertrand. Janvier 1969.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Antoine Desilets
Bilan du gouvernement Bertrand
Au chapitre des réalisations du gouvernement Bertrand, nombreuses sont généralement associées à la Révolution tranquille : adoption de la Loi 30 créant la Régie de l’assurance-maladie du Québec, création du réseau de l’Université du Québec, du Protecteur du citoyen, de Loto-Québec, de Radio-Québec et de la Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP) et des communautés urbaines. Le ministère des Communications est créé le 23 décembre 1969.
C’est pendant son mandat qu’on abolit le Conseil législatif, que l’Assemblée législative devient l’Assemblée nationale et que l’orateur en devient le président. C’est aussi son gouvernement qui reconnaît aux Autochtones le droit de vote aux élections québécoises. Claude Morin précise que c’est son gouvernement qui règle « le problème des “comtés protégés” grâce auxquels, dès 1867, la minorité anglophone du Québec se vit, nonobstant l’évolution démographique, garantir sa représentation à l’Assemblée législative. »
C'est à la première ouverture de session suivante, le 25 février 1969, que « l'Assemblée abandonne la tradition qui consiste à présenter, pour la forme, avant le débat sur le discours du trône, le “bill” 1 sur la prestation des serments d'office. Cette tradition avait pour but de manifester l'indépendance de l'Assemblée face au pouvoir royal. » - Site de l'Assemblée nationale


Sur la photographie de gauche : Jean-Jacques Bertrand marche avec le lieutenant-gouverneur Hugues Lapointe dans la salle du conseil législatif (salon rouge), vidée de son conseil depuis son abolition en 1968. Elle sert maintenant de salle de réceptions, de commissions ou de caucus.
Photographies de l'ouverture de la 5e session de la 28e législature à l'Assemblée nationale du Québec. Photo moderne enrg. 24 février 1970
Collection Assemblée nationale du Québec
Élection québécoise de 1970
Claude Morin écrit que « nul besoin de présenter ici un relevé complet de ses réalisations ni de prétendre qu’elles furent toutes imaginées sous son règne — certains projets étaient en gestation sous Johnson — pour retenir que Bertrand manifesta plus de dynamisme que ses contemporains ne s’en rendirent compte, peut-être parce qu’ils ne prêtaient plus attention à sa gouverne de l’État. En 1969-1970 la désaffection à l’endroit du gouvernement unioniste s’aggravait, coincé qu’il était entre les libéraux qui se donneraient bientôt un nouveau chef, Robert Bourassa, et le Parti québécois naissant. On peut penser que, dans ces conditions, eût-il voulu expliquer ses politiques aux électeurs, ceux-ci n’auraient plus eu le goût d’écouter. Modeste par tempérament et peu enclin à se vanter, Bertrand réprouvait la propagande gouvernementale, fatalement fondée selon lui sur des manipulations politiciennes douteuses et, de ce fait, malhonnêtes. Il n’aurait pas dû raisonner ainsi : l’information objective et factuelle est aussi une forme de propagande. Les apparences sont, comme les impressions, la matière première de la politique. »
O’Neill et Benjamin complètent : « Le premier ministre Bertrand méritait mieux, prétendent certains ; sa vulnérabilité l’a tué. Sa réputation avait été surfaite, répondent les autres ; ses dix-huit mois de pouvoir l’ont révélé tel qu’il était, sans que les spécialistes en publicité aient eu à l’amoindrir aux yeux de l’Histoire. […] Avant 1968, l’image de M. Bertrand a été le fruit de médias, dira un jour l’ancien ministre Marcel Masse. Lorsqu’il a accédé au poste de premier ministre, puisqu’il n’a pas été conforme à l’image qu’on s’en faisait, évidemment on a été doublement déçu, tant à l’intérieur du parti que dans la population. Depuis 1961, en effet, l’image de M. Bertrand avait été établie en contraste avec celle de M. Johnson : d’abord l’homme honnête, puis le nationaliste. Cela provenait du besoin des médias de créer un bon et un méchant, disait M. Masse. Arrivé au pouvoir, M. Bertrand, “qui était bien conscient de la différence entre son potentiel personnel et cette image”, dut par conséquent se fier aux spécialistes de la publicité ; il ne s’aperçut que trop tard de leur infidélité. »
O’Neill et Benjamin soulignent qu’en « 1970 tout le monde se croyait capable de faire gagner l’U.N. : Ronald Corey, qui avait été engagé par M. Bertrand comme secrétaire de presse ; Jacques Bouchard (qui avait fait la publicité de Bertrand à la chefferie de 1969) ; Jean Loiselle, qui était maintenant sous-ministre de l’immigration ; et enfin l’agence de publicité SOPEQ. […] Tout le monde, ou presque, se mêlait de concevoir la publicité de l’Union nationale, dont SOPEQ, qui n’aimait pas beaucoup M. Bertrand. Certains éléments de cette protection de l’image ont d’ailleurs déplu aux fidèles alliés de M. Bertrand. Par exemple, la publicité en très petits caractères publiée dans les quotidiens à grand tirage à la fin de la campagne — publicité peu attrayante et difficile à lire — et la photo officielle de M. Bertrand. Lorsque le choix de cette photo s’est effectué, deux collaborateurs de l’Union nationale (comptant à eux deux cinquante ans au service du parti) ont nettement cru que l’on choisissait la moins attrayante des photos du leader (“Il avait l’air d’un mort dans son cercueil.”). »
Pierre B. Berthelot prétend que « depuis deux ans, l’avenir de l’Union nationale semblait de plus en plus incertain. Avec la présence de deux nouveaux partis politiques, un pouvant sérieusement le rivaliser sur le terrain nationalisme (le Parti québécois), l’autre sur le terrain du conservatisme (le Ralliement créditiste), le parti de Duplessis n’arrivait plus à jouer son rôle de vaisseau amiral pour ces deux grandes bases électorales. L’avenir du Québec ne se déciderait donc plus seulement selon son autonomie au sein du Canada, mais selon son avenir politique même : serait-il une province ou un pays indépendant ? Dans ce nouveau contexte, incapable d’offrir une solution claire à ces problèmes, avec des troupes fatiguées et démoralisées, l’Union nationale se dirigeait tout droit vers une cuisante défaite aux élections de 1970. »
O’Neill et Benjamin rapportent que « M. Bertrand se désintéressait personnellement de [la] dimension partisane et se fiait totalement aux frères Roland et Fernand Beauregard pour la bonne marche de la machine électorale de la grande région de Montréal. La rédaction du programme électoral de 1970 a été confiée, à la dernière minute, à M. Marcel Masse. MM. Beauregard et Masse assuraient au premier ministre que les adjuvants partisans étaient prêts au combat ; mais, en fait, seul ce petit groupe d’individus se substituait aux contacts avec les militants de la base. »
Gilles Gariépy rappelle qu’en « 1970, les sondages préélectoraux ont révélé un mécontentement général de la population devant les performances du gouvernement U.N. Même les éléments les plus conservateurs, socialement et politiquement, s’estimaient mal servis, puisque l’Union nationale avait, au pouvoir, renié largement ses attitudes du temps de l’opposition. Enfin, les nationalistes qui avaient pu être séduits par le slogan « Égalité ou indépendance » se sont sentis trahis par l’adoption de la loi 63, en 1969, à la suite de la crise de Saint-Léonard. »
Pensant prendre de cours le tout nouveau chef libéral et mettre de côté la crise linguistique ainsi que ses problèmes de leadership, le premier ministre Jean-Jacques Bertrand déclenche, à la surprise générale, l’élection le 12 mars 1970. À ce sujet, Jacques Benjamin ajoute que « L’Union nationale paraît avoir entrepris la campagne électorale de 1970 sans aucune préparation. Les piliers de l’organisation de 1966 avaient été nommés à la tête de Régies d’État ou étaient plus ou moins tombés en disgrâce après avoir appuyé Jean Guy Cardinal à la chefferie du parti l’année précédente. […] Tout le monde, y compris le caucus des députés, s’attendait de toute façon à des élections pour l’automne de 1970. Mais prenant tout le monde par surprise, monsieur Bertrand les fixa au printemps ». Ce qui fait dire à Robert Bourassa : « Vous savez que monsieur Bertrand a essayé de nous prendre les culottes à terre en déclenchant les élections le 11 mars (sic). Mais le 29 avril, c’est lui pis son équipe qui vont avoir les culottes à terre avec la victoire du Parti libéral ». En constatant l’état famélique de l’organisation unioniste et le manque flagrant de préparation, certaines mauvaises langues pourraient dire que le premier ministre Bertrand s’est lui-même surpris en déclenchant l’élection aussi tôt.
Gilles Gariépy relate que « lorsque Bertrand choisit de tenir une élection générale, au printemps de 1970, la situation politique avait beaucoup changé. Le RIN de Pierre Bourgault avait cédé la place au tout nouveau Parti québécois, fondé par un René Lévesque encore très populaire. À droite, éclairés par les succès régionaux obtenus par la coalition du Ralliement national en 1966, les créditistes avaient enfin décidé d’être carrément présents dans l’arène provinciale. Caouette avait fini par s’y résigner. Quant au Parti libéral, remis des blessures laissées par la défection de Lévesque, il venait de se refaire une virginité en portant à sa direction Robert Bourassa, qui était politiquement taillé sur mesure pour canaliser l’insatisfaction populaire devant la stagnation économique. Le scrutin du 29 avril fut, pour l’Union nationale, un désastre. Non seulement le parti perdit le pouvoir : il fut déclassé, dans le suffrage populaire, par le Parti québécois. Entre 1966 et 1970, l’Union nationale — qui n’avait jamais cessé de perdre du terrain depuis 1960 — avait perdu la moitié de sa clientèle électorale. L’U.N. a perdu des votes au profit du Parti libéral, au profit du Parti québécois et à celui du Parti créditiste. »
Le slogan « Québec plus que jamais » est non sans rappeler le fameux « Québec d’abord » qui avait ouvert les portes du gouvernement à l’Union nationale en 1966. Malgré le peu de moyens financiers du Parti Québécois, ce dernier récolte de plus en plus d’appuis, notamment au sein de la base de l’Union nationale, provoquant même une nouvelle question de l’urne. Pour une première fois, la question constitutionnelle devient un thème majeur lors d’une élection. Tellement que pour tenter de conserver ses appuis nationalistes, le premier ministre sortant affirme qu’il « faut enfin que le Québec sache où il va et que le Canada tout entier le sache aussi ». Lors des assises de sa formation politique du 4 avril 1970, il a d’ailleurs ouvert la porte à la tenue d’un référendum sur l’indépendance en 1974 si les négociations constitutionnelles avec le gouvernement fédéral ne débloquaient pas dans le prochain mandat.
Malgré tout, l’Union nationale subit une lourde défaite le 29 avril 1970 et ne réussira plus jamais à prendre le pouvoir au Québec. Le parti de Jean-Jacques Bertrand ne reçoit l’appui que de 19,6 % des électeurs en 1970, une baisse spectaculaire en comparaison aux 40,8 % obtenus en 1966. En nombre de sièges le résultat est aussi sombre, passant de 56 députés en 1966 à seulement 17 en 1970 ne réussissant même pas à faire réélire plusieurs ministres. L’arrivée en scène du Ralliement créditiste de Camil Samson et du Parti Québécois de René Lévesque explique en partie cette dégringolade. Le Parti Québécois a dépouillé bon nombre de ses appuis dans les villes et le Ralliement créditiste ses appuis en ruralité.
Le Parti libéral de Robert Bourassa est porté au pouvoir avec 72 députés (45,4 % des voix). L’Union nationale retourne dans l’opposition avec seulement 17 députés (19,6 % des voix), aux côtés de 12 députés créditistes (11,19 % des voix). L’Union nationale arrive au troisième rang en termes de votes avec 19,65 % des voix, derrière le nouveau Parti québécois (23,06 %) qui ne fait élire que 7 députés. Bertrand laisse les clés du pouvoir à son successeur Robert Bourassa le 12 mai 1970.
...

Résultats de l'élection québécoise de 1970 dans la circonscription de Missisquoi.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec




Photographies de la campagne électorale du chef Jean-Jacques Bertrand. 3, 24 et 29 avril 1970.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographes Paul Henri Talbot et Pierre McCann
PREMIER MINISTRE


Macaron du premier ministre Jean-Jacques Bertrand. Production Le Macaronier. Vers 1980.
Collection Dave Turcotte


Carte de vœux des fêtes de Jean-Jacques Bertrand. Vers 1968.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne


Carte de vœux des fêtes de Jean-Jacques Bertrand. Vers 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
1968

Carton d'invitation à un cocktail du Club Renaissance de Québec où Jean-Jacques Bertrand est invité d'honneur, 27 novembre 1968.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
1969



Selon Anne Caroline Desplanques : « Au Québec, le plus important abri antiatomique est situé sur la base militaire de Valcartier. C’était le siège régional du gouvernement d’urgence. 400 hauts fonctionnaires, politiciens provinciaux et responsables militaires pouvaient s’y réfugier. Mais comme le Diefenbunker et le Trou, le bunker de Valcartier serait incapable de faire face à une bombe moderne. Tous peuvent résister à une bombe de quatre à cinq mégatonnes, soit plus de 300 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima en 1945. […] Malgré cela, un confinement a été envisagé dans nos bunkers en 1962, durant la crise des missiles de Cuba. Complètement obsolète, le bunker de Valcartier, comme les autres, a donc cessé d’être utilisé dans sa vocation d’origine. Il demeure cependant fermé au public, car il sert encore à l’armée comme bureaux, salles de classe, lieu d’hébergement temporaire et lieu d’entraînement. »
Photographies de la visite de Jean-Jacques Bertrand au parlement souterrain (secret) à Valcartier. Photo moderne enrg. 30 septembre 1969
Collection Assemblée nationale du Québec

Message de Jean-Jacques Bertrand lors de la 58e édition d'Expo-Québec. Vers 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Photographie de presse de John Bateman, receveur des Expos de Montréal, qui serre la main à Jean-Jacques Bertrand au moment du lancer protocolaire lors de la première partie de la Ligue nationale de Baseball en dehors des États-Unis d'Amérique. United Press International Photo. 14 avril 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Yves Beauregard
Chefferie 1969
L'Union nationale tient du 19 au 21 juin 1969 au Colisée de Québec son congrès à la chefferie pour officialiser la nomination de Bertrand. Fait rare, il a de l’opposition au sein même de son caucus. Il fait face à son propre vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, Jean-Guy Cardinal, et à un de ses députés André Léveillé. Le site internet Bilan du siècle rapporte que « Bertrand part favori, mais Cardinal mène une campagne dynamique axée sur des thèmes comme la modernisation de l’État, le redressement de l’économie québécoise et la nécessité de mettre de l’ordre dans la fonction publique. Le 21 juin, jour du vote, les débats sont houleux à l’intérieur et à l’extérieur du Colisée puisque 3 000 manifestants provenant de groupes de gauche se frottent aux forces policières. C’est finalement Jean-Jacques Bertrand qui remporte la victoire, obtenant le soutien de 1 325 délégués, contre 938 pour Cardinal et 22 pour Léveillé. Le ralliement de Cardinal ne suffit pas à masquer l’amertume de ses troupes, une réaction qui incite le premier ministre à déclarer dans son discours final : “Il est maintenant important que nous nous serrions les coudes. Unis, nous vaincrons.” » Tout comme pour le Parti libéral, ce congrès au leadership laissera des séquelles au sein de l’organisation unioniste.

Macaron du congrès de l'Union nationale des 19, 20 et 21 juin 1969 à Québec. Union nationale. 1969.
Collection Dave Turcotte
Pages 1, 9 à 12 et 15 du magazine Sept-Jours, 3e année no.33. 3 mai 1969.
Collection Dave Turcotte
Pages 1, 9 à 13 et 17 du magazine Sept-Jours, 3e année no.39. 14 juin 1969.
Collection Dave Turcotte
Jean-Jacques Bertrand


Pochette du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne


Éventail du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne


Macaron du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Collection Dave Turcotte
Macaron du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Collection Dave Turcotte
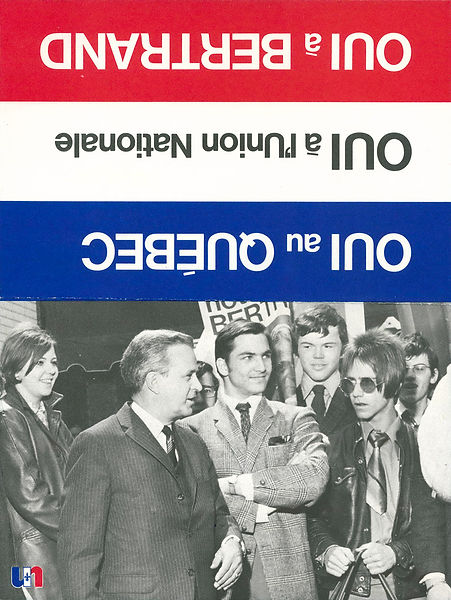

Carton d'information du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne






Cartes postales du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Programme du congrès à la chefferie identifié aux couleurs du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Carton annonçant les lieux de rencontre du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Paroles de la chanson-thème du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Bande en papier pour faire un chapeau identifiée aux couleurs du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Page couverture de la brochure promotionnelle du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
Journal de l'Union nationale « Le TéléBertrand », vol. 1, no 11. 20 juin 1969
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne

Autocollant du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Provenant d'une collection privée

Autocollant du candidat à la chefferie Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1969.
Provenant d'une collection privée
Jean-Guy Cardinal




Macarons du candidat à la chefferie Jean-Guy Cardinal. Union nationale. 1969.
Collection Dave Turcotte

Macaron du candidat à la chefferie Jean-Guy Cardinal. Union nationale. 1969.
Collection Dave Turcotte




...
Disque du candidat à la chefferie Jean-Guy Cardinal. Union nationale. 1969.
Collection Dave Turcotte
1970

Page couverture du journal Le Temps, vol. 31 no. 6. Union nationale. 31 mars 1970.
Collection Alain Lavigne
Programme électorale de l'Union nationale. Union nationale. 1970.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Affiche du chef unioniste Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1970.
Collection Dave Turcotte

Affiche du chef unioniste Jean-Jacques Bertrand. Union nationale. 1970.
Collection Dave Turcotte

Sur la photo : le ministre Jean-Guy Cardinal (au micro), le député d'Iberville Alfred Croisetière (derrière l'orateur), le candidat dans Saint-Jean Rolland Tremblay, homme à identifier, le premier ministre Jean-François Bertrand et son épouse, l'épouse du maire de Saint-Jean Bruno Choquette et lui-même.
Photographie d'un rassemblement de l'Union nationale dans la circonscription de Saint-Jean. Photographe Ken Wallett. 1970.
Collection journal Le Canada français

Le Petit journal a offert une page à chaque parti politique pour présenter les faits saillants de leur programme. Voici la page de l'Union nationale.
Page 39 du journal Le Petit journal. 26 avril 1970.
Collection Dave Turcotte

Page une du journal Montréal-Matin prédisant l'élection du candidat péquiste Pierre Bourgault dans Mercier face au chef libéral Robert Bourassa selon un sondage CROP. Journal Montréal-Matin. 28 avril 1970.
Collection Dave Turcotte

Publicité de l'Union nationale. Journal Montréal-Matin. 28 avril 1970.
Collection Dave Turcotte
Le chef de l'opposition
Devient chef de l'opposition officielle
Après la défaite de l’Union nationale aux élections, Jean-Jacques Bertrand devient le chef de l’opposition officielle. Le 6 novembre 1970, peu de temps après le conseil national de son parti, il annonce qu’il quitte la direction de l’Union nationale. Un congrès à sa succession est convoqué pour juin 1971. Son successeur est Gabriel Loubier, un ancien ministre dans les cabinet Johnson et Bertrand. Bertrand lui laisse les reines de l’opposition officielle le 19 juin 1971, mais demeure député.

Affiche de l'association de l’Union nationale de la circonscription de l’Islet.
Assemblée nationale du Québec
Collection Alain Lavigne
Photographe : Gaby (Gabriel Desmarais)
Artiste : [Jan Guy ?]
CHEF DE L'OPPOSITION

Photographie officielle de Jean-Jacques Bertrand. 1970.
Collection Assemblée nationale du Québec
Photographe : W.B. Edwards




Photographies du congrès à la chefferie de l'Union nationale des 18 et 19 juin 1971.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographes Jean-Yves Létourneau

Gabriel Loubier est le successeur de Jean-Jacques Bertrand comme chef de l'Union nationale. Il est élu député unioniste dans Bellechasse en 1962. Il est réélu en 1966 et en 1970. Il est ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche dans les cabinets Johnson et Bertrand du 16 juin 1966 au 12 mai 1970. Il est ministre responsable du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports de septembre 1967 à 1970. Le 19 juin 1971, il est élu chef de l'Union nationale, qui porte le nom d'Unité Québec du 25 octobre 1971 au 14 janvier 1973. Il est défait en 1973. Il démissionne de son poste de chef du parti le 30 mars 1974.
Page une du magazine Maclean. Juin 1967.
Collection Dave Turcotte


Le citoyen
Implication
Très impliqué dans sa région et politiquement, il est membre des Chevaliers de Colomb, du Club Renaissance, du Club de la garnison et du Club Saint-Denis.
Distinctions
Il reçoit des doctorats honoris causa des universités Bishop’s et Ottawa en 1959, Sherbrooke en 1967 ainsi que Montréal et Laval en 1969.


Photographies de la remise du doctorat honoris causa de l'Université de Montréal par Me Guy Guérin à Jean-Jacques Bertrand. 31 mai 1969.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Antoine Desilets
Décès
Jean-Jacques Bertrand décède d’une crise cardiaque à Montréal, le 22 février 1973, à l’âge de 56 ans et 8 mois. Il est toujours député lors de son décès. Conrad Black note qu’il « était le doyen de l’Assemblée nationale (dont il avait changé le nom), y ayant été élu sept fois, et après une vie entière dévouée “aux plus hautes vertus humaines et civiques” pour reprendre les mots de Claude Ryan dans Le Devoir. »
C’est 3 000 personnes qui lui rendent un dernier hommage lors des funérailles à la petite église paroissiale située à quelques pas de sa résidence. Il est inhumé au cimetière de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima, à Cowansville, le 25 février 1973. Son modeste monument funéraire rappelle qu’il a été « Premier ministre du Québec 1968-1970 » et « Député de Missisquoi 1948-1973 ». Il est décoré d’une fleur de lys à l’allure ancienne.
Jean-Jacques Bertrand est désigné personnage historique le 1er novembre 2012.
Claude Morin avance que « cela tient probablement à son style, peu flamboyant en comparaison de celui de Lesage, et à sa personnalité, plus ouverte que celle d’un Johnson dont la démarche, davantage intrigante, attirait l’attention : toujours est-il que Bertrand a laissé le souvenir d’un premier ministre plutôt terne. On éprouve de la difficulté à l’associer spontanément à des actes précis, sauf, mais de manière négative, en ce qui a trait au “Bill 63”, législation linguistique qui devint pour lui une colossale épreuve. Je crois pouvoir dire que l’impression floue qui subsiste encore aujourd’hui à l’endroit de Bertrand est assez injuste. Il n’exerça le pouvoir que pendant un an et demi à peine, mais réussit, au cours de cette brève période, à faire adopter plus de réformes et à mettre en place plus d’innovations que son prédécesseur, moins porté que lui à prendre des décisions catégoriques. Cela n’est pas une critique rétroactive de Johnson, mais un effort pour rappeler des faits oubliés. Les décisions de Bertrand n’eurent pas toutes une portée considérable et peu sont comparables aux grands virages spectaculaires de l’époque Lesage, comme la nationalisation de l’électricité, le régime de rentes, la Caisse de dépôt et placement ou la récupération fiscale. Elles furent cependant variées. S’il changea le nom de l’Assemblée législative en celui d’Assemblée nationale, mesure d’ordre symbolique qui intervint deux semaines après son accession au poste de premier ministre, il compta aussi à son actif plusieurs autres réalisations d’ordre concret. »

Avis de décès de Jean-Jacques Bertrand. La Voix de l'Est. 23 février 1973.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec




Photographies des funérailles de Jean-Jacques Bertrand. 25 février 1973.
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
Photographe Robert Nadon
LE CITOYEN

Page une du journal La Tribune. 23 février 1973.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Page une et deux du journal La Voix de l'Est. 23 février 1973.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Page une du journal L'Action-Québec. 26 février 1973.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Photographies du lieu de sépulture du premier ministre Jean-Jacques Bertrand.
Collection Dave Turcotte

Photographie de l'église de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima à Cowansville, lieu des funérailles du premier ministre Jean-Jacques Bertrand.
Collection Dave Turcotte
Pages 1, 6, 16 et 24 de l'Album souvenir publié suite au décès de Jean-Jacques Bertrand. 1973.
Collection Alain Lavigne
Je me souviens
Lieux de mémoire
Découvrez (virtuellement) les régions du Québec à travers la vie de nos premiers ministres. Cette carte interactive vous fera découvrir où ils sont nés, où ils ont habités, étudiés, travaillés ainsi qu’où ils sont décédés et enterrés. Elle indique aussi les quelques musées à visiter, les monuments en leur honneur ainsi que les lieux rappelant leur mémoire par la toponymie. Cette carte est loin d’être exhaustive. Elle sera toujours en développement.
Légende de la carte

JE ME SOUVIENS

Photographies de panneaux de voies de communication rendant hommage au premier ministre Jean-Jacques Bertrand.
Collection Dave Turcotte
Sources
Livres
Assemblée nationale du Québec (1980). Répertoire des parlementaires québécois 1867–1978. Québec : Assemblée nationale.
Benjamin, Jacques (1975). Comment on fabrique un Premier ministre québécois. Montréal : Éditions de l'Aurore.
Berthelot, Pierre B. (2021). Duplessis est encore en vie. Québec : Les éditions du Septentrion.
Black, Conrad (1977). Duplessis : Le Pouvoir. Montréal : Les Éditions de l'Homme.
Blais, Christian, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre (2008). Québec, quatre siècles d'une capitale. Québec : Les Publications du Québec.
Commission de la Capitale nationale du Québec (1999). Je me souviens. Les monuments funéraires des premiers ministres du Québec. Québec : Commission de la Capitale nationale du Québec.
Ferretti, Lucia (1994). L’université en réseau. Les 25 ans de l’Université du Québec. Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.
Gariépy, Gilles (1975). L'Union nationale meurt, le Parti québécois naît et les libéraux règnent dans Une certaine révolution tranquille. Montréal : La Presse.
Gervais, Albert. (1984). Daniel Johnson. Célébrités canadiennes. Montréal : LIDEC.
Gignac, Benoit (2008). Québec 68 : l'année révolution. Montréal : Les Éditions La Presse.
Gignac, Benoit (2007). Le Destin Johnson. Montréal : Les Éditions internationales Alain Stanké.
Godin, Pierre (1980). Daniel Johnson : 1946-1964 la passion du pouvoir. Montréal : Les Éditions de l'Homme.
Godin, Pierre (1980). Daniel Johnson : 1964-1968 la difficile recherche de l'égalité. Montréal : Les Éditions de l'Homme.
Guay, Jean-Herman et Serge Gaudreau (2018). Les élections au Québec : 150 ans d’une histoire mouvementée. Québec : Les presses de l’Université Laval.
Holden, Richard B. (1970). Élection 1970, Le point tournant. Montréal : Éditions Ariès.
Labelle, Marcel (2007). Adélard Godbout. Précurseur de la Révolution tranquille. Montréal : LIDEC.
Lamarche, Jacques (1997). Les 27 premiers ministres. Montréal : Éditions LIDEC.
Latouche, Daniel ; Lord, Guy et Jean-Guy Vaillancourt (sous la direction de) (1976). Le processus électoral au Québec : les élections provinciales de 1970 et 1973. Montréal : Hurtubise HMH Ltée.
Lavigne, Alain (2018). Bourassa et Lévesque : Marketing de raison contre marketing de passion. Québec : Les éditions du Septentrion.
Lemieux, Vincent ; Gilbert, Marcel et André Blais (1970). Une élection de réalignement, l'élection générale du 29 avril 1970 au Québec. Montréal : Éditions du Jour.
Morin, Claude (1991). Mes premiers ministres : Jean Lesage, Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa et René Lévesque. Montréal : Les éditions du Boréal.
O'Neill, Pierre et Jacques Benjamin (1978). Les mandarins du pouvoir. Montréal : Éditions Québec / Amérique.
Rumilly, Robert (1978). Maurice Duplessis et son temps. Tome II. Montréal : FIDES
Smith, Bernard (1970). Les élections 1970 au Québec. Le Coup d'état du 29 avril. Montréal : Éditions Actualité.
Smith, Frédéric. Les résidences des premiers ministres du Québec. Québec : Commission de la Capitale nationale du Québec.
Vien, Christian et Dominique Lapointe (1969). L'Union nationale : son histoire, ses chefs, sa doctrine. Ottawa : Les Éditions du Mercredi.
Articles
Desplanques, Anne Caroline (2023). Menace nucléaire : Des centaines de bunkers au pays. Journal de Montréal (Montréal).
Farfan, Matthew (2013). Jean-Jacques Bertrand (1916-1973), premier ministre du Québec. Cybermagazine Patrimoine des Cantons (Sherbrooke).
Gagnon, Jacques (2015). Trois grandes familles de parlementaires issues des Cantons-de-l’Est. Revue d’Études des Cantons de l’Est (Sherbrooke).
Massé, Stéphanie (2018). Le 18 décembre 1968 : naissance du réseau de l’Université du Québec. Neo UQTR (Trois-Rivières).
Audiovisuel
Arcand, Denys. (1972). Québec : Duplessis et après... Élections 1970 : et si Duplessis était encore vivant? [DVD]. Montréal : ONF.
Cossette-Trudel, Jacques. (2000). Une révolution tranquille 1960-1980 [DVD]. Montréal : Imavision.
Sites
Bilan d'un siècle (Chefferie 1961)
Bilan d'un siècle (Chefferie 1969)
Conseil du patrimoine culturel
Cowansville (Maison Giroux-Bertrand)
Musée québécois de la culture populaire - exposition Le début d’un temps nouveau (Projet de loi 63)
Musée québécois de la culture populaire - exposition Le début d’un temps nouveau (Élection 1966)
Wikipédia (États généraux du Canada français)