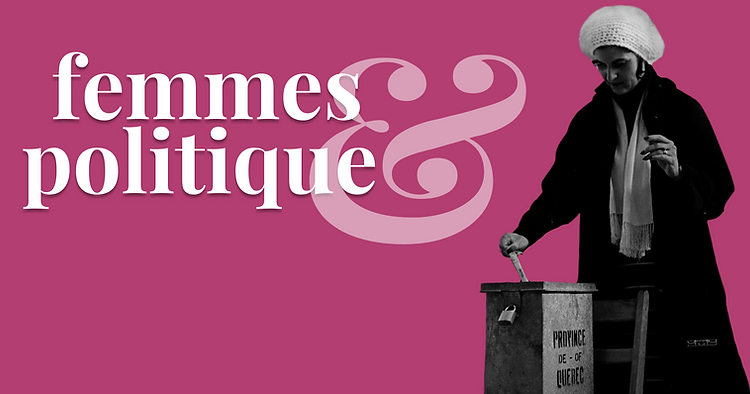
Suffrage féminin
Saviez-vous qu’en 1791, avec l’Acte constitutionnel, certaines femmes se sont vu octroyer le droit de vote ? Ce droit de vote, qui n’est reconnu qu’à certaines catégories de propriétaires et de locataires sans égard à leur sexe, donne le goût à certaines femmes d'y recourir. Elles sont les seules de l’Empire britannique à se prévaloir de cette ambiguïté. Cependant, des hommes influents dont, Louis-Joseph Papineau, s’opposent à l’exercice de ce « privilège contraire à [la] nature de mère et d’épouse ». La pression est si forte que les femmes cessent de se porter candidates. En 1834, le droit de vote est retiré aux femmes mariées et en 1849, le Parlement adopte une loi qui abolit formellement le droit de vote pour toutes les femmes.
Les suffragistes doivent mener de rudes batailles juridiques et politiques pour que les Québécoises obtiennent le droit de vote. Denyse Baillargeon explique que « Le terme “suffragettes” est généralement réservé à une partie des militantes, surtout britanniques, qui se sont tout particulièrement fait remarquer par la vigueur de leur lutte et même la violence de leurs actions. Par opposition, celles qui ont adopté des tactiques moins radicales et plus pacifiques sont qualifiées de suffragistes. » C’est d’ailleurs le cas au Québec.
Le Parti socialiste ouvrier exige dans son manifeste de 1894, le droit de suffrage universel pour tous, sans considération de croyance, de couleur ou de sexe. En 1912, Carrie Derick fonde la Montreal Suffrage Association, premier mouvement organisé, orienté principalement vers l’obtention du droit de vote des femmes au fédéral. Six ans plus tard, les femmes obtiennent le droit de vote au fédéral.

En 1921, des Québécoises francophones et anglophones se rassemblent et créent le Comité provincial pour le suffrage féminin. Le 9 février 1922, le Comité mène une délégation de 400 femmes à Québec et rencontre le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Celui-ci leur affirme que si elles obtiennent un jour le droit de vote, ce n’est pas lui qui le leur aura accordé. De 1927 à 1940, des délégations de femmes se rendent annuellement au Parlement de Québec pour assister à la présentation d’un projet de loi pour le vote des femmes. Chaque fois, le projet de loi est rejeté. Voici quelques citations de députés de l’époque sur le sujet :
« On se plaint que notre Code civil ne donne pas aux femmes les mêmes droits qu’il accorde aux hommes. C’est vrai. Mais il ne lui impose pas non plus les mêmes obligations. Il tient compte du rôle que la nature a assigné à chacun. S’il n’en était ainsi, la femme serait moins bien protégée, elle risquerait de n’être plus femme. […] Il faut tenir compte de ce qu’elle est et de ce qu’elle doit être. Tout être humain a sa loi dont il ne peut s’affranchir impunément, et la loi de la femme, le seul droit de la femme est en regard de la maternité. […] Nous tenons à écarter la femme de la vie publique. Nous avons besoin que nos mères restent nos mères. Plus nous voulons écarter la femme de la vie publique, plus nous lui devons de respect dans la vie privée. Le foyer lui appartient comme elle appartient au foyer. La femme doit rester au foyer. C’est là seulement qu’elle trouvera, sinon une égalité à laquelle elle ne tient pas, son droit d’être honorée du mari et obéie de ses enfants, et qu’elle conservera l’autorité qui lui appartient, c’est-à-dire l’autorité morale. »
– Joseph-Éphraïm Bédard, député de Québec-Comté (23 février 1928)
« Cette question de vote a depuis longtemps suggestionné l’imagination des Ontariennes et a même fini par s’infiltrer quelque peu chez nous. On s’explique que nos voisines cherchent à occuper les loisirs que leur laisse une famille restreinte et souvent inexistante. Il va tout autrement chez nos Canadiennes françaises où le désœuvrement domestique est chose inconnue, à raison des nombreuses familles qui accaparent l’attention de la mère et de ses filles. Je crois qu’il est plus pratique et il n’y a pas de doute qu’il est autrement méritoire de faire, comme nos bonnes mères de Québec, des électeurs éclairés patriotes que de rêver de faire des électrices ou de fonder un parti mauve ! Josette vaut mieux qu’Emmeline Pankhurst. C’est par le berceau et non par le bulletin de vote que la Canadienne française a fait survivre notre race. Le rôle quelle a joué dans notre histoire est autrement noble et patriotique que celui qu’on voudrait lui poser et qui ne manquerait pas, si elle s’y prêtait, de détourner de sa véritable mission. »
– Raoul-Paul Bachand, député de Shefford (20 janvier 1932)

Portrait de Louis-Alexandre Taschereau
Collection Dave Turcotte
À ce moment, les antisuffragistes jouissent d’un rapport de forces favorable et, même au sein de la population féminine, le droit de vote des femmes ne fait pas l’unanimité. L’opposition de l’Église catholique demeure constante et une pétition de femmes du milieu rural, appuyée par le clergé, recueille 25 000 signatures contre le suffrage féminin. Le 2 mars 1940, le Cardinal Villeneuve s’exprime dans un communiqué : « Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin.
1) Parce qu’il va à l’encontre de l’unité et de la hiérarchie familiale ;
2) parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l’électoralisme ;
3) parce que, en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas ;
4) parce que les réformes sociales, économiques, hygiéniques, etc., que l’on avance pour préconiser le suffrage chez les femmes peuvent être aussi bien obtenues grâce à l’influence des organisations féminines en marge de la politique.
Nous croyons exprimer ici le sentiment commun des évêques de la province. »

Portrait du Cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve. 1939.
Collection Dave Turcotte
Le biographe Conrad Black rappelle que « Maurice Duplessis entretient une correspondance prolongée avec Thérèse Casgrain qui était à la tête d’un mouvement réclamant le droit de vote pour les femmes au Québec. Lorsqu’elle demanda à Duplessis s’il appuierait le projet de loi qui assurerait ce droit, il lui répondit qu’il ne pouvait se prononcer sur un projet dont il ne connaissait pas exactement le contenu, mais il ajouta : “Je donnerai un vote consciencieux, juste, et conforme au désir de la population que j’ai l’honneur de représenter et aux intérêts de la Province en général.” » Il vote contre ledit projet de loi et tous les suivants.
En juin 1938, le Parti libéral tient son congrès à Québec. Des femmes y participent pour la première fois : elles sont 40 sur plus de 800 délégués. Adélard Godbout, jusqu’alors opposé à cette mesure, est confirmé chef du parti, mais le vote féminin est inscrit au programme électoral. Lors de l’élection générale de 1939, les suffragistes québécoises appuient le Parti libéral. Après la victoire de Godbout, lettres, télégrammes et pétitions affluent de partout au Québec pour rappeler au premier ministre la promesse de son parti. Finalement, malgré l’opposition persistante du clergé et des antisuffragistes, un projet de loi sur le suffrage féminin est annoncé dans le discours du trône.
Le premier ministre Godbout déclare en chambre lors du dépôt de son projet de loi : « J’étais honnête autrefois en tenant l’attitude que j’avais, honnête dans ma conscience, et je ne pense pas avoir changé quant à cela. Ce sont les circonstances qui ont changé. Le problème se pose aujourd’hui sous un jour différent. Les conditions dans lesquelles nous vivons font de la femme l’égale de l’homme. Elle a souvent les mêmes devoirs et les mêmes obligations que l’homme, pourquoi lui refuser les mêmes droits, surtout quand bien des questions dont nous avons à décider relèvent plus de sa compétence que de la nôtre ? On a peur que la femme soit soustraite à ses devoirs particuliers. C’est la vie moderne qui l’a sortie du foyer : 100 000 femmes québécoises gagnent actuellement leur vie et celle de leurs proches. Les femmes ont dans notre vie économique une influence qui n’est pas loin d’être prépondérante : elles détiennent plus de 50 % des économies dans les banques et 75 % du capital investi dans les assurances. Elles ont à défendre leur foyer, leurs enfants et leurs biens comme les hommes. Au point de vue économique, pourquoi leur refuser le droit de vote ? »
C’est le 25 avril 1940 que la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur. Le projet de loi no 18, soutenu par le premier ministre Adélard Godbout, avait auparavant été adopté à 67 voix contre 9, le 18 avril 1940 par l’Assemblée législative du Québec. Le Québec est la dernière province à adopter une telle législation. Quatorze projets de loi, déposés entre 1922 et 1939, sont nécessaires pour que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Un ombre au tableau, les femmes autochtones doivent attendre en 1969 pour obtenir ce droit démocratique.

Photographie du chef Adélard Godbout lors du lancement de la campagne libérale. 1939.
Collection famille Godbout
Les premières Québécoises à pouvoir voter sont les électrices des circonscriptions de Huntingdon et de Saint-Jean lors des élections partielles du 6 octobre 1941. Pour l’ensemble du Québec, ce n’est qu’à partir de l’élection générale du 8 août 1944. Le nombre total d’électeurs inscrits est de 1 864 692, alors qu’aux élections précédentes, soit celles du 25 octobre 1939, la liste électorale ne comportait que 753 310 noms.
Mais c’est seulement en juillet 1947, dans une élection partielle, qu’une première femme, Mae O’Connor, s’est présentée devant l’électorat. Il s’est écoulé deux décennies entre l’obtention du droit de vote et l’élection de la première femme à l’Assemblée nationale du Québec. En 1961, Marie-Claire Kirkland devient la première députée à s’assoir sur les banquettes du parlement. Elle sera aussi la première femme ministre en 1962. Cinquante ans plus tard, en 2012, Pauline Marois devient la première première ministre élue de l’histoire du Québec.

Portrait de la première ministre Pauline Marois. 2014.
Parti Québécois
SUFFRAGE FÉMININ

La devise « Votes for Women » a été utilisée en 1909 lors du célèbre rassemblement pour le suffrage des femmes à Marble House à Newport, Rhode Island. Cette collection est inspirée du service à thé original qui a été créé pour Alva Vanderbilt, une suffragette de premier plan de l’époque, cette tasse et soucoupe est une reproduction du service utilisé lors de cette journée portes ouvertes.
Reproduction d’une tasse et d’une soucoupe ainsi que d’une théière décorative. Preservation Society of Newport County.
Collection Dave Turcotte

En 1919, le Nebraska était l'un des premiers états à ratifier le 19e amendement garantissant aux femmes le droit de vote aux États-Unis. Cependant, la lutte pour le suffrage durait au Nebraska depuis 60 ans à ce moment-là.
Affiche de l'exposition « Votes for Women : Nebraska's Suffrage Story ». Nebraska History Museum. 2019.
Collection Dave Turcotte

1922 : Henry Miles, député libéral de Montréal-Saint-Laurent
1925 : William Tremblay, député ouvrier de Maisonneuve
1927 : Victor Marchand, député libéral de Jacques-Cartier
1929 : William Tremblay, député ouvrier de Maisonneuve
1930 : Irénée Vautrin, député libéral de Montréal-Saint-Jacques
1931 : Irénée Vautrin, député libéral de Montréal-Saint-Jacques
1932 : Anatole Plante, député libéral de Montréal-Mercier
1933 : Anatole Plante, député libéral de Montréal-Mercier
1934 : Gaspard Fauteux, député libéral de Montréal-Sainte-Marie
1935 : Edgar Rochette, député libéral de Charlevoix-Saguenay
1936 : Frederick Arthur Monk, député de l'Action libérale nationale dans Jacques-Cartier
1938 : Joseph-Grégoire Bélanger, député unioniste de Montréal-Dorion
1939 : Pierre-Auguste Lafleur, député unioniste de Montréal-Verdun
Photographies des députés ayant déposé à tour de rôle les projets de loi rejetés sur le droit de vote des femmes. Journal La Presse. 21 avril 1990.
Collection Dave Turcotte


Journal L'Action Catholique. 19 avril 1940.
Collection Dave Turcotte

Sur la Ligne du temps du Québec, vous trouverez des documents d'époque témoignant de cet événement historique, fruit d'une lutte ardue !
Adoption du droit de vote des femmes au Québec. 2017.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Documentaire 9 février 1922.
Assemblée nationale du Québec
En avril 1940, Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain voient le Parlement du Québec accorder le droit de vote et d’éligibilité aux Québécoises. La série Figures de la démocratie revient sur les luttes et le parcours de ces trois femmes d’exception qui ont marqué l'histoire de la démocratie québécoise en réclamant davantage de droits politiques pour les femmes.
Figures de la démocratie : Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. 2010.
Assemblée nationale du Québec
Les « vraies » premières électrices
Le biographe Conrad Black raconte : « Deux élections partielles au provincial avaient été fixées au 6 octobre 1941 pour remplacer deux députés libéraux, James Ross de Huntingdon qui avait trouvé la mort dans un incendie et le Dr Alexis Bouthillier de Saint-Jean–Napierville, tué dans un accident d’automobile. Dans Huntingdon, les candidats étaient Dennis O’Connor, ancien député libéral au fédéral, et John Stewart de l’Union nationale. Dans Saint-Jean–Napierville, Omer Perrier, éditeur de l’influent journal local Le Canada français et cousin d’Hector Perrier, s’opposait à Paul Beaulieu, comptable et déjà candidat de l’Union nationale lors de trois élections générales précédentes. Dans le comté à majorité anglophone de Huntingdon, Jonathan Robinson s’efforça de garder la campagne au niveau provincial et local et d’éviter toutes questions se rapportant à la guerre.
La vraie bataille allait se livrer dans Saint-Jean, comté libéral depuis la Confédération. […] Le libéral O’Connor l’emporta sans difficulté dans Huntingdon le 6 octobre ; dans Saint-Jean–Napierville, Perrier semblait élu avec une majorité de moins de vingt voix. Mais Edouard Asselin, procureur de Beaulieu, demanda un dépouillement judiciaire. Le juge Alfred Duranleau présida cette opération, assisté des libéraux John Ahern et Elie Beauregard, et d’Edouard Masson pour l’Union nationale. Masson, qui était probablement le plus rusé des organisateurs de l’Union nationale, rejetait un bulletin libéral à la fois, réduisant graduellement la majorité de Perrier. Il fut établi que certains bulletins avaient été marqués à l’avance en faveur du libéral. Lorsque la majorité de Perrier n’était plus que de quatre voix, Ahern parti en hâte pour Montréal demander à la Cour d’appel la suspension du dépouillement. […] Le juge refusa d’émettre l’ordre sollicité par Ahern et Paul Beaulieu l’emporta dans Saint-Jean–Napierville par 6 612 voix contre 6 603. Cette victoire rassurait ceux qui avaient cru que l’Union nationale était un phénomène né de la crise économique et constituait un point tournant pour ce parti et le Québec ».
De mauvaises langues diront que c’est les femmes qui ont voté en grand nombre pour Beaulieu car il était le plus beau des deux candidats.

Carte de souhaits de Dave Turcotte, député de Saint-Jean, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. 2010.
Collection Dave Turcotte

Affiche Libre de faire entendre sa voix pour le 60e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des Québécoises. Directeur général des élection du Québec, Assemblée nationale du Québec, Conseil du statut de la femme et la Commission de la Capitale nationale. 2000.
Collection Dave Turcotte
Brochure Femmes et vie politique. De la conquête du droit de vote à nos jours publiée dans le cadre du 70e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des Québécoises. Assemblée nationale du Québec. 2010.
Collection Dave Turcotte
Affiche de l'exposition Aux urnes, citoyennes ! présentée dans le cadre du 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des Québécoises. Assemblée nationale du Québec. 2015.
Assemblée nationale du Québec
Publicité de l'exposition 9 février 1922, elles marchent vers le parlement ! présentée dans le cadre du 100e anniversaire de la première marche des femmes vers Québec pour demander le droit de vote. Assemblée nationale du Québec. 2022.
Assemblée nationale du Québec
Brochure de l'exposition Femmes et politique : une histoire d'engagement. Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. 2022.
Collection Dave Turcotte

Pièce de 1 $ produite dans le cadre du 100e anniversaire du droit de vote des femmes au Canada. Monnaie royale canadienne. 2016.
Collection Dave Turcotte
Bulletin de l'Amicale soulignant le 75e anniversaire du droit de vote des femmes. Amicale des anciens parlementaires du Québec. Volume 16, Numéro 1, Juin 2015.
Collection Dave Turcotte
Le Temps de parole traitant des femmes parlementaires au Québec. Amicale des anciens parlementaires du Québec. Volume 20, Numéro 1, Janvier 2019.
Collection Dave Turcotte
Les droits des femmes et la politique
Au fil du temps, les droits des femmes sont devenus des sujets de discussion politiques. Les droits des femmes sont essentiels pour une société égalitaire. Lors des élections québécoises, il est important que les enjeux tels que l'égalité salariale, la conciliation travail-famille et la représentation politique des femmes soient au cœur des débats.


Au cœur des années 1930, un mouvement gagne le parlement et d’autres lieux de pouvoir au Québec. Ce mouvement mis de l’avant par la jeunesse libérale demande de remplacer, par des hommes, toutes les jeunes filles qui occupent des emplois sans avoir besoin de gagner leur vie. Le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau et des ses ministres ont d’ailleurs appuyé cette revendication.
Article du journal L'Action catholique. Page 12. 17 janvier 1936.
Collection Alain Lavigne
Lettre d'Hector Laferté. 1936.
Collection Assemblée nationale du Québec
Publicité de la Jeunesse libérale de Saint-Roch. 1936.
Collection Alain Lavigne


Le Parti libéral rappelle qu'il a octroyé le droit de vote aux Québécoises pour démontrer sa crédibilité auprès d'elles.
Brochure de contre-propagande « Duplessis donne SA province ». Parti libéral du Québec. Élection 1956.
Collection Dave Turcotte

Journal La Réforme. Parti libéral du Québec. Élection 1966.
Collection Dave Turcotte



Carton promotionnel pour les femmes. Comité national du OUI. Référendum 1995.
Collection Dave Turcotte
Les pionnières
À cette époque, en plus de ne pas pouvoir voter, les femmes ne peuvent pas signer de chèque. L’éducation supérieure est pratiquement réservée aux hommes. Les femmes doivent se marier vierges et obéir à leur mari. La sexualité n’est permise que dans le cadre du mariage et uniquement à des fins de procréation. La contraception et le divorce sont interdits. L’avortement est criminalisé.
L’obtention du droit de vote des femmes est principalement l’œuvre des suffragettes, un mouvement international de femmes qui a vu le jour au Royaume-Uni et qui s’est véritablement amorcé au début du 20e siècle au Québec. Thérèse Casgrain, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean ont notamment été des pionnières de cette lutte pour le suffrage féminin. À cette courte liste, on peut ajouter Caroline Dessaulles-Béïque, Carrie Derick et Anna Marks Lyman. Par des manifestations, des campagnes d’information et du lobbying auprès des parlementaires, elles font leur chemin auprès de l’opinion publique, du clergé et des politiciens.

Thérèse Casgrain
Thérèse Casgrain est née à Montréal le 10 juillet 1896. Elle est la fille de lady Blanche MacDonald, d’origine écossaise, et de sir Rodolphe Forget, avocat, financier, homme politique conservateur et philanthrope canadien-français. Celui-ci est considéré comme l’un des hommes les plus riches de Montréal au tournant du XXe siècle. Après ses études chez les sœurs, elle souhaite poursuivre ses études à l’université, mais son père s’y oppose, n’en voyant pas l’utilité. Selon lui, elle doit plutôt apprendre à gérer une maison, une qualité que doit posséder une future épouse de son rang. En janvier 1916, à 19 ans, elle épouse l’avocat Pierre-François Casgrain, un partisan libéral, avec qui elle a quatre enfants.
Après 13 ans à siéger au parlement à titre de député conservateur indépendant dans la circonscription fédérale de Charlevoix--Montmorency, son père se retire de la vie politique. Son époux décide de lui succéder, mais sous la bannière libérale. Il sera élu à l’élection de décembre 1917. Thérèse Casgrain accompagne son mari à Ottawa pour l’ouverture de la session parlementaire, au printemps 1918. C’est dans la capitale fédérale qu’elle prend conscience de l’importance de la question du droit de vote pour les femmes. Lors de l’élection fédérale de 1917, on permet à un certain nombre de femmes de voter. Le gouvernement Borden va par la suite faire adopter le Women’s Suffrage Act, un projet de loi accordant le droit de vote aux élections fédérales à toutes les Canadiennes de vingt et un ans et plus. Dès le début de sa deuxième campagne en 1921, Pierre Casgrain tombe gravement malade. Thérèse Casgrain décide de le remplacer malgré que les femmes ne prennent pratiquement jamais la parole en public à cette époque. Il s’agit de la première élection fédérale à laquelle les femmes peuvent voter et se porter candidates. Pierre Casgrain est réélu.
Thérèse Casgrain joue un rôle de premier plan dans le mouvement pour le vote des femmes au Québec. Dès 1921, elle est membre fondatrice, avec Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Idola Saint-Jean, du Comité provincial pour le suffrage féminin (CPSF) et en devient la vice-présidente. En 1922, elle fait partie d’une délégation de plus de 400 personnes du CPSF qui rencontre le premier ministre du Québec, le libéral Louis-Alexandre Taschereau pour réclamer le droit de vote des femmes. Le gouvernement ne leur donne aucun espoir. Le premier ministre Taschereau aurait déclaré en privé : « Si jamais les femmes du Québec obtiennent le droit de vote, ce n’est pas moi qui le leur aurai donné ». Ce n’est donc que le premier d’une longue série de périples au parlement de Québec. En 1927, le CPSF se divise en deux organisations distinctes : L’Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, menée par Idola Saint-Jean ainsi que la Ligue des droits de la femme, dirigée par Thérèse Casgrain. Elle occupe cette fonction jusqu’en 1941.
Thérèse Casgrain lutte pour l’obtention de l’égalité tant juridique que sociale des femmes en usant de ses relations dans les cercles politiques et de son influence dans les médias. Elle tient salon chez elle, où se rencontrent les esprits réformistes du temps, ce qui suscite même le mécontentement du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Elle reçoit à ces débats d’idées des intellectuels et des activistes comme Frank Scott, Jacques Perrault, Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, Gérard Pelletier, Jean Marchand, Fernand Daoust et Jacques Parizeau.
Membre du club des femmes libérales, Thérèse Casgrain convainc son chef Adélard Godbout, en 1938, d’inviter 40 femmes au congrès du Parti libéral du Québec visant à préparer le programme électoral de la prochaine élection. Alors vice-présidente du Club des femmes libérales du Canada, elle parvient avec cette délégation féminine, à faire inscrire le suffrage féminin au programme du parti. Puis, en 1940, elle encourage son chef, devenu premier ministre du Québec, à tenir tête au cardinal Villeneuve, qui s’oppose toujours à l’adoption de cette mesure. Adélard Godbout tient parole et fait adopter un projet de loi octroyant le droit de vote aux femmes.
En 1942, lors d’une élection fédérale partielle, elle se présente en tant que candidate libérale indépendante dans la circonscription de Charlevoix-Saguenay, qui était celle de son mari, devenu depuis juge à la Cour supérieure du Québec. Le biographe Conrad Black résume cette élection : « Deux élections complémentaires allaient avoir lieu le 30 novembre 1942 dans Outremont et dans Charlevoix. Dans Charlevoix, il s’agissait de remplacer le président de la Chambre, Pierre Casgrain, qui avait été nommé à la magistrature. […] Cinq personnes avaient posé leur candidature dans Charlevoix, mais la principale était Thérèse Casgrain, femme de l’ancien député et fille du député précédent qui avait aussi été député de la Chambre des communes, Sir Rodolphe Forget. Mme Casgrain était déjà bien connue pour son leadership dans la campagne du suffrage féminin au Québec. On lui refusa l’investiture libérale parce qu’elle s’était prononcée contre la conscription. Il n’y avait pas de candidat libéral dans cette élection. Le principal adversaire de Mme Casgrain était Frédéric Dorion, frère de Noël et de Charles, et il était appuyé par ce qui restait du Parti conservateur, par l’organisation locale de l’Union nationale sous la direction du Dr Arthur Leclerc (ancien député unioniste de cette région) et par les divers groupes nationalistes. Les deux candidats menèrent une campagne pittoresque et énergique. Le 30 novembre, […] Dorion triompha de Mme Casgrain par neuf mille sept cents voix contre six mille six cents ». Thérèse Casgrain écrit « que les chefs du Parti libéral, tant fédéral que provincial, ne voulaient pas de moi comme député […]. Non seulement j’étais une femme, mais ils savaient aussi que si j’étais élue, jamais ils ne pourraient me faire accepter des idées contre lesquelles je m’étais déjà prononcée avec raison ».
En 1946, elle rompt avec les libéraux et adhère au parti Co-operative Commonwealth Federation (CCF), connu en français sous le nom de Parti social démocratique du Canada (PSD) l’ancêtre du Nouveau parti démocratique. Elle devient vice-présidente du PSD en 1948, et la seule femme à siéger au comité exécutif du parti. Elle dirige la branche québécoise du PSD de 1951 à 1957. Elle devient ainsi la première femme au Canada à être cheffe d’un parti politique.
Lise Payette milite aux côtés de Thérèse Casgrain en 1957 dans la circonscription de Villeneuve en Abitibi-Témiscamingue. « J’étais, à l’époque, l’accompagnatrice de Mme Casgrain durant sa tournée électorale. Ses adversaires étaient polis parce qu’elle inspirait le respect, mais ils n’en étaient pas moins impitoyables. Quant à ses supporters, même parmi les plus près de son organisation, plusieurs ont voté pour quelqu’un d’autre le jour de l’élection, estimant à la dernière minute qu’il valait mieux voter pour n’importe quel homme plutôt que pour une femme. Je la revois encore, debout à l’arrière d’un camion, haranguant les ouvriers à la sortie de la mine, dans son tailleur élégant, avec son éternel chapeau et ses gants, emblèmes de la femme du monde qu’elle avait toujours été. Objet de curiosité, elle créait des attroupements, mais ne réussissait pas à se faire prendre au sérieux ».
Malgré ces neuf tentatives, elle n’aura jamais la chance de porter la voix des femmes au parlement.
30 novembre 1942
Candidate à l’élection fédérale partielle dans Charlevoix--Saguenay
Indépendante libéral
16 juillet 1952
Candidate à l’élection générale québécoise dans Montréal--Verdun
Cooperative Commonwealth Federation (CCF)
6 octobre 1952
Candidate à l’élection fédérale partielle dans Outremont—St-Jean
Parti social démocratique du Canada (PSD)
10 août 1953
Candidate à l’élection générale fédérale dans Jacques-Cartier—Lasalle
Parti social démocratique du Canada (PSD)
20 juin 1956
Candidate à l’élection générale québécoise dans Jacques-Cartier
Parti social démocrate (PSD)
10 juin 1957
Candidate à l’élection générale fédérale dans Villeneuve
Parti social démocratique du Canada (PSD)
31 mars 1958
Candidate à l’élection générale fédérale dans Jacques-Cartier—Lasalle
Parti social démocratique du Canada (PSD)
18 juin 1962
Candidate à l’élection générale fédérale dans Outremont—St-Jean
Nouveau Parti démocratique (NPD)
8 avril 1963
Candidate à l’élection générale fédérale dans Outremont—St-Jean
Nouveau Parti démocratique (NPD)
Le 7 octobre 1970, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau la nomme au Sénat, où elle devient sénatrice indépendante. Elle n’y siège que neuf mois avant d’atteindre 75 ans, l’âge limite pour occuper la fonction. Elle meurt le 3 novembre 1981 à l’âge de 85 ans. Elle est désignée « personnage historique » par la ministre de la Culture et des Communications le 8 mars 2019.
Selon L’Encyclopédie canadienne, « Thérèse Casgrain est une grande humaniste qui a lutté non seulement pour la reconnaissance du droit de vote pour les femmes, mais aussi pour les droits universels. Son engagement politique et social a favorisé de nombreuses réformes en matière d’emploi, de soins de santé, d’éducation et de logement ».

Marie Lacoste-Gérin-Lajoie
Marie Lacoste-Gérin-Lajoie est née à Montréal le 19 octobre 1867. Elle est la fille de Marie-Louise Globensky, une figure importante des milieux philanthropiques montréalais et de sir Alexandre Lacoste, avocat, professeur de droit à l’Université Laval à Montréal, sénateur, président du Sénat, puis juge en chef du Québec. L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon précise que Marie Lacoste « naît donc dans un foyer nourri de traditions diverses et contradictoires où elle s’affirmera très tôt par ses choix personnels. Côté Lacoste, elle compte en effet un grand-père patriote, ex-détenu du Pied-du-Courant et ardent disciple de Papineau. Côté Globensky, elle hérite au contraire d’un passé de collaboration avec l’occupant anglais ». Elle est la sœur de Justine Lacoste-Beaubien, co-fondatrice, avec Irma Levasseur, de l’hôpital pour enfants Sainte-Justine, ainsi que de Thaïs Lacoste-Frémont, militante féministe, fondatrice de l’Association des femmes conservatrices de Québec et s’illustre, en 1932, à Genève, « comme première déléguée féminine du gouvernement Bennett à la Société des Nations ». En 1887, Marie Lacoste épouse l’avocat montréalais Henri Gérin-Lajoie, fils du poète Antoine Gérin-Lajoie, petit-fils du journaliste Étienne Parent et frère du sociologue Léon Gérin.
Après ses études secondaires terminées en 1883, elle souhaite poursuivre à l’université, mais elle se bute au refus des facultés universitaires francophones d’admettre des femmes. Elle poursuit donc sa formation de juriste en autodidacte en se plongeant dans les livres de son père, puis ceux de son époux. L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon ajoute que son père « Alexandre Lacoste, fidèle à sa promesse, encourage sa fille qui, à n’en pas douter, possède un authentique tempérament d’intellectuelle. Tout l’intéresse : philosophie, religion, histoire, littérature. Mais aussi, chose rare chez une fille, sciences physiques et naturelles. Elle dévore des traités de chimie, de physique et d’astronomie. […] la jeune Lacoste, fouinant dans la bibliothèque paternelle où foisonne la littérature juridique, va bientôt s’intéresser à l’étude du droit et en faire progressivement le grand intérêt de sa vie. Tout son féminisme va d’ailleurs s’alimenter à cette culture ». Ses lectures lui font prendre conscience de la situation juridique de la femme mariée au Québec, le Code civil alors en vigueur en fait une perpétuelle mineure aux yeux de la loi. Afin d’informer les femmes sur leur condition légale, elle publie en 1902 un Traité de droit usuel, manuel de droit civil et constitutionnel s’adressant en particulier aux femmes. Réédité en 1910 et 1922, puis traduit en anglais, il est utilisé dans les institutions d’enseignement et inscrit en 1914 sur la liste des ouvrages recommandés pour les bibliothèques scolaires. Avec le succès de son livre, elle devient chargée de cours dans ce domaine qu’elle maitrise de mieux en mieux. L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon confirme que « c’est donc à une mère de famille autodidacte que reviendra le mérite d’avoir été la première femme à se voir confier une charge d’enseignement à la faculté de Droit de l’Université Laval à Montréal ». En plus du Traité de droit usuel (1902), elle publie L’état légal des femmes dans la province de Québec (1900), La communauté légale (1927) et La femme et le Code civil (1929).
Elle est une des rares femmes francophones, avec sa mère, à participer à la Montreal Local Council of Women (MLCW) dès 1893. Le MLCW, affilié au Conseil national des femmes du Canada, et, à travers lui, au Conseil international des femmes, est une organisation rassemblant majoritairement des femmes anglophones et destinée à « coordonner les efforts et les actions des multiples associations féminines œuvrant alors dans le domaine social, avec pour objectif d’améliorer la société en général, en particulier la condition des femmes et des enfants ». Cette association est l’un des premiers regroupements féministes au Québec. À une époque où la religion catholique domine, où une femme qui parle en public commet un geste osé, l’adhésion d’une francophone catholique au MLCW, organisme anglophone et non confessionnel, ne va pas de soi. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie y rencontre notamment la journaliste Joséphine Marchand-Dandurand. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie siège au sein de son conseil d’administration de 1900 à 1906.
L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon met en contexte un des premiers écrits de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie sur la question du droit de vote des femmes. « Pour la juriste que se révèle déjà Marie Lacoste, mener à bien pareilles réformes suppose que la femme mariée détienne deux pouvoirs essentiels qui lui font encore défaut : la pleine capacité juridique et le droit de vote. Voici en quels termes elle évoque pour la première fois, en 1902, les liens qu’elle établit déjà entre action sociale, politisation et féminisme. Il s’agit d’un article qu’elle publie sous l’anonymat […] et qui sera reproduit à Montréal par plusieurs journaux aussi bien anglophones que francophones. À cette époque, les femmes ne votent ni au niveau fédéral, ni au niveau provincial, mais les femmes célibataires et les veuves peuvent exercer ce droit au niveau municipal depuis 1892 : “Mesdames, comprenez-vous l’importance qu’il y a pour vous de vous présenter pour voter aux élections municipales... (Si vous ne votez pas) vous vous plaindrez ensuite de voir au coin de chez vous une buvette qui perd votre fils, vous mourrez de chagrin à la vue de votre fille dont la vertu tombera miette à miette au milieu de représentations malsaines, vous déplorerez la mort d’un enfant empoisonné par la contamination des ordures de la rue et vous n’essayez (sic) pas de remédier tout ce mal ! " ».
Partageant le malaise de d’autres femmes francophones à militer au sein d’un mouvement laïc et majoritairement anglophone, elle se dissocie du MLCW pour fonder en 1907, avec Caroline Dessaulles-Béïque, et les femmes de la section des Dames patronnesses de l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), destinée selon l’intention de ses fondatrices, à « grouper les Canadiennes françaises catholiques en vue de fortifier par l’union leur action dans la famille et dans la société ». La FNSJB, jusqu’au milieu des années 1920, va notamment jouer un rôle important dans les débuts du mouvement féministe québécois et la lutte pour l’obtention du suffrage féminin au Québec. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie marque profondément la FNSJB de son empreinte personnelle, y occupant les fonctions de secrétaire (1907-1913), puis de présidente (1913-1933).
Après l’obtention du droit de vote des femmes en 1918 au fédéral et la démobilisation du mouvement suffragiste qui suivit, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie co-fonde en 1922, avec Anna Marks Lyman (présidente du MLCW), le Comité provincial pour le suffrage féminin (CPSF) qui rassemble des militantes anglophones et francophones dans le but est de relancer la lutte au Québec. Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain et Carrie Derick comptent parmi les 32 femmes présentes à l’assemblée de fondation. Le 9 février 1922, elle conduit à Québec une délégation de 400 femmes pour tenter de convaincre, en vain, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. La délégation doit faire face à un très fort mouvement d’opposition provenant à la fois du clergé catholique, des journalistes, des politiciens et de femmes. Le projet de loi déposé à l’Assemblée législative par Henry Miles (Montréal–Saint-Laurent), député libéral sympathique à la cause, est défait.
En mai 1922, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie se rend à Rome pour assister au congrès de l’Union internationale des ligues féminines catholiques afin de recevoir l’assentiment du pape concernant le suffrage des femmes au Québec. Elle espère ainsi contourner la forte opposition de la hiérarchie catholique québécoise en la matière. L’Union se prononce en faveur du mouvement suffragiste, mais déclare, à l’instigation du représentant du pape, que les démarches doivent se faire avec l’accord de l’épiscopat local. Le Dictionnaire biographique du Canada explique que Marie Lacoste-Gérin-Lajoie est certaine qu’Henri Bourassa est à l’origine de cette nuance importante. « Le journaliste et polémiste, farouchement opposé au suffrage des femmes, a ses entrées au Vatican, notamment par l’entremise du cardinal Rafael Merry del Val, délégué du pape au congrès et président des séances. Marie Gérin-Lajoie croit que c’est Bourassa qui, par un jeu d’influences, fait ajouter, dans les résolutions adoptées au congrès, une clause obligeant les femmes à recevoir, préalablement à l’obtention du droit de vote, l’approbation de leur épiscopat. Au Québec, c’est alors impossible ».
À la suite de fortes pressions du clergé qui souhaite dissocier la FNSJB de toute implication du mouvement suffragiste, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie démissionne de la présidence de la section francophone du CPSF en novembre 1922, tout en demeurant membre du conseil d’administration jusqu’en 1928.
Après la mort accidentelle de son époux, le 7 mai 1936, elle se retire auprès de sa fille et homonyme Marie Gérin-Lajoie, à l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil fondé par cette dernière, où elle meurt en 1945. Elle est désignée « personnage historique » par la ministre de la Culture et des Communications le 8 mars 2019.
L’un de ses petits-fils, Paul Gérin-Lajoie, ministre libéral de l’Éducation du Québec de 1964 à 1966, joue un rôle clé dans la réforme du système éducatif québécois au cours de la Révolution tranquille.

Idola Saint-Jean
Idola Saint-Jean est née le 19 mai 1879 à Montréal. Elle est la fille de Emma Guyon dite Lemoine et de Edmond Saint-Jean, un avocat criminaliste. Elle est issue d’un milieu bourgeois, les membres de sa famille, dont plusieurs sont avocats, possèdent plusieurs propriétés et s’impliquent dans le monde politique. Son oncle Alphonse Levis, notaire et libéral modéré, est défait par Honoré Beaugrand lors d’une course à la mairie de Montréal en 1886.
Elle fait ses études au couvent Villa-Maria, chez les religieuses de la Congréation de Notre-Dame. Elle suit également des cours de diction, de mise en scène et de théâtre à l’école de Julia Bennati. Dès 1900, elle se fait remarquer sur les scènes des villes de Montréal et Québec pour ses talents de comédienne et d’oratrice, notamment lors de récitals de poésie. En guise de gagne-pain, elle enseigne la diction et l’élocution.
En 1903, Idola Saint-Jean part à Paris pour y suivre des cours de théâtre et s’inscrit du même coup à la Sorbonne. De retour à Montréal, elle est embauchée comme professeure de français à l’Université McGill ; un poste qu’elle occupe jusqu’à son décès. Elle fréquente le poète Émile Nelligan et le franc-maçon Arsène Bessette. C’est à l’université qu’elle rencontre Carrie Derick, la première femme à occuper un poste de professeure titulaire au sein d’une université canadienne. Derick est également la présidente de la Montreal Suffrage Association (1913 à 1919), une association fondée en 1913 pour promouvoir le suffrage féminin aux élections fédérales.
Idola Saint-Jean mène de front sa carrière dans l’enseignement et son engagement social, notamment auprès de la jeunesse. Elle publie des ouvrages sur la diction et donne un cours ouvert au public au Monument-National et s’implique dans diverses sociétés d’entraide. En 1918, elle adopte seule (elle sera célibataire toute sa vie) une petite fille noire devenue orpheline à la suite du décès de ses parents, victimes de la grippe espagnole — Idola Saint-Jean s’implique au sein d’un bureau de secours ouvert jour et nuit pendant cette épidémie. L’enfant meurt deux ans plus tard.
En 1922, elle est membre fondatrice du Comité provincial pour le suffrage féminin (CPSF) avec Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Anna Marks Lyman. Tout comme Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Thérèse Casgrain, elle est des 400 participantes, en compagnie des Carrie Derick, Julia Drummond et Grace Ritchie-England, à la grande délégation féminine qui rencontre, à Québec, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Elles rencontrent alors le premier ministre du Québec afin de convaincre les députés québécois d’approuver un projet de loi visant à accorder le droit de vote aux femmes du Québec.
Durant l’élection fédérale de 1925, elle se rapproche du Parti libéral du Canada, qui sollicite ses talents d’oratrice. Elle s’exprime au grand ralliement de campagne des Libéraux au Québec au Forum de Montréal. Ce rassemblement, que le journal Le Canada considère à l’époque comme le plus grand ralliement libéral de l’histoire de Montréal, établit la renommée politique d’Idola Saint-Jean. Devant l’inaction du CPSF auprès des classes populaires, Idola Saint-Jean s’en dissocie et crée, en 1927, l’Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Elle crée notamment pour cet organisme une bibliothèque ambulante et met sur pied un bureau offrant des consultations gratuites aux femmes sur des questions légales et économiques. De son côté, Thérèse Casgrain transforme le CPSF en Ligue des droits de la femme. L’Alliance s’adresse principalement aux ouvrières et aux femmes des quartiers populaires, alors que la Ligue regroupe essentiellement des bourgeoises et des femmes mariées. Les deux organisations travaillent conjointement pour un objectif commun, mais emploient des méthodes différentes.
Malgré que les femmes ont le droit de vote depuis 1918 au fédéral, elle est, en 1930, la première candidate québécoise à une élection fédérale. Elle se présente dans la circonscription de Montréal–Saint-Denis et 1 732 personnes (3,87 %) votent pour elle. Elle arrive en troisième place. L’animateur Gilles Proulx en dit ceci : « Idola Saint-lean a essuyé nombre d’insultes et de quolibets. Malgré tout, elle a poussé l’audace jusqu’à se présenter aux élections fédérales, en 1930. Voilà une femme qui se battait contre vents et marées ! Inutile de dire qu’elle fut aisément battue lors de ce scrutin ; de toute façon, elle était totalement consciente de la situation. Mais au lieu de la décourager, cette défaite l’a incitée à poursuivre son œuvre de sensibilisation auprès du public ».
Elle s’exprime sur diverses tribunes, comme des journaux, émissions radiophoniques, marches et rassemblements. Elle répète inlassablement son message d’égalité et de justice sociale, et ce, malgré les obstacles : le clergé, les journalistes, les parlementaires et de très nombreuses femmes. L’animateur Gilles Proulx affirme que « Pour Idola Saint-Jean, c’était le suffrage féminin, la cause de sa vie. Elle en a parlé sur toutes les tribunes. Tandis que [Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Thérèse Casgrain] s’adressaient surtout à la haute société de tendance libérale, notre d’Artagnan se concentrait, elle, sur le peuple. Pour convaincre des “bleus” et des ecclésiastiques d’adopter sa cause, elle utilisait des arguments très nationalistes, notamment en rappelant le courage des pionnières de la Nouvelle-France. Peut-on dire qu’elle a joué le rôle principal dans l’obtention du droit de vote des femmes au Québec ? Quand même pas ! En tout cas, elle a été le porte-voix inlassable de cette cause pendant quasiment toute sa vie. Plus souvent qu’à son tour, elle parlait dans le vide. Les oreilles du temps ne prêtaient pas une grande attention à cette “idée nouvelle”, même si les femmes pouvaient voter et se présenter aux élections fédérales depuis 1918. C’était avant tout un phénomène d’époque : la province se trouvait “déphasée” par rapport à l’Angleterre et aux États-Unis. S’il y avait des réticences, c’est peut-être parce que le droit de vote des femmes était vu comme une cause anglo-saxonne. ». En 1935, elle envoie une pétition de 10 000 noms au Roi George V.
À partir de 1935, Idola Saint-Jean s’engage dans le mouvement pacifiste et milite également pour les droits civils. Elle s’oppose notamment à la « loi du cadenas » du premier ministre Maurice Duplessis, un texte législatif discriminatoire visant à « protéger la province contre la propagande communiste ».
Idola Saint-Jean est de tous les rassemblements et actions d’éclat ayant pour objectif le suffrage féminin. Une fois l’an, les femmes se rendent à Québec afin de présenter et d’appuyer différents projets de loi sur le suffrage. En 1939, Idola Saint-Jean déclare à l’Assemblée législative du Québec : « Donnez un vote libérateur, ouvrez la porte de l’arène politique aux femmes de chez vous qui sauront rester dans la vie provinciale aussi dignes qu’elles le sont dans la vie fédérale à laquelle elles participent depuis plus de vingt ans. » Elle déclare aussi « Dans un pays où le système démocratique est en vigueur, le vote est le droit que possède tout citoyen de s’exprimer dans les questions d’intérêt public. […] Peut-on parler de suffrage universel quand toute une moitié de la société est privée de son droit de vote ? »
En 1944, les Québécoises peuvent, pour la première fois, participer aux élections québécoises. Idola Saint-Jean exerce son droit de vote peu de temps avant son décès. Ce qui fait dire à l’animateur Gilles Proulx : « Si Marie Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Marie Claire Kirkland-Casgrain sont nos trois mousquetaires du droit de vote des femmes au Québec, Idola Saint-Jean est notre d’Artagnan ! […] parce que c’est l’aînée, et que c’est elle qui a reçu le moins d’honneurs de son vivant. Si elle ne s’était pas éteinte en 1945, avant le début de la Révolution tranquille, elle aurait certainement été fêtée comme l’une de ses grandes championnes. […] Imaginez la joie qu’a éprouvée cette femme lorsqu’à l’aube de la soixantaine, elle a vu le Québec adopter enfin la réforme qu’elle préconisait depuis tant d’années. […] Si elle est morte trop tôt, les cyniques diront qu’au moins, cela lui a épargné le long règne duplessiste ». Elle meurt le 6 avril 1945, à l’âge de 65 ans. Lors de ses funérailles, neuf femmes, ses compagnes de combat, portent son cercueil.
Elle est désignée « personnage historique » par la ministre de la Culture et des Communications le 8 mars 2019.
LES PIONNIÈRES

Première page du cahier spécial pour souligner le 50e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes. Journal La Presse. 21 avril 1990.
Collection Dave Turcotte
Bulletin de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec portant sur le 70e anniversaire du droit de vote des femmes et mettant en vedette les pionnières Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean et Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Volume 39, numéro 1, printemps 2010.
Collection Dave Turcotte



Timbres en l'honneur de Emily Murphy (17 avril 1985), Thérèse Casgrain (17 avril 1985) et Idola Saint-Jean (4 mars 1981). Société canadienne des postes.
Collection Dave Turcotte



Photographies du monument Hommage aux femmes en politique qui met en lumière la contribution de Idola Saint-Jean, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Marie-Claire Kirkland. Ce monument fut inauguré le 5 décembre 2012 par Pauline Marois, la première première ministre du Québec.
Collection Dave Turcotte
Dépliant sur le monument Hommage aux femmes en politique. Assemblée nationale du Québec. 2016.
Collection Dave Turcotte

Carte de souhaits du député Dave Turcotte pour la journée internationale des femmes illustrant le monument Hommage aux femmes en politique. 2013.
Collection Dave Turcotte

La Marche pour la parité, organisée par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie et les Partenaires pour la parité, s’inscrit dans l’esprit des suffragettes qui, pendant 14 ans, ont réclamé le droit de vote, il y a maintenant un siècle.
Photographie d'ex-parlementaires lors de la 7e édition de la Marche pour la parité. 28 avril 2022.
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Photographe : Llamaryon
THÉRÈSE CASGRAIN
Militante pour les droits des femmes : Thérèse Casgrain.
Historica Canada

Macaron du souper Pionniers. Club Lions Baie Saint-Paul. 1979.
Collection Simon Turmel

Publicité de l’Association canadienne des électrices invitant les Québécoises à user de leur droit de vote pour améliorer leur condition sociale lors de l’élection québécoise du 28 juillet 1948. Dans la publicité, on peut voir une lettre signée par Thérèse Casgrain, présidente de cette association, questionnant les candidats sur leurs plates-formes pour les femmes. Journal La Presse. 17 juillet 1948.
Collection Dave Turcotte
IDOLA SAINT-JEAN

Idola Saint-Jean est la première Québécoise à se porter candidate à une élection fédérale.
Reproduction de l'affiche électorale de Idola Saint-Jean, candidate libérale indépendante dans Montréal–Saint-Denis. Élection fédérale du 28 juillet 1930.
Collection Dave Turcotte

Biographie Idola Saint-Jean, l'insoumise écrite par Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean. Les Éditions du Boréal. 2017.
Collection Dave Turcotte
MARIE LACOSTE-GÉRIN-LAJOIE

Biographie Marie Gérin-Lajoie : De mère en fille, la cause des femmes écrite par Hélène Pelletier-Baillargeon. Les Éditions du Boréal. 1985.
Collection Dave Turcotte
JOSÉPHINE MARCHAND

Joséphine Marchand-Dandurand, une des pionnières du mouvement féministe québécois est la fondatrice de la revue Le coin du feu, première revue féminine parue au Québec. Publiée de 1893 à 1896, elle revendique l’émancipation des femmes et l’amélioration de leur statut dans la société. Dans son exposition virtuelle 9 février 1922, elles marchent vers le parlement!, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec présente la parution de décembre 1893. Dans ce numéro, on questionne des personnalités connues sur leur conception du vote féminin. La grande majorité s’y oppose, notamment Louis Fréchette, Arthur Buies et Honoré Beaugrand.
Carte postale en l'honneur de Joséphine Marchand-Dandurand. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Collection Dave Turcotte
Les premières
Mae O’Connor
Première femme à être candidate (1947)
Mae O’Connor, née Mary Loretta Leehy, est la première femme candidate à une élection au Québec. Elle se présente sous la bannière libérale dans la circonscription de Huntingdon lors de l’élection partielle du 23 juillet 1947. Elle tente de succéder à son mari, Dennis James O’Connor, mort en fonction en 1946.
Fait inusité, Dennis James O’Connor est élu député libéral à l’élection partielle du 6 octobre 1941. Cette élection est historique puisque c’est lors de cette élection partielle (ainsi que celle dans la circonscription voisine de Saint-Jean–Napierville) que les femmes votent pour la première fois à Québec. C’est donc dans la même circonscription que 5 ans plus tard, sa femme, la première au Québec, souhaite prendre sa relève.
Mae O’Connor obtient 2675 voix contre 3402 pour son adversaire, John Gillies Rennie de l’Union nationale.

Article du journaliste Pierre Laporte qui sera quelques années plus tard député et ministre dans les cabinets des premiers ministres Jean Lesage et Robert Bourassa.
Article du journal Le Devoir. Mercredi 23 juillet 1947.
Journal Le Devoir
Article du journal The Gazette. Mercredi 23 juillet 1947.
Journal The Gazette


Bien que Mae O’Connor soit la première candidate au Québec, il n’y a que le « Mrs. » de féminin sur le bulletin de vote. Elle doit s’y faire appeler « Madame Dennis James O’Connor ».
Bulletin de vote de la circonscription d'Huntingdon. Élection partielle du 23 juillet 1947
Élections Québec


Photographie de l'entrée et de la plaque d'identification du salon Mae-O'Connor au restaurant Le Parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec.
Collection Dave Turcotte
Marie-Claire Kirkland
Première femme élue députée (1961)
Première femme à occuper la fonction de ministre (1962)
Marie-Claire Kirkland, Américaine de naissance, passe son enfance à Ville Saint-Pierre (aujourd’hui fusionnée à Lachine). Elle s’initie tôt à la politique en suivant son père, le docteur Charles-Aimé Kirkland, député de Jacques-Cartier. Elle devient notamment conseillère de la Jeunesse libérale dans sa circonscription, présidente du comité de la constitution de la Fédération des femmes libérales du Québec et membre fondatrice de l’Association des femmes avocates de la province de Québec.
14 décembre 1961
Suite au décès de son père, une élection partielle est appelée dans la circonscription de Jacques-Cartier. Elle y brigue les suffrages sous la bannière libérale. Elle remporte cette élection avec une majorité de 23 875 voix face à son opposant Paul-Émile Lejour. Marie-Claire Kirkland devient la première femme de l’histoire du Québec à être élue députée à l’Assemblée nationale du Québec.
14 novembre 1962
Elle est réélue députée libérale de Jacques-Cartier avec une majorité de 49 388, la plus grande de l’histoire du Québec. Elle est encore la seule femme à siéger au Parlement.
5 décembre 1962
Elle est assermentée ministre sans portefeuille dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Elle devient ainsi la première femme ministre de l’histoire du Québec.
Bien qu’elle soit habilitée à siéger au Parlement, Marie-Claire Kirkland, ne peut signer de bail afin de séjourner à Québec pendant la session parlementaire en vertu du Code civil. Ceci est le lot des Québécoises de l’époque. En 1964, elle réussit à faire adopter à l’unanimité la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, qui corrige cette situation. Les Québécoises peuvent désormais exercer une profession, gérer leurs propres biens, intenter des actions en justice et conclure des contrats.
En entrevue à Lysiane Gagnon 13 ans plus tard, Marie-Claire Kirkland se souvient : « Quand j’ai été élue, ma priorité, c’était la reconnaissance de la capacité juridique de la femme mariée […] Il m’a fallu trois ans pour convaincre mes collègues de la nécessité de ce projet. Au Conseil des ministres, il fallait que je me surveille de près. Car là, une femme qui parlerait à la légère serait cent fois plus mal jugée qu’un homme, on dirait qu’elle est “trop émotive”. Il faut être ultra diplomate et cacher ses sentiments. »
25 novembre 1964
Elle est assermentée ministre des Transports et des Communications dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Elle occupe cette fonction jusqu’au 16 juin 1966.
5 juin 1966
Elle est réélue députée libérale dans Marguerite-Bourgeoys. Elle est encore la seule femme à siéger au Parlement.
En 1969, alors qu’elle est dans l’opposition officielle, elle fait adopter la Loi concernant les régimes matrimoniaux et l’établissement de la société d’acquêts qui privilégie le partage de la valeur des biens accumulés pendant le mariage tout en permettant à chacun des époux d’exclure certains biens qui leur sont propres.
29 avril 1970
Elle est réélue députée libérale de Marguerite-Bourgeoys. Elle est encore la seule femme à siéger au Parlement.
12 mai 1970
Elle est assermentée ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle va occuper cette fonction jusqu’au 15 février 1972.
Elle élabore un livre blanc sur l’accessibilité des territoires de chasse et de pêche, qui se traduit par la création des réserves fauniques du Québec.
2 au 6 août 1972
Elle est désignée première ministre intérimaire afin de remplacer le premier ministre Robert Bourassa qui doit s’absenter du Québec.
2 février 1972
Elle est assermentée ministre des Affaires culturelles dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle va occuper cette fonction jusqu’au 14 février 1973.
Elle fait adopter la Loi sur les biens culturels et en 1973, elle dépose le projet de loi no 63, Loi sur le Conseil du statut de la femme. Ce projet de loi est adopté à la session parlementaire suivante, après son départ de la vie politique.
14 février 1973
Son siège devint vacant lors de sa nomination à titre de juge de la Cour provinciale et de présidente de la Commission du salaire minimum.
24 mars 2016
Marie-Claire Kirkland meurt à l’âge de 91 ans. Le même jour, le premier ministre Philippe Couillard annonce la tenue de funérailles nationales « pour souligner l’engagement et le dévouement de Mme Kirkland-Casgrain qui, en tant que première femme à exercer des fonctions dans les domaines politique et juridique au Québec, a mis ses convictions au service de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Elle est la première femme à avoir droit à des funérailles nationales.

Affiche de la candidate Marie-Claire Kirkland. Parti libéral du Québec. Élection partielle du 14 décembre 1961.
Collection Simon Turmel
Marie-Claire Kirkland se confie à Louise Decelles sur son rôle de première députée et première ministre sans portefeuille au Québec. Émission Actualités féminines. 26 février 1963
Marie-Claire Kirkland raconte à l'animatrice Rachel Verdon son parcours de première femme élue députée. Émission Femme d'aujourd'hui. 21 mars 1978.
Extrait de l'entrevue de Marie-Claire Kirkland à l'émission Mémoires de députés.
Assemblée nationale du Québec

Photographie de presse de Marie-Claire Kirkland, le soir de sa victoire, à son local électoral. United Press International. Élection 1962.
Collection Dave Turcotte

Le Bottin parlementaire du Québec. 12 octobre 1962.
Collection Dave Turcotte


Carte postale autographiée par la ministre Marie-Claire Kirkland et illustrant l'œuvre Le bateau à glace, vers 1860 de l'artiste Cornelius Krieghoff. Ministère des Affaires culturelles / Musée du Québec.
Collection Alain Lavigne

Article du journal Dimanche-Matin. 5 juin 1966.
Collection Dave Turcotte

Article du journal Le Soleil. 18 avril 1970.
Collection Dave Turcotte
La comédienne Alice Pascual témoigne de sa grande admiration pour Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Série Nos géants. 27 mars 2022.
La Fondation Lionel-Groulx
Lise Bacon
Première femme élue présidente d’un parti politique au Canada (1970)
Première femme à occuper la fonction de vice-première ministre (1985)
« Sa trajectoire politique commence un été des années 40, dans un terrain de jeu baigné de soleil trifluvien. Des pièces de 10 cents pleuvent entre les balançoires. Des enfants courent vers ces fragments de fortune, qui brillent comme autant de promesses de gros sacs de friandises. Une fillette ne participe pas à la bousculade. La jeune Lise reste plantée là, toisant l’homme qui vide ainsi ses poches, Maurice Duplessis ». C’est en ces mots que décrit, Jean-François Lisée, le premier contact de Lise Bacon avec la politique. « Ça m’avait humiliée au plus profond de moi-même », confie-t-elle.
Lise Bacon est issue d’une famille politisée. Jean-François Lisée rappelle que « chez Joseph et Yvonne Bacon l’enfer est bleu. Joseph est organisateur libéral à Trois-Rivières, capitale de l’Union nationale et de son chef. À 16 ans, Lise assiste aux assemblées du parti, participe aux campagnes, prononce ses premiers discours, assimile la culture libérale, se taille un caractère de batailleuse. Son idole : Eleanor Roosevelt, la très activiste épouse du président des États-Unis Franklin Roosevelt ; une first lady qui dépassait nettement son mari sur la gauche ».
En entrevue avec Marie-Jeanne Robin, Lise Bacon raconte le début de son militantisme ainsi : « J’étais étudiante. Et dans ce milieu, il y avait une certaine “conscientisation” face aux événements sociaux. C’étaient les années cinquante avec, à Québec un gouvernement très autoritaire. Quand on ne l’acceptait pas, il fallait s’engager contre. Et dans mon milieu familial, on réagissait déjà. D’autant plus que j’habitais à Trois-Rivières, le comté même de Duplessis. Notre première tâche était d’inciter les gens à aller voter ».
Elle débute son militantisme au sein du Parti libéral dès 1954. Elle est notamment, directrice provinciale de la Fédération des jeunes libéraux du Québec (1954 à 1956), présidente du Groupement régional des femmes libérales de la Mauricie (1963 à 1965), vice-présidente pour le secteur de la Mauricie de la Fédération des femmes libérales du Québec (1965 à 1967), secrétaire de la Commission de la constitution de la Fédération libérale du Québec (1966 et 1967) et présidente de la Fédération des femmes libérales du Québec (1967 à 1970).
Lise Bacon présente la structure du Parti libéral à cette époque : « Il y avait une fédération séparée du Parti où [les femmes] travaillaient un peu en vase clos. Mais il fallait le faire : aujourd’hui c’est facile de juger, mais je crois qu’il y a des femmes qui se sentent à l’aise à travailler dans ce que j’appelle la “mixité” au niveau du Parti. À l’époque, il y avait trois entités : la fédération des femmes, la fédération des jeunes et le Parti comme tel qui en congrès annuel regroupait tout le monde. Chaque fédération avait quand même ses congrès, ses réunions, ses assemblées, ses conférences. Je pense que ces séparations étaient justifiées par le contexte dans lequel nous étions. Mais, lorsque je suis arrivée à la présidence des femmes libérales en 1967, j’ai essayé de mettre davantage de pression pour que les femmes n’aient pas peur de s’impliquer dans le Parti […] D’ailleurs, mes premiers gestes [à la présidence du Parti] ont été de dire aux jeunes et aux femmes : cessons d’avoir peur de la “mixité”, impliquons-nous ensemble dans le Parti. Et c’est là que nous avons changé le nom de Fédération libérale du Québec pour Parti libéral du Québec qui regroupait les trois entités ».
Jean-François Lisée explique la déception de Lise Bacon de ne pas pouvoir être candidate à l’élection de 1970. « L’élection d’avril 1970 est au coin de la rue. Lise Bacon est prête à faire le saut, à suivre Robert à Québec. Elle connaît tout le monde à Trois-Rivières, où elle est revenue travailler. Elle se voit députée, et, qui sait ? Ministre. Autour de la table, Bourassa et la haute gomme libérale étudient les candidatures, Paul Desrochers, dont le pouvoir ne cesse de croître, mène le bal. Vient le tour de Trois-Rivières. Desrochers énumère une série d’aspirants possibles, Lise Bacon ne figure pas dans la liste. « Il faut se remettre dans la culture politique de 1970, raconte Jean-Claude Rivest. Desrochers ne croyait pas qu’une femme puisse se faire élire à Trois-Rivières. » Ayant constaté, après quelques appels dans les milieux trifluviens qu’il se heurtait à la misogynie politique ambiante, Desrochers avait résolu de ne pas risquer un bon comté au nom de l’égalité des sexes. Pendant la discussion, Lise Bacon rage en silence. “Robert s’attendait à ce que je fasse une colère à Desrochers et que je lui dise : « Trois-Rivières c’est pour moi. » Mais ça m’a tellement fait mal de voir Desrochers, qui savait très bien que je voulais y aller, et qui nommait tous les noms possibles et impossibles… Je suis restée figée là, en me disant que jamais une femme ne pourrait passer au travers. Jamais ! Quand je suis sortie, Raymond Garneau m’a dit : ‘Tu l’auras pas, Trois-Rivières. Robert ne fera pas la bataille pour toi. Tu viens de manquer ton coup. » Avant cette rencontre, Desrochers avait contacté Guy Bacon, frère de Lise, pour lui suggérer de se porter candidat. Guy habitait Longueuil et, selon Rivest, « n’avait pas le tiers du quart de la moitié du following de Lise dans Trois-Rivières ». Il arracha tout de même le siège. « J’aurais gagné, soupire Bacon. En 1970, il y avait un vent libéral ».
Lise Bacon raconte ce moment ainsi : « En 1970, j avais trente-cinq ans. Je me sentais prête à assumer ce rôle-là. Trois-Rivières était un comté très conservateur où il n’y avait pas eu de député libéral depuis quarante-cinq ans. L’organisation du Parti a fait faire des sondages. Il en est sorti qu’une femme ne pouvait pas se faire élire dans Trois-Rivières ou, du moins, que ce serait plus difficile ! On a toujours peur quand c’est une femme. Quel que soit le candidat masculin, on ne pose pas la question dans un parti. Avec le recul, je pense que j’aurais peut-être dû lutter davantage pour être candidate à Trois-Rivières. Je ne l’ai pas fait parce que j’ai trouvé vraiment odieux qu’on amène mon frère comme candidat ». Elle ajoute « Il est beaucoup plus difficile d’être acceptée à une « convention » par les membres de son propre parti que d’être acceptée dans la population. Quel que soit le parti, j’ai connu des candidats qui ont été élus plus facilement députés qu’ils n’avaient été élus candidats. C’est une question d’organisation électorale qui ne veut jamais prendre des risques. En 1970, une femme candidate c’était un risque. Il n’y avait eu que Claire Kirkland-Casgrain, comme députée… C’est alors en septembre 1970, après l’élection, que je me suis présentée à la présidence du Parti. Ne serait-ce que pour leur montrer que je pouvais faire des choses. Il fallait prouver encore. Il faut toujours prouver quand on est une femme. À ce moment-là, davantage ».
Lise Bacon remporte son pari et devient présidente du Parti libéral du Québec. Elle est ainsi la première femme de l’histoire du Canada à présider un parti politique. Elle occupe cette fonction jusqu’en 1973.
29 octobre 1973
Elle est élue députée libérale dans Bourassa avec une majorité de 3 889 votes face à son adversaire du Parti Québécois, Yves Michaud. Elle est la seule femme députée à siéger au Parlement durant tout ce mandat.
Jean-François Lisée rapporte qu’à « l’élection de 1973, l’organisation lui refuse les circonscriptions où le parti est sûr de l’emporter. “Le comté de Mont-Royal était libre. On m’a dit : “Mont-Royal, on le garde pour John Ciaccia.” Il y avait Saint-Laurent qui était intéressant. On m’a dit : “Faut le donner à Claude Forget.” Elle héritera de la circonscription électorale de Bourassa, dans le nord de Montréal, où elle n’a jamais mis les pieds et où le PQ présente un candidat vedette, Yves Michaud. Partant de zéro, elle doit frapper à chaque porte. Elle en garde une solide rancune contre Desrochers. “Chaque marche d’escalier que je monte, je vous vois là, lui dit-elle. J’ai l’impression que je passe sur vous, pour me motiver.”»
13 novembre 1973
Elle est assermentée ministre d’État aux Affaires sociales dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 30 juillet 1975.
Lise Bacon déclare en entrevue à Mémoires de députés : « Je pensais avoir fait ma marque au niveau du parti, au niveau politique au Québec. Je pensais mériter, on pense toujours qu’on mérite un poste de ministre. Tout le monde aspire et tous les députés aspirent à être ministres. » Elle ajoute : « À l’époque, le premier ministre m’avait offert les Affaires culturelles et [Marie-Claire Kirkland] avait énormément de problèmes au niveau des Affaires culturelles avant de quitter la politique. Je ne voulais pas succéder à [Marie-Claire Kirkland] en me disant : “je vais passer le même mauvais temps, la même période difficile qu’elle a eu”. Je ne voulais pas commencer ma vie politique comme ça. J’ai donc refusé lorsque j’ai eu le téléphone de Monsieur Bourassa. Mais tous les ministres avaient été réélus. C’était embêtant pour le premier ministre de me trouver un poste quand il avait prévu que je serais aux Affaires culturelles. Il m’a rappelé deux jours plus tard pour me dire : “je vais t’offrir le poste de ministre d’État aux Affaires sociales”. Donc, je n’avais pas un ministère bien à moi, mais où j’ai quand même appris énormément. C’était un ministère énorme, parce qu’il y avait toute la partie sociale, la partie santé, qui venait d’être regroupée. On remettait les structures en place. On essayait de les faire fonctionner. Et ça, c’était pas facile. Je me rappelle, quand j’arrivais avec un dossier au conseil des ministres, tous les ministres parlaient sur le dossier. Au début, j’essayais d’argumenter à mesure avec eux et j’ai appris qu’il fallait les laisser parler. Dire tout ce qu’ils avaient à dire et à la fin je disais : “si ça ne vous dérange pas, je pense connaître le dossier davantage que vous, mieux que vous parce que moi ça fait des mois que je travaille le dossier donc je vais vous l’expliquer à nouveau”. Et là j’expliquais le dossier. Mais c’est difficile d’être obligé de faire ça. Je me sentais un petit peu de second ordre, seconde classe, d’être obligé d’attendre que tout le monde ai parlé. Un collègue masculin n’avait pas à faire ça parce qu’on dit : “il connaît son métier. Il connaît son dossier, il est intelligent”. Mais une femme doit toujours, et c’était à l’époque 1973, 1976, ça fait quand même 30 ans, et il y a trente ans il fallait faire sa marque. » Elle dit aussi : « Ça n’a pas été facile d’être accepté par mes collègues. C’est évident. Étant la seule femme, on disait : “elle est nommée parce qu’elle est la seule femme”. J’avais un collègue qui avait dit que j’étais nommé parce que j’avais une jupe et que si je n’avais pas de jupe je n’aurais pas été ministre.” »
Jean-François Lisée parle du côté travaillant de Lise Bacon : « Ivre de cette première responsabilité, de cette première occasion de « changer le monde », elle se plonge dans les dossiers. Le soir même où elle doit être assermentée, elle campe au bureau jusqu’à minuit. “Je suis restée trois jours avec la même robe sur le dos. Je ne voulais pas sortir. Je voulais voir ce que c’était.” »
Lise Bacon se souvient du Plan Bacon, les premières garderies subventionnées par le gouvernement du Québec : « Il y avait des garderies subventionnées par le fédéral, ce qu’on appelait SOS garderie à l’époque et évidemment elles ne voulaient pas changer. Il n’y avait aucun budget de l’État québécois pour les garderies. C’est ce que je voulais avoir. Un plan public, qui pouvait aider, parce que dans ma campagne électorale, j’avais vu des mères de famille aller travailler et laisser les enfants à la grand-maman, qui ne parle ni français, ni anglais, par exemple et qui avait des problèmes. Il y avait énormément de besoins. Alors, j’avais vraiment décidé qu’il fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Le programme, le Plan Bacon à l’époque, c’était le début des garderies subventionnées par l’État. Mes collègues étaient assez réfractaires à ça. J’ai pris les plus endurcis contre les garderies, je les ai amenés avec moi à travers le Québec. Parce que j’aimais beaucoup aller consulter la population. Pour savoir ce que les autres gens pensent. Alors ça été de longue lutte mais heureusement, à la fin, j’ai gagné l’acceptation de mes collègues puisqu’on a mis en marche le Plan Bacon avec un budget de début de 5 millions qui n’étaient quand même pas élevés à l’époque. »
30 juillet 1975
Elle est assermentée ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 26 novembre 1976.
Jean-François Lisée explique que Lise Bacon ne l’a pas facile à ce ministère : « Bacon ouvre trois fronts : une première loi de protection des consommateurs, une loi instituant la protection des automobilistes « sans égard à la responsabilité » (le no-fault), une loi sur la société de développement coopératif. Dans les trois cas, elle se heurte à une forte résistance des membres du Cabinet. L’ex-premier ministre Jean Lesage, qui agit alors comme conseiller du comité de législation, trouve que le projet de loi de protection du consommateur va trop loin. “Enlevez ça, ça et ça”, ordonne-t-il. Bacon n’en fait rien. Elle porte le projet au Conseil des ministres, où elle entend Gérard D. Levesque chuchoter au premier ministre ; “Elle a rien enlevé, la petite madame. ” Gérard D., propriétaire de garage, est particulièrement sensible aux arguments s’opposant à la garantie sur les réparations de voitures. Le caucus, constitué en grande partie d’avocats, rechigne, quant à lui, à tuer la poule aux œufs d’or des poursuites pour dommages corporels, qui disparaîtraient avec la nouvelle loi (sans égard à la faute) en assurance automobile. ‘Il y avait une expression que j’entendais beaucoup, se souvient Jean Cournoyer ; on disait “va-t-on arrêter de faire mal à tous nos amis ?”, les avocats comptant pour beaucoup parmi les pourvoyeurs des caisses électorales. Alors même que le Cabinet a approuvé le principe, sinon l’application, de cette loi, le ministre Denis Hardy lance, en plein congrès libéral, une attaque-surprise contre le projet. Aucun collègue ne vient à la rescousse de Bacon, qui doit improviser une défense. Elle se sent isolée, peu écoutée. Elle demande à d’autres ministres de soulever, au Cabinet, certains arguments à sa place. “Si c’est moi qui le faisais, ça ne passait pas, parce que j’étais une femme, explique-t-elle. Je n’aime pas dire ça, mais il n’y a pas un homme qui connaît ça. Il faut avoir le vécu d’une femme.” »
20 janvier 1976
Elle est assermentée ministre de l’Immigration dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 26 novembre 1976.
15 novembre 1976
Elle est défaite par 2 162 votes face à son adversaire du Parti Québécois, Patrice Laplante.
13 avril 1981
Elle est élue députée libérale dans Chomedey.
À quelques semaines des élections d’avril 1981, on lui propose d’abord de retourner dans la circonscription de Bourassa où elle a été défaite en 1976. Elle refuse. Lise Bacon raconte son retour en politique : « J’avais rencontré le candidat dans Bourassa. Je lui avais dit : “Je te souhaite bonne chance”. Ça, c’était le vendredi. J’ai trouvé qu’il était un peu fou de se présenter, mais bon. Il faut un peu d’adrénaline qui fonctionne et qui nous pousse à se présenter. Ensuite, le samedi soir j’étais chez moi et je devais sortir. C’est amusant de voir comment ça arrive les choses. Je devais sortir cette soirée-là. J’ai remis la soirée. J’ai un téléphone de Pierre Bibeau qui m’a dit : “on a un comté pour vous : Chomedey”. À l’époque, monsieur Ryan, qui était le chef du parti, avait un candidat qu’il préférait et Jean-Noël Lavoie en avait un autre. J’ai été la candidate du compromis. Je me suis rendu chez Jean-Noël Lavoie. Il m’a expliqué le comté. C’était relativement plus facile. C’était un comté intéressant : 50 % francophone, 50 % multiethnique. J’avais été ministre de l’Immigration. J’avais côtoyé ces gens-là. J’ai accepté le samedi soir et le lundi matin, j’ai dit à mes patrons que j’entreprenais une nouvelle carrière en politique. On a toujours l’impression, quand on a été que 3 ans et demi à Québec, on a l’impression qu’on n’a pas terminé. J’avais trouvé que la période avait été courte et comme on veut changer le monde, ça toujours été ça ma ligne de direction, il faut être là ! » Jean-François Lisée ajoute : « Elle pense revenir au pouvoir. Elle se retrouve finalement dans l’opposition, sous la férule du nouveau chef, Claude Ryan, qui la nomme critique de l’immigration. Mais quelque chose cloche. Elle semble avoir perdu son agressivité. C’est que le ministre à qui elle doit riposter s’appelle Gérald Godin, un ancien voisin de Trois-Rivières. Et entre Trifluviens, on est gentil. “Lise n’est pas restée plus d’une semaine ma critique officielle parce qu’on a jugé qu’elle n’avait pas assez de mordant ”, raconte Godin, qui avoue par ailleurs sa juvénile admiration pour la députée : “Pour nous [les Trifluviens], Lise incarnait l’audace féminine.” »
La chimie ne passe pas entre Lise Bacon et Claude Ryan. Après avoir demandé ouvertement un congrès au leadership, ce dernier lui retire ses dossiers de porte-parole. Elle demeure simple députée de Chomedey.
2 décembre 1985
Elle est réélue députée libérale dans Chomedey.
12 décembre 1985
Elle est assermentée vice-première ministre dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 janvier 1994.
Lise Bacon est surement la vice-première ministre qui a eu le plus de pouvoir. Elle est en quelque sorte la première première ministre sans avoir le titre. Lise Bacon raconte comment son mandat débute. « Monsieur Bourassa s’était présenté dans le comté de Bertrand sur la Rive-Sud de Montréal. Il n’avait pas été élu. Il ne pouvait pas être en chambre, mais il pouvait être premier ministre parce qu’on avait suffisamment de députés libéraux. Il devait alors regarder la période des questions de son bureau et c’était moi qui faisais la période des questions à sa place et évidemment, au début, la lecture du discours du trône. Ce qui a fait dire, tout le reste de la session, à l’opposition “le discours de la vice-première ministre”. On a toujours fait référence au discours de la vice-première ministre, mais c’était quand même le discours du trône. »
En raison de sa lutte contre le cancer, le premier ministre Robert Bourassa doit s’absenter du pouvoir en 1990, 1991 et 1993. Lors de ces absences, Lise Bacon préside le caucus, le Conseil des ministres, gère l’État. « Les arbitrages finaux, c’est Lise qui les a rendus », explique Jean-Claude Rivest, conseiller de Bourassa. « Elle est à l’apogée de sa carrière, en pleine possession de ses moyens, elle a eu le plein contrôle. » Un ancien ministre libéral affirme : « Elle est décisive, elle grouille, elle ne laisse pas traîner les choses ». Un proche du premier ministre ajoute : « Les ministres préfèrent s’entendre entre eux plutôt que d’envoyer leurs litiges en arbitrage au bureau de la vice-première ministre. Ils savent que si ça monte en haut, il va y avoir une décision rapide, finale et imprévisible. Ils préfèrent éviter ça. » « On a nettoyé beaucoup de dossiers qui avaient traîné parce que la crise était longue », raconte Lise Bacon, parlant de la première absence de Robert Bourassa. Elle dit au premier ministre : « Quand tu vas revenir, tu n’auras pas grand-chose à faire, parce que tout sera nettoyé ! »
En juin 1990, la négociation de l’Accord du lac Meech s’étire. Robert Bourassa est retenu là-bas pendant plusieurs jours. La pression est forte sur le gouvernement. Au parlement, l’ambiance est à couper au couteau. Les troupes de Jacques Parizeau ont le couteau entre les dents. Lise Bacon tient le fort. Elle se permet même d’aller à l’attaque. Lise Bacon raconte ce moment. « Lors des discussions de la Constitution à Ottawa, le premier ministre était parti pendant une semaine. Ça devait être une journée ou deux, mais ça a duré toute une semaine. Évidemment, j’étais à la période des questions celle qui devait répondre aux questions. Je pense que j’avais un attaché de presse à l’époque qui faisait exprès pour me mettre en rogne juste avant d’entrer en chambre. J’ai été très dur avec monsieur Parizeau toute la semaine. Ça soulevait nos troupes. Nos troupes étaient heureuses. Nos députés étaient contents. Mais monsieur Parizeau avait la vie dure. Tous les soirs, j’avais un téléphone du premier ministre qui me disait : “prends-en soin, t’es un peu dur”. Mon premier ministre me disait : “faut que je le garde, prends en soin”. Mais ça revenait à chaque jour parce que la période des questions c’est une joute et il fallait jouer dur. » Elle ajoute : « Quand le premier ministre est revenu, il a trouvé des députés de bonne humeur, content de le voir revenir, mais aussi très heureux de leur semaine. Alors, j’avais réussi parce qu’il avait dit au caucus : “je remercie Lise d’avoir tenu le fort pendant mon départ” et tout le monde s’était levé. C’était un geste spontané qui m’avait vraiment fait chaud au cœur parce que les députés n’ont pas l’habitude de nous féliciter. Ils avaient applaudi à tout rompre à la grande surprise du premier ministre. » Jean-François Lisée ajoute : « Cet accueil, en plus de la satisfaction d’avoir dirigé sans heurts le gouvernement et de s’être gagné le respect de plusieurs de ses pairs au cours des quelques mois que Robert Bourassa a passés sur son lit d’hôpital, ont constitué pour Lise Bacon les premières gratifications d’une longue carrière politique faite d'espoirs déçus, de travail méconnu, de loyauté jamais récompensée ».
En 1986, elle déclare : « Un peu partout dans le monde, les femmes ont démontré qu’elles pouvaient gouverner aussi efficacement que les hommes. […] Je crois que la venue un jour d’une première ministre est non seulement possible, mais souhaitable. L’alternance au pouvoir entre hommes et femmes donnerait un bien meilleur équilibre à notre société. Je suis sûre que viendra le moment où une Québécoise va relever ce défi. » L’idée de créer elle-même un précédent féminin au sommet de l’État lui effleure l’esprit. Au début de 1993, un de ses amis affirme qu’elle a fait plusieurs aller-retour entre son envie de briguer la succession et son désir de quitter la politique. « Après avoir fait l’intérim [en 1990 et 1991], elle y avait pris goût et avait décidé qu’elle y allait. [L’ex-ministre] Paul Gobeil avait même signalé qu’il reviendrait en politique avec elle pour lui donner un coup de main. Depuis, il a changé d’avis, elle aussi, plusieurs fois. » Elle décide toute foi de quitter ses fonctions le même jour que le premier ministre Robert Bourassa.
12 décembre 1985
Elle est assermentée ministre des Affaires culturelles dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 octobre 1989.
Jean-François Lisée explique comment Lise Bacon a réussi à faire adopter le statut de l’artiste. « Ramant à contre-courant, son propre gouvernement n’étant que vaguement intéressé par le projet, elle attaque le dossier du statut de l’artiste. C’est en menaçant Robert de démissionner qu’elle obtiendra satisfaction, trois ans d’ailleurs avant que le gouvernement fédéral ne lui emboîte le pas. C’est une réalisation majeure, applaudie par les milieux culturels québécois. La dramaturge et comédienne Marie Laberge, dont on connaît les sympathies souverainistes, ne tarit pas d’éloges. Bacon “a un discours clair, intelligent et remarquablement sain”, dit Laberge. Elle a “le courage de ses opinions”, sait écouter et, côté culture, “s’est très bien ‘autodidactée’”. “J’en ai vu des ministres de la culture, ajoute la dramaturge. Jamais ils n’ont voulu autre chose que d’être photographiés avec moi.” Avec Bacon, “c’est la première fois qu’une personnalité politique qui me demande une collaboration, non seulement s’intéresse à ce que je fais comme artiste, mais va voir mes pièces et lit mes œuvres.” »
12 décembre 1985
Elle est assermentée ministre responsable de la Charte de la langue française dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 31 mars 1988.
21 décembre 1988
Elle est assermentée ministre de l’Environnement dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 octobre 1989.
25 septembre 1989
Elle est réélue députée libérale dans Chomedey.
11 octobre 1989
Elle est assermentée ministre de l’Énergie et des Ressources dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 janvier 1994.
11 janvier 1994
Elle démissionne comme ministre et députée.
Lise Bacon affirme en entrevue à l’émission Mémoires de députées : « On ne peut pas rester constamment en politique. J’étais députée dans le comté extraordinaire de Chomedey qui m’aurait réélu t’en que j’aurais voulu. Après deux mandats, on se connaissait. On se comprenait. Et j’avais des majorités énormes. Alors, ce n’est pas parce que c’était un comté difficile. Un jour ou l’autre il faut que ça soit terminé. Il faut le laisser à d’autres. Parce que les générations changent. Leur façon de faire change. Leur vision des choses n’est pas la même. J’ai de la difficulté à accepter que certains politiciens s’accrochent à leur vie politique sans vouloir laisser ça à d’autres. On peut laisser à d’autres. »
Lise Bacon est nommée sénatrice de la division de La Durantaye par le premier ministre Jean Chrétien. Elle occupe cette fonction de 1994 à 2009.

En 1970, Lise Bacon devient la première femme élue présidente d’un parti politique au Canada.
Photographie de Lise Bacon, présidente du Parti Libéral du Québec. 21 septembre 1973.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Photographe : Gaby (Gabriel Desmarais)

Sur le côté A : Lise Bacon fait une présentation en langue française, espagnole et anglaise
Sur le côté B : Ritournelle électorale
Disque Encore un peu plus loin avec Lise Bacon. Parti libéral du Québec. Élection 1973.
Collection Dave Turcotte
Louise Cuerrier
Première femme à occuper la fonction de vice-présidente de l’Assemblée nationale (1976)
29 octobre 1973
Elle est candidate défaite du Parti Québécois dans Vaudreuil-Soulanges.
15 novembre 1976
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Vaudreuil-Soulanges.
14 décembre 1976
Elle devient la première femme de l’histoire à occuper la fonction de vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Elle occupe cette fonction jusqu’au 19 mai 1981.
Comme première femme à un poste de commande d’une assemblée d’hommes pas encore habitués à partager le pouvoir avec des femmes, Louise Cuerrier ne l’a pas eu facile. Lise Payette écrit : « Quant à la vice-présidente de l’Assemblée nationale, antre de la démocratie souvent travesti en “nid de coucous”, les honorables députés lui ont fait subir tous les outrages. Ses “à l’ordre, messieurs” ont fait glousser, trompeter, rigoler, des deux côtés de la chambre. Je prétends que Louise Cuerrier ne se serait jamais fait traiter d’incompétente si, un jour de houleuse grossièreté, elle était descendue de son fauteuil pour gifler deux ou trois de ces garnements. Les rapports de force prennent plusieurs formes. »
13 avril 1981
Elle est défaite par 1 955 votes face à son adversaire libéral, Daniel Johnson, fils, fils du 20e premier ministre du même nom et sera lui-même le 25e premier ministre du Québec en 1994.

Photographie de la députée Louise Cuerrier lors d'un rassemblement politique.
Collection Dave Turcotte
Don de Claude DeBellefeuille
Denise LeBlanc
Première députée à donner naissance à un enfant durant son mandat (1979)
15 novembre 1976
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Îles-de-la-Madeleine.
15 avril 1979
Elle est la première députée à donner naissance à un enfant en cours de mandat en Amérique du Nord.
13 avril 1981
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Îles-de-la-Madeleine.
30 avril 1981
Elle est assermentée ministre de la Fonction publique dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu'au 1er avril 1984.
29 novembre 1983
Elle est assermentée ministre déléguée à la Condition féminine dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu'au 26 novembre 1984.
26 novembre 1984
Elle démissionne du cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle siège comme indépendante à compter du 27 novembre 1984.
2 décembre 1985
Elle ne se représente pas à l'élection.
Macaron de la candidate Denise LeBlanc. Parti Québécois.
Collection Dave Turcotte


Article du journal La Presse. Mardi 17 avril 1979.
Journal La Presse
Lise Payette
Première femme à occuper la fonction de ministre d’État à la Condition féminine (1979)
Lise Payette débute sa carrière publique par le journalisme. Elle fait de la radio à Trois-Rivières, à Rouyn-Noranda, Québec et Montréal. Puis de Paris, elle collabore à plusieurs journaux et revues. Elle anime l’émission Interdit aux hommes. Au cœur des années 1960, Lise Payette, de retour au Québec, constate que les femmes on prit plus de place. Dans son émission Place aux femmes, Lise Payette traite de sujets très tabou pour l’époque. De 1972 à 1975, elle coanime l’émission télévisée Appelez-moi Lise en compagnie de Jacques Fauteux. L’émission lui apporte la célébrité et fait d’elle la porte-parole du mouvement féministe québécois. Elle anime le Gala du plus bel homme du Canada durant neuf ans, une émission qui vise à représenter la libération de la femme et à placer l’homme comme objet. Selon Stéphane Laporte, c’était la Oprah Winfrey du Québec. En 1975, dans le cadre de l’Année internationale de la femme, elle préside l’organisation de la Fête nationale du Québec sur le Mont-Royal à Montréal.
Lise Payette sent que c’est par l’action politique qu’elle peut poursuivre son combat. « Je continue d’être fascinée par le fait qu’il soit encore si facile de faire de la politique au Québec. Se fait-on remarquer par son esprit d’“entrepreneurship” ? Se distingue-t-on dans une carrière publique ? Fut-elle journalistique, syndicale ou sociale, les gens se diront immanquablement : “il ou elle se prépare une carrière politique.” Quant à moi, j’étais le parfait stéréotype. Mon destin aurait pu être tout tracé dans les feuilles de thé de ma grand-mère. On me reconnaissait partout. Je faisais les délices [du caricaturiste] Girerd. La misère, l’injustice et l’oppression m’ont toujours empêchée de dormir. J’étais, en principe, la parfaite candidate. Pourtant, personne ne m’a forcée à faire le grand saut. C’était pour moi une simple question de mauvaise conscience, j’avais beaucoup reçu, j’avais aussi beaucoup dénoncé, revendiqué, pointé du doigt et de la langue. Je ne peux blâmer personne d’autre que moi-même. Je suis entrée en politique par conscription volontaire ».
En 1976, voyant l’élection québécoise venir, elle offre ses services au Parti Québécois. « Mon tour était venu. J’ai vécu mon choix avec fièvre, frénésie et ardeur, un peu comme quand on se sent amoureux. C’était le Québec de 1976, découragé, résigné presque, face aux troubles sociaux qui surgissaient de toutes parts, face à un gouvernement qui tanguait au gré des pressions contradictoires, face à son chef, Robert Bourassa, qui avait réussi le tour de force de perdre l’estime de tout le monde, ses amis comme ses ennemis. Six députés dans l’opposition pour dénoncer l’incurie et l’inertie libérales. C’était impossible, ridicule et attirant. Ma décision était prise. Je serais la septième, ou la douzième, ou la trentième si le Parti Québécois était chanceux aux prochaines élections. Je serais là, moi aussi, dans le grand salon vert devenu bleu par la suite, de nuit, de jour, à dénoncer, à filibuster, à pomper de l’air là où les 102 députés au pouvoir se relayaient dans la “noble enceinte” asphyxiante et vivaient leurs derniers soubresauts autour d’une partie de blackjack, d’une bouteille de gin ou du ronflement insolent d’un des élus du peuple ».
15 novembre 1976
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Dorion.
Lise Payette se souvient des premiers jours suivant son élection. « Je suis encore sous le choc. Depuis le 16 novembre, les journalistes supputent les ministrables parmi les élus, on prétend que Lévesque n’y échappera pas, qu’il devra me nommer ministre. Je souris. C’est vrai que j’ai probablement donné un bon coup de main pour l’élection, mais on ne nomme pas un ministre comme moi, sans expérience, sans études en droit ou en sciences politiques. Je trouve toutes les excuses. “Il lui faudra une femme.” J’enrage déjà. Je ne veux pas être nommée parce que je suis une femme. René Lévesque ne donne pas signe de vie. Il est enfermé quelque part avec ses conseillers, disent les journaux. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ».
26 novembre 1976
Elle est assermentée ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu’au 21 septembre 1979.
Lise Payette raconte sa rencontre avec René Lévesque. « Mon tour est venu ; comme on dit, “mon heure est arrivée”. J’essaie d’être drôle. Au moins, montrer que j’ai le sens de l’humour. […] Lévesque et moi sommes seuls. Que va-t-il dire ? Il me demande si je suis prête à travailler très fort… Je suis prête à tout si vous admettez que le courage et la ténacité peuvent tenir lieu de compétence. Quelques minutes. Je nous regarde tous les deux, timide et intimidés l’un par l’autre, moi parce qu’il est lui et lui parce que je suis une femme. Nous n’avons pas de passé commun, pas d’anecdote à partager, pas de militantisme de tranchées pour nous lier, nous sommes là pour l’avenir. Les Consommateurs, et quoi ? Je suis bloquée. Je suis furieuse, mais trop polie pour le laisser voir, j’ai envie de le traiter de tous les noms. Donner à une femme le seul ministère qui était occupé par une femme sous Bourassa (Lise Bacon), j’estime que l’imagination lui a fait défaut. Il aurait pu se forcer. Mais on ne peut pas faire de caprice avec celui qui sera premier ministre dans quelques heures. Il s’empresse d’ailleurs, pour mieux me distraire, de me mettre sous le nez une feuille sur laquelle sont griffonnés les noms de quelques autres avec leur affectation ministérielle à côté. J’ai du mal à m’y retrouver, tellement il y a rature sur rature. “Qu’est-ce que vous en pensez ?” Je ne suis pas spécialiste en hiéroglyphes. J’ai l’audace de commenter, deux, ou même trois de mes futurs collègues qui me semblent mal ministrés selon moi ».
Lise Payette explique ses premiers jours de ministre. « Mais d’abord, trouver le ministère. Michel Therrien (son garde du corps) se renseigne. “C’est dans le grand édifice de marbre rose, place d’Youville.” C’est peut-être la couleur de l’édifice qui inspire les premiers ministres et qui fait que je prends la relève de Lise Bacon. Un ministère en marbre rose pour les femmes. Encore faut-il savoir ce qu’on fait quand on est ministre. Qui me donnera ma première leçon ? Personne n’a plus le temps. Ni Marcel Léger qui a sur les bras toute la troupe des députés. Ni Robert Burns qui doit organiser rapidement une première mini-session. J’ai besoin de quelqu’un qui a tout son temps et qui acceptera de me donner quelques heures. C’est mon ami Jean-Paul L’Allier, le premier [libéral] défait du 15 novembre, qui m’accueillera dans sa magnifique maison de l’île d’Orléans et répondra sans rire à mes questions. J’avais confiance en lui. Comment devient-on ministre ? “On se rend à son bureau un matin, à une heure raisonnable, on accroche son manteau et on commence.” C’est aussi simple et aussi difficile que cela. Il m’a parlé du pouvoir, de ses pièges, de ses mythes, il n’y avait ni amertume ni rancune dans ses propos, juste des regrets. Des regrets d’avoir laissé des choses inachevées ».
Le Québec doit, entre autres, à Lise Payette la création de la Société de l’assurance automobile du Québec. En 1978, elle réussit le tour de force de faire adopter son projet de loi très critiqué par de nombreux lobbys d’assureurs, d’avocats et même au sein même de son propre parti. Claude Charron croit même que si elle a réussi à faire cette réforme, c’est grâce à sa « tête de cochon ». Cette réforme majeure, qui dans le langage populaire porte souvent le nom de « La Payette », vise à indemniser les victimes d’accident de la route sans égard à la responsabilité (no fault).
21 septembre 1979
Elle est assermentée ministre d’État à la Condition féminine. Elle occupe cette fonction jusqu’au 30 avril 1981. En 1979, Lise Payette exige de se faire appeler madame « la » ministre au lieu de madame « le » ministre, lançant dès lors la féminisation des titres au Québec.
Lise Payette explique qu’en « 1976, je ne m’attendais pas à être nommée ministre responsable du Conseil du statut de la femme. Sous les libéraux, cette responsabilité avait été confiée à deux hommes successivement : Fernand Lalonde et Bernard Lachapelle, il m’était déjà arrivé de penser qu’il aurait mieux valu dissoudre le conseil, tant sous les libéraux il avait servi d’excuse au gouvernement Bourassa. Mis sur pied à la dernière minute avant l’Année internationale des femmes, disposant de peu de moyens financiers, il m’était souvent apparu comme une astuce politique libérale pour pouvoir dire aux femmes en 1975 : voyez ce que nous avons fait pour vous. Les autres responsabilités du même ordre avaient toutes été distribuées à un conseil des ministres précédent. Ministre responsable de ceci, ministre responsable de cela, ministres membres du Conseil du Trésor. La semaine suivante, René Lévesque vint me dire […] qu’il avait oublié de nommer le ministre responsable du Conseil du statut de la femme. Je fis une blague en disant que ça commençait bien. Le premier ministre était-il confus, je n’en suis pas certaine, mais il me demanda d’accepter d’être la mère du Conseil orphelin. Je lui demandai s’il savait bien ce qu’il faisait… que je n’allais certainement pas m’employer à bâillonner le Conseil, au contraire, et qu’on devait en être conscient avant de me confier cette responsabilité. Avec un haussement d’épaules, le premier ministre me dit qu’on ne me demandait pas de le bâillonner. J’acceptai. Je me suis posé la question, à savoir si l’expression “condition féminine” avait déjà été prononcée dans la soucoupe volante (surnom donné à la salle du conseil des ministres de l’époque). Est-ce que quelqu’un y avait déjà parlé des “revendications” des femmes ?... Les murs ne répondent pas à ce genre de question. Je me retrouvais avec un Conseil sur les bras. Je n’avais même pas eu le temps de me demander si ça pouvait être un cadeau empoisonné ».
Lise Payette se souvient de la politique Pour les Québécoises : égalité et indépendance. « Je proposai au conseil une stratégie qui m’apparaissait intéressante dans la mesure où elle forcerait le gouvernement à se commettre sur l’ensemble du dossier des femmes : la préparation d’une politique globale. Au fond, un livre vert, qui sous la pression des femmes deviendrait un livre blanc, c’est-dire qui serait endossé intégralement par le gouvernement. Des femmes ont râlé qu’il fallait encore une fois recommencer. Comme ministre responsable du Conseil, je n’avais aucun pouvoir sauf celui de transmettre au gouvernement des avis du Conseil sur les sujets que le Conseil voulait bien traiter. Je pouvais aussi demander des avis au Conseil, j’avais le pressentiment que tout cela ne nous mènerait ni très loin ni très vite. Il fallait obliger le gouvernement à prendre position. Ce fut fait. Le document du Conseil, POUR LES QUÉBÉCOISES ÉGALITÉ ET INDÉPENDANCE, remis officiellement au premier ministre à l’automne 1978, fut endossé par lui quant à ses objectifs. Le gouvernement du Québec allait donc travailler à réaliser l’Égalité et l’Indépendance économique des femmes. Du moins, René Lévesque en prenait-il l’engagement. C’était un premier pas. Nous avions imaginé, avec Léa Cousineau qui était alors membre de mon Cabinet, de mettre sur pied une structure de contrôle et de surveillance dans chacun des ministères que le rapport du Conseil identifiait comme responsables des changements à mettre en œuvre. Cette structure de “répondantes”, avec un lien direct au sous-ministre en titre, devait nous aider à suivre le dossier et à empêcher que des décisions ministérielles ou des projets de loi émanant des ministères ne puissent atteindre un Comité permanent ou le Conseil des ministres sans avoir d’abord été tamisés selon la grille d’analyse de “Égalité et Indépendance”. Trouvaille astucieuse s’il en fut, mais qui a demandé de la part des répondantes du courage, de la ténacité et beaucoup d’imagination. Leur rôle était en fait de court-circuiter la machine chaque fois que les femmes étaient concernées. Elles n’ont pas toujours réussi, mais elles ont parfois évité que ne se prennent des décisions qui auraient été catastrophiques ».
Même ministre, elle poursuit son militantisme pour plusieurs causes féminines comme les services de garde et les centres d’aide pour femmes. Elle s’implique dans la réforme des lois du travail, notamment en ajoutant des congés de maternité et un droit de retrait préventif des femmes enceintes. On lui doit la réforme du droit de la famille. En 1980, Lise Payette travaille pour que le nouveau Code civil du Québec permette aux parents de donner le ou les noms de famille de leur choix à leurs enfants. À partir de ce moment-là, beaucoup d’enfants ont été nommés avec deux noms de famille.
6 novembre 1980
Elle est assermentée ministre d’État au Développement social. Elle occupe cette fonction jusqu’au 30 avril 1981.
13 avril 1981
Elle ne se représente pas à l’élection.
Lors de l’annonce de son départ de la vie politique, Lise Payette déclare : « Les femmes ne font pas beaucoup confiance aux hommes politiques… Ni hélas aux femmes politiques. Il y a eu depuis toujours tant de promesses qui leur ont été faites et qui n’ont pas été tenues que quand nous avons commencé à tenir les nôtres comme gouvernement, elles ont été portées à penser que ça n’était pas normal et qu’il fallait se méfier. C’est la deuxième raison pour laquelle je ne serai pas candidate à la prochaine élection. Je veux retourner parler aux femmes du Québec de ce qui nous concerne toutes, des exigences que nous devons avoir pour nous-mêmes et pour nos filles. Je veux leur parler du chemin que nous avons parcouru, de ce qui est gagné et de ce combat qui n’est jamais fini. Je veux leur parler des femmes et de la politique, des femmes en politique, du pouvoir et de ses limites. Il m’apparaît clair, à ce moment-ci, que je ne peux le faire avec crédibilité qu’en me dépouillant de mon titre de ministre pour qu’à nouveau, nous puissions nous parler sans méfiance. Elles constateront sans doute que mon discours ne change pas, que je sois ou non ministre, mais je crois sincèrement que je dois maintenant le leur prouver. Mes années en politique auront été pour moi, du moins, des plus importantes et des plus salutaires aussi. […] Je n’oublierai pas mes collègues, députés et ministres, à qui j’ai parfois causé des sueurs froides, mais qui ont eu souvent l’occasion de me rendre la monnaie de ma pièce. Je ne vous cacherai pas que je ne crois pas que je vais regretter l’Assemblée nationale. Cette “noble enceinte” n’a jamais réussi à me convaincre de toutes ses vertus. Je souhaite cependant passer le flambeau à d’autres femmes politiques, car, que les hommes aiment ça ou pas, ils devront se faire à l’idée que les femmes sont en politique pour la changer ».
Lise Payette se lance dans une carrière prolifique d’auteure. Elle se consacre à l’écriture de livres, de chroniques dans les journaux et séries télévisées. Elle signe le premier feuilleton quotidien du Québec, Marilyn, mettant en lumière une femme de ménage qui deviendra première ministre. Elle anime aussi quelques émissions. Tout au long de sa carrière, elle tente de prêter sa voix aux femmes du Québec. « Le message que je voudrais laisser, c’est que nos mères, nos grands-mères et nous, on a ouvert des portes. Elles étaient fermées, on est rentrées dedans. Ce qu’il reste à faire, est de les garder ouvertes pour toujours. »
Lise Payette est décédée le 5 septembre 2018 à Montréal. Le gouvernement du Québec lui consacre une cérémonie d’hommage nationale le 20 octobre 2018.
Les « Yvettes »
Lise Payette revient sur les « Yvettes » :
« Mars 1980. Je cherche un moyen de faire comprendre clairement ce que sont les modèles sexistes véhiculés par les livres d’école. Je n’ai, en fait, que l’embarras du choix des textes, puisque les livres d’école en sont encore pleins. Mais j’aime l’exemple de Guy et Yvette. Il me paraît clair et tellement évident que même mon collègue de l’Éducation ne pourra plus prétendre que j’exagère. […] J’ai besoin de son appui pour arriver à obliger le ministère de l’Éducation à s’engager à l’élimination des stéréotypes sexistes dans les livres scolaires. Le 9 mars, à l’auditorium du Plateau à Montréal, devant une salle partisane, dans une assemblée organisée par le Parti Québécois de Montréal-Centre, j’ai lu l’extrait du manuel scolaire. J’ai enchaîné en disant que j’étais une Yvette, que nous étions toutes des Yvettes à cause de l’éducation que nous avons reçue. Improvisant devant sept cent cinquante personnes, j’ai ajouté que Claude Ryan (chef libéral de l’époque), si on en jugeait par ses propos et ses attitudes, serait le genre d’homme à vouloir que les femmes restent des Yvettes et… maladresse des maladresses, j’ai ajouté : “Il est d’ailleurs marié à une Yvette.” Renée Rowan, du Devoir, était la seule journaliste à “couvrir” l’événement. Elle rapportait ma maladresse le lendemain dans sa chronique. Quelques jours plus tard, Lise Bissonnette, éditorialiste au même Devoir, signait un billet à couper le souffle ».
« Je n’aurais pas dû parler de Madeleine Ryan. C’était une erreur. Ma remarque était déplacée. Je ferai des excuses. Le 12 mars, je me levai en Chambre pour dire ceci : j’ai en main un livre de lecture de deuxième année, dans lequel on peut lire : “Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique, le tennis, la boxe, le plongeon, son ambition est de devenir champion et de remporter beaucoup de trophées. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille… elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l’heure du repas, elle a tranché le pain, versé l’eau chaude sur le thé dans la théière, elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait, elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Après le déjeuner, c’est avec plaisir qu’elle a essuyé la vaisselle et balayé le tapis. Yvette est une petite fille obligeante.” Monsieur le président, comme on apprend ça dans les écoles, à l’époque où on se parle maintenant, je me suis permis, monsieur le président, quand on m’accuse de faire de la démagogie, de souligner que les femmes du Québec ont bien du mérite, ayant été élevées comme Yvette à devenir autre chose que des Yvette. Si j’ai pu blesser, par cette remarque, qui que ce soit, y compris l’épouse du chef de l’Opposition, je m’en excuse publiquement, parce que telle n’était pas mon intention, mon intention était de continuer ce que je fais depuis 20 ans et d’aider les femmes du Québec à sortir de ces stéréotypes dont nous sommes affublées ».
« En principe, l’incident aurait dû être clos. Les organisateurs libéraux mirent trois semaines entre ma malencontreuse allusion à Madeleine Ryan et la première manifestation du Comité du non où, au Château Frontenac à Québec, des femmes se laissèrent coller l’étiquette d’Yvette. Le 30 mars, elles étaient mille cinq cents à bruncher en écoutant une brochette d’oratrices vedettes venues leur expliquer pourquoi il était impérieux de voter non au référendum. On a, semble-t-il, très peu parlé de moi au cours de ce brunch des Yvettes. Les journalistes et les politiciens ont toutefois rapidement changé de ton devant l’ampleur de la réunion “dite spontanée” des Yvettes au Forum à Montréal. La blague ou la gaffe de Madame la ministre était devenue dans la presse l’insulte et le mépris. Je sentais de plus en plus l’injustice de la situation. Le ridicule aussi. Toutes ces femmes qui s’affublaient d’un prénom symbolisant la dépendance, et surtout l’utilisation des Yvettes par d’autres femmes comme Thérèse Casgrain, Monique Bégin, Sheila Finestone, Yvette Rousseau, Thérèse Lavoix-Roux, Solange Chaput-Rolland et d’autres, qui non seulement n’étaient pas elles-mêmes des femmes au foyer, mais des femmes de carrière qu’on aurait en d’autres temps citées en exemple aux féministes. Ma seule consolation : mon but premier était atteint. Jacques-Yvan Morin, m’entendant lire l’histoire de Guy et Yvette en Chambre, vint me trouver en disant : “ce n’est pas vrai, n’est-ce pas ? On ne trouve pas ça dans un livre d’école de maintenant ?” Eh oui, cher collègue, sa décision était prise, le ministère de l’Éducation éliminerait le sexisme dans les livres d’école. Yvette était morte, du moins la mienne, la petite sœur de Guy ».


Livre Mon deuxième livre de lecture. Édition Du Quartz. 1935.
Collection Dave Turcotte
De 1972 à 1975, Lise Payette coanime l’émission télévisée Appelez-moi Lise en compagnie de Jacques Fauteux. Cette émission diffusée à 23 h attire à l’époque, plus d’un million de téléspectatrices et téléspectateurs subjugués par ses nombreux « défis » : être gardienne de but au hockey, traverser le fleuve Saint-Laurent à Québec, conduire un camion de pompier, être maire de Montréal pendant une journée.
Revue Hockey Match. Fédération du hockey sur glace du Québec. Vol. 1, No 2, décembre 1973.
Collection Dave Turcotte


Macaron de la candidate Lise Payette. Parti Québécois. Vers 1980.
Collection Dave Turcotte

Sur le côté A : Monologue de l'humoriste Yvon Deschamps donnant son appui à Lise Payette
Sur le côté B : Présentation de Lise Payette
Disque de la candidate Lise Payette. Parti Québécois. Élection 1976.
Collection Dave Turcotte
Publicité télévisée mettant en vedette Lise Payette. Parti Québécois. Élection 1976.
Collection Dave Turcotte

Photographie de presse de Lise Payette, le soir de sa victoire, au Centre Paul-Sauvé. Élection 1976.
Collection Dave Turcotte
Les membres du Conseil du statut de la femme, en assemblée régulière tenue le 14 septembre 1978, ont accepté à l'unanimité les objectifs énoncés dans cette politique d'ensemble de la condition féminine présentée à la ministre Lise Payette et au ministre Pierre Marois.
Pour les Québécoises : égalité et indépendance. Conseil du statut de la femme. 1978
Collection Dave Turcotte

Lors de la création de la Société de l'assurance automobile du Québec en 1978, Lise Payette remplace « La belle province » par la devise du Québec « Je me souviens » sur les plaques d'immatriculation des voitures.
Plaque d'immatriculation du Québec. Société de l'assurance automobile du Québec. 1978
Collection Dave Turcotte

Déroulement de la cérémonie d'hommage national à la mémoire de Lise Payette. Gouvernement du Québec. 20 octobre 2018.
Collection Dave Turcotte
Pauline Marois
Première ministre à donner naissance à un enfant durant son mandat (1983)
Première femme élue cheffe d’un parti politique représenté à l’Assemblée nationale (2007)
Première femme élue première ministre (2012)
Femme détenant la plus grande longévité parlementaire avec Louise Harel : 10 101 jours (27 ans, 8 mois)
Par respect pour la longue feuille de route de Pauline Marois, une exposition dédiée uniquement à la vie de celle qui fut la première première ministre du Québec sera ultérieurement présentée par le Musée virtuel d’histoire politique du Québec. Voici donc, bien humblement, quelques grandes lignes sur le parcours politique de celle qui a brisé le plafond de verre plus d’une fois.
Pauline Marois débute sa carrière politique comme attachée de presse du ministre des Finances du Québec, Jacques Parizeau, d’octobre 1978 à mars 1979 puis comme directrice du cabinet de la ministre d’État à la Condition féminine, Lise Payette, de 1979 à 1981.
Lise Ravary dit d'elle : « Si une telle chose existait, ce serait du sang de politicienne qui coulerait dans les veines de Pauline Marois, qui cumule 15 ministères en quelque 30 ans de politique. Difficile de trouver un élu, homme ou femme, qui ait autant d’expérience dans tout le pays ». Elle ajoute : « Mais ce qui intéresse vraiment Pauline Marois, c’est de changer les choses en profondeur. Les ministères qu’elle a gérés en témoignent ; Main-d’œuvre et Sécurité du revenu, Finances, Santé, Éducation, Industrie et Commerce n’en sont quelques-uns. Des postes de “gars”, de “toughs”, en contraste avec son style de gestion. Cris et coups de poing sur la table, ce n’est pas pour elle ».
13 avril 1981
Elle est élue députée du Parti Québécois dans La Peltrie.
30 avril 1981
Elle est assermentée ministre d’État à la Condition féminine dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu’au 9 septembre 1982.
9 septembre 1982
Elle est nommée vice-présidente du Conseil du trésor par le premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu’au 12 décembre 1985.
9 septembre 1982
Elle est assermentée ministre déléguée à la Condition féminine dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu’au 29 novembre 1983.
12 octobre 1983
Elle est la première ministre à donner naissance à un enfant en cours de mandat en Amérique du Nord.
29 novembre 1983
Elle est assermentée ministre de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu dans le cabinet du premier ministre René Lévesque, puis dans le cabinet du premier ministre Pierre-Marc Johnson. Elle occupe cette fonction jusqu’au 12 décembre 1985.
17 juin 1985
Elle est assermentée ministre déléguée à la Condition féminine dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu’au 16 octobre 1985.
29 septembre 1985
Elle est candidate défaite à la direction du Parti Québécois.
2 décembre 1985
Elle est défaite par 6 357 votes face à son adversaire libéral, Lawrence Cannon.
20 juin 1988
Elle est candidate du Parti Québécois défaite à l’élection partielle dans Anjou.
25 septembre 1989
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Taillon.
12 septembre 1994
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Taillon.
26 septembre 1994
Elle est assermentée ministre déléguée à l’Administration et à la Fonction publique et présidente du Conseil du trésor dans le cabinet du premier ministre Jacques Parizeau. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 3 novembre 1995.
31 août 1995
Elle est assermentée ministre responsable de la Condition féminine et ministre de la Sécurité du revenu dans le cabinet du premier ministre Jacques Parizeau. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 12 septembre 1995.
3 novembre 1995
Elle est assermentée ministre des Finances et ministre du Revenu dans le cabinet du premier ministre Jacques Parizeau. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 29 janvier 1996.
29 janvier 1996
Elle est assermentée ministre de l’Éducation dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe cette fonction jusqu’au 15 décembre 1998.
2 juillet 1997
Elle est assermentée ministre de la Famille et de l’Enfance dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe cette fonction jusqu’au 15 décembre 1998.
30 novembre 1998
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Taillon.
15 décembre 1998
Elle est assermentée ministre d’État à la Santé et aux Services sociaux, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre de la Famille et de l’Enfance dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 8 mars 2001.
8 mars 2001
Elle est assermentée vice-première ministre dans le cabinet du premier ministre Bernard Landry. Elle occupe cette fonction jusqu’au 29 avril 2003.
8 mars 2001
Elle est assermentée ministre d’État à l’Économie et aux Finances, ministre des Finances et ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie dans le cabinet du premier ministre Bernard Landry. Elle est la première femme ministre de Finances de l’histoire à déposer un budget au Québec. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 25 septembre 2002.
30 janvier 2002
Elle est assermentée ministre de l’Industrie et du Commerce dans le cabinet du premier ministre Bernard Landry. Elle occupe cette fonction jusqu’au 25 septembre 2002.
25 septembre 2002
Elle est assermentée ministre des Finances, de l’Économie et de la Recherche dans le cabinet du premier ministre Bernard Landry. Elle occupe cette fonction jusqu’au 29 avril 2003.
14 avril 2003
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Taillon.
15 novembre 2005
Candidate défaite à la direction du Parti Québécois.
20 mars 2006
Elle annonce sa démission à titre de députée de Taillon.
26 juin 2007
Elle devint cheffe du Parti Québécois. Elle est la première femme de l’histoire à diriger un parti politique représenté à l’Assemblée nationale du Québec.
24 septembre 2007
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Charlevoix lors d’une élection partielle.
1er octobre 2007
Elle devient cheffe du deuxième groupe d’opposition. Elle occupe cette fonction jusqu’au 5 novembre 2008.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Charlevoix.
15 décembre 2008
Elle devient cheffe de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 1er août 2012.
4 septembre 2012
Elle est élue de nouveau députée dans Charlevoix−Côte-de-Beaupré.
19 septembre 2012
Elle est assermentée première ministre. Elle devient la première première ministre de l’histoire du Québec. Malheureusement, sa victoire est assombrie par un attentat politique dont elle est la cible.
Lise Payette écrit un jour : « “I have a dream”, disait Martin Luther King, un autre merveilleux fou américain qui serait si heureux de voir Barack Obama à la Maison-Blanche. Mon rêve est semblable. Je désire voir une femme diriger mon pays devenu enfin indépendant et parlant fièrement le français. Midi ? Minuit ? Quelle importance ! Il n’est jamais trop tard. » Elle est assurément très fière d’avoir pu réaliser une partie de son rêve avant sa mort.
7 avril 2014
Elle est défaite dans sa circonscription et son gouvernement n’est pas réélu. Elle annonce sa démission à titre de cheffe du Parti Québécois.

Dépliant et macarons de Pauline Marois, candidate à la direction du Parti Québécois suite à la démission de René Lévesque. 1985.
Collection Dave Turcotte
Publicité télévisée rappelant la création des centres de la petite enfance par Pauline Marois. Parti Québécois. Élection 1998.
Collection Dave Turcotte
Publicité télévisée mettant en vedette Valérie Blais invitant les électeurs à élire la première première ministre du Québec. Parti Québécois. Élection 2008.
Collection Dave Turcotte



UNE du journal La Presse. 5 septembre 2012.
Collection Dave Turcotte
UNE du Journal de Montréal. 5 septembre 2012.
Collection Dave Turcotte
Paire de souliers portée par Pauline Marois le soir de son élection à titre de première première ministre de l'histoire du Québec.
Prêt de Véronique Lalande

Édition souvenir de la revue Châtelaine. Septembre 2012.
Collection Dave Turcotte
Huguette Lachapelle
Première femme à occuper la fonction de whip en chef du gouvernement (1984)
Avant d’être elle-même députée, Huguette Lachapelle, est une militante de la première heure du Parti Québécois. Elle fait campagne pour René Lévesque en 1973 dans Laurier et est l’organisatrice de la tournée électorale de Lise Payette dans la circonscription de Dorion en 1976. Après son élection, Lise Payette lui confie la direction de son bureau de circonscription.
13 avril 1981
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Dorion.
Huguette Lachapelle raconte comment elle a succédé à Lise Payette. « Quand nous avons su qu’elle ne se représenterait pas, moi comme tous les autres militants, nous attendions un “gros canon” comme on dit. II n’y avait personne en vue. Dans le comté, on ne voulait pas n’importe qui et, en plaisantant, je disais : “C’est un peu mon comté, alors, je suis prête à travailler avec quelqu’un qui a de l’allure ! ” Et un jour, monsieur Lévesque m’a dit : “Il paraît que c’est vous le ‘gros canon’ de ce comté ! ” J’ai seulement répondu : “Ah oui ? Alors, on se reverra au centre Paul-Sauvé ! ” Techniquement, j’étais prête. On a embarqué. Je m’étais fait connaître, j’avais réglé des tas de dossiers comme secrétaire en l’absence de la ministre. »
22 septembre 1982
Elle est nommée whip adjointe du gouvernement. Elle occupe cette fonction jusqu’au 4 décembre 1984.
4 décembre 1984
Elle est nommée whip en chef du gouvernement. Elle occupe cette fonction jusqu’au 23 octobre 1985.
2 décembre 1985
Elle est défaite par 2 498 face à son adversaire libérale, Violette Trépanier.

Photographie d'Huguette Lachapelle lors de son assermentation à titre de députée de Dorion. Mai 1981.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Fonds Ministère des Communications
Photographe Daniel Lessard
Monique Gagnon-Tremblay
Première femme à occuper la fonction de ministre des Finances (1993)
Première femme à occuper la fonction de présidente du Conseil du trésor (1994)
Première femme à occuper la fonction de présidente du caucus de l’opposition officielle (1994)
Première femme à occuper la fonction de cheffe de l’opposition officielle (1998)
13 avril 1981
Elle est candidate libérale défaite dans Saint-François.
2 décembre 1985
Elle est élue députée libérale dans Saint-François.
12 décembre 1985
Elle est assermentée ministre déléguée à la Condition féminine et des services de garde dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 octobre 1989.
3 mars 1989
Elle est assermentée ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 janvier 1994.
25 septembre 1989
Elle est réélue députée libérale dans Saint-François.
11 octobre 1989
Elle est nommée vice-présidente du Conseil du trésor par le premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 26 septembre 1994.
18 octobre 1993
Elle est assermentée ministre des Finances dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle est la première femme de l’histoire du Québec nommée à ce poste. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 janvier 1994.
11 janvier 1994
Elle est assermentée vice-première ministre, ministre déléguée à l’Administration et à la Fonction publique et présidente du Conseil du trésor dans le cabinet du premier ministre Daniel Johnson, fils. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 26 septembre 1994.
12 septembre 1994
Elle est réélue députée libérale dans Saint-François.
26 septembre 1994
Elle est nommée présidente du caucus de l’opposition officielle. Elle est la première femme de l’histoire du Québec nommée à ce poste. Elle occupe cette fonction jusqu’en 1996.
13 mai 1998
Elle est devient cheffe de l’opposition officielle. Elle est la première femme de l’histoire du Québec nommée à ce poste. Elle occupe cette fonction jusqu’au 28 octobre 1998.
30 novembre 1998
Elle est réélue députée libérale dans Saint-François.
19 janvier 1999
Elle est nommée adjointe du chef de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 12 mars 2003.
14 avril 2003
Elle est réélue députée libérale dans Saint-François.
29 avril 2003
Elle est assermentée vice-première ministre dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe cette fonction jusqu’au 18 février 2005.
29 avril 2003
Elle est assermentée ministre des Relations internationales et de la Francophonie dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe cette fonction jusqu’au 18 décembre 2008.
18 février 2005
Elle est nommée vice-présidente du Conseil du trésor par le premier ministre Jean Charest. Elle occupe cette fonction jusqu’au 18 décembre 2008.
26 mars 2007
Elle est réélue députée libérale dans Saint-François.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée libérale dans Saint-François.
18 décembre 2008
Elle est assermentée présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 10 août 2010.
11 août 2010
Elle est assermentée ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 19 septembre 2012.
4 septembre 2012
Elle ne se représente pas à l’élection.

Mémoires de Monique Gagnon-Tremblay, Une force tranquille. 2022.
Collection Dave Turcotte
Fatima Houda-Pepin
Première femme musulmane élue à l’Assemblée nationale (1994)
12 septembre 1994
Elle est élue députée libérale dans La Pinière. Elle est la première femme musulmane élue à l’Assemblée nationale du Québec.
30 novembre 1998
Elle est réélue députée libérale dans La Pinière.
14 avril 2003
Elle est réélue députée libérale dans La Pinière.
26 mars 2007
Elle est réélue députée libérale dans La Pinière.
8 mai 2007
Elle est élue première vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Elle occupe cette fonction jusqu’au 30 octobre 2012.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée libérale dans La Pinière.
4 septembre 2012
Elle est réélue députée libérale dans La Pinière. Elle siège comme indépendante à partir du 20 janvier 2014.
7 avril 2014
Elle est défaite par 15 503 votes face à son adversaire libéral, Gaétan Barette.
Louise Harel
Première femme à occuper la fonction de présidente de l’Assemblée nationale (2002)
Femme détenant la plus grande longévité parlementaire avec Pauline Marois : 10 101 jours (27 ans, 8 mois)
Louise Harel témoigne : « Aussi loin que je puisse me rappeler j’ai toujours fait de la politique, dans le sens le plus large du mot. Cela date de l’époque où je collectionnais les éditoriaux de Laurendeau dans Le Devoir. Je devais avoir treize ou quatorze. Mon héros était Laurendeau, à cause Commission Laurendeau-Dunton. De plus, je me rappelle très distinctement la mort de Duplessis en 1959. »
Avant d’être députée, Louise Harel est militante et employée du Parti Québécois. De 1979 à 1981, elle occupe la fonction de vice-présidente du Parti où elle sait tenir tête à son chef René Lévesque.
13 avril 1981
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Maisonneuve.
25 septembre 1984
Elle est assermentée ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration dans le cabinet du premier ministre René Lévesque. Elle occupe cette fonction jusqu’au 27 novembre 1984, date de sa démission comme ministre.
2 décembre 1985
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Maisonneuve.
25 septembre 1989
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve.
12 septembre 1994
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve.
26 septembre 1994
Elle est assermentée ministre d’État à la Concertation et ministre de l’Emploi dans le cabinet du premier ministre Jacques Parizeau. Elle occupe cette fonction jusqu’au 29 janvier 1996.
29 janvier 1996
Elle est assermentée ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité, ministre de la Sécurité du revenu et ministre responsable de la Condition féminine dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe ces fonctions jusqu’au 15 décembre 1998.
25 juin 1997
Elle est assermentée ministre de l’Emploi et de la Solidarité dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe cette fonction jusqu’au 15 décembre 1998.
30 novembre 1998
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve.
15 décembre 1998
Elle est assermentée ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe cette fonction jusqu’au 30 janvier 2002.
12 mars 2002
Elle devient présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Elle est la première femme de l’histoire du Québec à atteindre cette responsabilité. Elle occupe cette fonction jusqu’au 4 juin 2003.
14 avril 2003
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve.
6 juin 2005
Elle devient cheffe de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 21 août 2006.
26 mars 2007
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve.
8 décembre 2008
Elle ne se représente pas à l’élection.
En 2009, Louise Harel se lance en politique municipale à Montréal. Le 29 juin 2009, elle devient cheffe de Vision Montréal. Le 1er novembre 2009, elle est défaite à la mairie mais est élue conseillère du district de Maisonneuve–Longue-Pointe. Elle est cheffe de l'opposition au conseil municipal de la Ville de Montréal de 2009 à 2013. Le 2 juillet 2013, elle annonce qu'elle ne se présentera pas à la mairie. Le 3 novembre 2013, elle est défaite dans le district de Sainte-Marie.
Portrait officiel de la présidente Louise Harel, exposé en permanence à l'hôtel du parlement. Huile et feuille d'or sur bois marouflé. Denis Jacques.
Collection Assemblée nationale du Québec


Macaron de la candidate Louise Harel. Parti Québécois. Élection 1981.
Collection Dave Turcotte
Macaron de la candidate Louise Harel. Parti Québécois.
Collection Dave Turcotte


Macaron de la candidate Louise Harel. Parti Québécois. Élection 1981.
Collection Dave Turcotte
Noëlla Champagne
Première femme à devoir reprendre son élection suite à une égalité des voix (2003)
Noëlla Champagne est conseillère municipale à Saint-Louis-de-France de 1988 à 1997 puis attachée politique du député du Parti Québécois dans Champlain, Yves Beaumier, de 1997 à 2003.
14 avril 2003
Elle gagne l’élection, mais suite à un recomptage, une égalité des voix est constatée entre elle et son adversaire libéral, Pierre-A. Brouillette. C’est la deuxième fois qu’une telle situation se produit dans l’histoire électorale du Québec.
20 mai 2003
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Champlain. Elle est la première femme à devoir reprendre son élection suite à une égalité des voix.
26 mars 2007
Elle est défaite par 5 001 votes face à son adversaire adéquiste, Pierre Michel Auger.
8 décembre 2008
Elle est élue de nouveau députée du Parti Québécois dans Champlain.
4 septembre 2012
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Champlain.
7 avril 2014
Elle est défaite par 1 046 votes face à ses adversaires libéral, Pierre Michel Auger, et caquiste, Andrew D’Amours.

Cartons et autocollant de la candidate Noëlla Champagne. Parti Québécois. Élection partielle du 20 mai 2003.
Collection Dave Turcotte
Diane Lemieux
Première femme à occuper la fonction de leader parlementaire de l’opposition officielle (2004)
30 novembre 1998
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Bourget.
15 décembre 1998
Elle est assermentée ministre d’État au Travail et à l’Emploi dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe cette fonction jusqu’au 8 mars 2001.
8 mars 2001
Elle est assermentée ministre d’État à la Culture et aux Communications dans le cabinet du premier ministre Bernard Landry. Elle occupe cette fonction jusqu’au 29 avril 2003.
14 avril 2003
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Bourget.
18 août 2004
Elle est nommée leader parlementaire de l’opposition officielle. Elle est la première femme de l’histoire du Québec nommée à ce poste. Elle occupe cette fonction jusqu’au 21 février 2007.
26 mars 2007
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Bourget.
4 avril 2007
Elle est nommée leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition. Elle occupe cette fonction jusqu’au 27 août 2007.
17 octobre 2007
Elle annonce sa démission à titre de députée de Bourget.
Après son départ de la politique québécoise, elle tente sa chance en politique municipale à Montréal. Candidate défaite d'Union Montréal dans Ahuntsic le 1er novembre 2009, elle devient cheffe de cabinet du maire et du président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle occupe ce poste jusqu'en décembre 2010. De 2011 à 2023, elle est présidente du conseil d’administration et directrice générale de la Commission de la construction du Québec.
Yolande James
Première femme noire élue à l’Assemblée nationale (2004)
20 septembre 2004
Elle est élue députée libérale dans Nelligan lors d’une élection partielle. Elle est la première femme noire élue à l’Assemblée nationale du Québec.
26 mars 2007
Elle est réélue députée libérale dans Nelligan.
18 avril 2007
Elle est assermentée ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe cette fonction jusqu’au 10 août 2010.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée libérale dans Nelligan.
6 mai 2010
Elle est assermentée ministre de la Famille dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe cette fonction jusqu’au 19 septembre 2012.
4 septembre 2012
Elle est réélue députée libérale dans Nelligan.
28 septembre 2012
Elle est nommée leader parlementaire adjointe de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 8 avril 2013.
7 avril 2014
Elle ne se représente pas à l’élection.

Signet de la députée Yolande James. Assemblée nationale du Québec. 2007.
Collection Dave Turcotte
Lisette Lapointe
Première conjointe d'un premier ministre élue à l'Assemblée nationale (2007)
26 mars 2007
Elle est élue députée péquiste dans Crémazie. Elle est la première conjointe d'un premier ministre québécois à se faire l'élire à l'Assemblée nationale.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée péquiste dans Crémazie.
6 juin 2011
Elle siège à titre de députée indépendante.
4 septembre 2012
Elle ne se représente pas.

Signet de la députée Lisette Lapointe. Assemblée nationale du Québec. 2007.
Collection Dave Turcotte
Nicole Léger
Première femme à occuper la fonction de whip en chef de l’opposition officielle (2008)
9 décembre 1996
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles lors d’une élection partielle.
23 septembre 1998
Elle est assermentée ministre déléguée à la Famille et à l’Enfance dans le cabinet du premier ministre Lucien Bouchard. Elle occupe cette fonction jusqu’au 8 mars 2001.
30 novembre 1998
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles.
8 mars 2001
Elle est assermentée ministre déléguée à la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cabinet du premier ministre Bernard Landry. Elle occupe cette fonction jusqu’au 29 avril 2003.
14 avril 2003
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles.
29 avril 2003
Elle est nommée whip adjointe de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 9 septembre 2004.
1er juin 2006
Elle annonce sa démission à titre de députée de Pointe-aux-Trembles.
12 mai 2008
Élue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles lors d’une élection partielle.
7 août 2008
Elle est nommée présidente du caucus du deuxième groupe d’opposition. Elle occupe cette fonction jusqu’au 22 octobre 2008.
22 octobre 2008
Elle est nommée whip du deuxième groupe d’opposition. Elle occupe cette fonction jusqu’au 5 novembre 2008.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles.
16 décembre 2008
Elle est nommée whip en chef de l’opposition officielle. Elle est la première femme de l’histoire à assumer cette responsabilité. Elle occupe cette fonction jusqu’au 1er août 2012.
4 septembre 2012
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles.
19 septembre 2012
Elle est assermentée ministre de la Famille dans le cabinet de la première ministre Pauline Marois. Elle occupe cette fonction jusqu’au 23 avril 2014.
21 septembre 2012
Elle est nommée vice-présidente du Conseil du trésor dans le cabinet de la première ministre Pauline Marois. Elle occupe cette fonction jusqu’au 23 avril 2014.
7 avril 2014
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles.
15 septembre 2015
Elle est nommée présidente du caucus de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 12 mai 2016.
1er octobre 2018
Elle ne se représente pas.

Dépliant de la candidate Nicole Léger. Parti Québécois. Élection partielle du 12 mai 2008.
Collection Dave Turcotte

Carton de la ministre Nicole Léger. Gouvernement du Québec. 2013.
Collection Dave Turcotte
Nicole Ménard
Première femme à occuper la fonction de présidente du caucus du gouvernement (2014)
26 mars 2007
Elle est élue députée libérale dans Laporte.
8 décembre 2008
Elle est réélue députée libérale dans Laporte.
18 décembre 2008
Elle est assermentée ministre du Tourisme dans le cabinet du premier ministre Jean Charest. Elle occupe cette fonction jusqu’au 19 septembre 2012.
4 septembre 2012
Elle est réélue députée libérale dans Laporte.
7 avril 2014
Elle est réélue députée libérale dans Laporte.
14 avril 2014
Elle est nommée présidente du caucus du gouvernement. Elle est la première femme de l’histoire à assumer cette responsabilité. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 octobre 2017.
11 octobre 2017
Elle est nommée whip en chef du gouvernement. Elle occupe cette fonction jusqu’au 23 août 2018.
1er octobre 2018
Elle est réélue députée libérale dans Laporte.
10 octobre 2018
Elle est nommée whip en chef de l’opposition officielle. Elle occupe cette fonction jusqu’au 16 juin 2020.
3 octobre 2022
Elle ne se représente pas.
Catherine Fournier
Plus jeune femme élue à l’Assemblée nationale à l’âge de 24 ans et 7 mois (2016)
5 décembre 2016
Elle est élue députée du Parti Québécois dans Marie-Victorin lors d’une élection partielle. Elle est la plus jeune femme élue à l'Assemblée nationale à l'âge de 24 ans et 7 mois.
1er octobre 2018
Elle est réélue députée du Parti Québécois dans Marie-Victorin.
11 mars 2019
Elle siège à titre de députée indépendante.
13 novembre 2021
Elle donne officiellement sa démission comme députée et est assermentée mairesse de la ville de Longueuil.

Dépliants de la candidate Catherine Fournier. Parti Québécois. Élection partielle du 5 décembre 2016.
Collection Dave Turcotte
Kateri Champagne Jourdain
Première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale (2022)
3 octobre 2022
Elle est élue députée caquiste dans Duplessis. Elle est la première femme autochtone à l'Assemblée nationale.
20 octobre 2022
Elle est assermentée ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord dans le cabinet du premier ministre François Legault.

Carré web de la candidate Kateri Champagne Jourdain. Coalition Avenir Québec. Élection du 3 octobre 2022.
Page Facebook de Kateri Champagne Jourdain
FLORA AU PARLEMENT
Émilise Lessard-Therrien est la première députée québécoise à avoir siégé avec son bébé Flora dans le Salon bleu de l’Assemblée nationale pendant une séance de travaux parlementaires. Il est donc aussi vrai de dire que bébé Flora est la plus jeune femme à avoir siégé au Parlement. Lors de son élection le 1er octobre 2018, elle était déjà la mère d’un enfant d’un an. Pour elle et son conjoint, il n’était pas question de remettre leur projet d’avoir un deuxième enfant rapproché du premier.
À la fin du mois de juin 2020, Émilise Lessard-Therrien donne naissance à la petite Flora. Ce jour-là, la députée de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda--Témiscamingue ne s’attendait à mener une « bataille » qui allait créer un nouveau précédant dans la vie parlementaire. Lors de l’élection de Marie-Claire Kirkland, la première femme élue à l’Assemblée nationale, il y eut tout un débat à savoir si elle devait porter un chapeau et des gants comme les femmes devaient le faire à l’église. À l’arrivée de Pauline Marois au début des années 1980, les femmes ont eu le droit de porter le pantalon au Salon bleu. Quelques années plus tard, les femmes députées ont obtenu l’ajout des semaines de travail en circonscription dans le calendrier parlementaire et la fin des séances nocturne. Il en faut de la patience et de la détermination à ses « premières » pour faire évoluer cette institution bicentenaire.
Pour ce couple abitibien, la conciliation famille et politique est un incontournable. D’autant plus que la distance entre leur résidence et le parlement est immense. Elle a déjà été obligée de rester à Québec pendant 10 jours alors que les avions étaient cloués au sol en raison de mauvaises conditions météorologiques. « Quand tu as de jeunes enfants, ça, c’est dur », nous confie la députée en entrevue téléphonique. La présence de nombreux médias régionaux dans sa circonscription lui fait dire qu’il était difficile pour elle de s’absenter complètement.
Pour cette maman qui souhaite être très présente dans la vie de ses enfants, la possibilité de siéger avec Flora est le seul moyen qui lui permet de continuer à bien exercer sa fonction de députée et de défendre ses dossiers sans devoir mettre sa vie familiale sur pause. Depuis octobre 2020, moment du retour à l’Assemblée nationale de la jeune maman, une salle d’allaitement a été créée avec des tables à langer. Loin d’être parfait, le déploiement du parlement virtuel en raison de la pandémie de COVID-19 devrait permettre de nouvelles avenues pour favoriser la vie familiale des députés. Ne pouvant pas bénéficier d’un « réseau » pour la dépanner à Québec, comme c’est le cas dans sa circonscription, une halte-garderie et une forme de service éducatif seront nécessaires. Elle pense que ça pourrait donner le goût à plus de femmes de faire le saut en politique, mais aussi à celles qui y sont, de s’y investir plus longtemps.
Au Québec, il n’y a pas de congé parental prévu pour les députés. La députée du Parti Québécois dans Joliette, Véronique Hivon, a fait adopter une motion pour instaurer un tel régime. Un autre jalon qui facilitera une plus grande représentativité de la « maison du peuple ».
Émilie Perreault de l’émission L’Avenir nous appartient a suivi Émilise Lessard-Therrien et bébé Flora à l’Assemblée nationale pendant une journée. Voici le lien pour écouter la vidéo.
Sur les modèles pour les femmes en politique
Extrait de l'entrevue de Dave Turcotte avec la députée Émilise Lessard-Therrien.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Pour une Assemblée plus représentative
Extrait de l'entrevue de Dave Turcotte avec la députée Émilise Lessard-Therrien.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Première intervention de bébé Flora à l'Assemblée nationale du Québec. Assemblée nationale du Québec. 20 octobre 2020.
Madame la députée
Les femmes peuvent devenir candidates dès 1940, mais c’est seulement en juillet 1947, dans une élection partielle, qu’une première femme le fait. Lors de l’élection de 1948, deux femmes sont candidates et trois briguent les suffrages en 1952. En 1956, on en compte sept, mais il n’y en a aucune en 1960. Marie-Claire Kirkland, la première députée, est élue en 1961 seulement, plus de 20 ans après l’obtention du droit de vote des femmes. La deuxième élue est Lise Bacon, elle demeure à son tour la seule femme au parlement jusqu’en 1976. Ce n’est qu’à l’élection de 1976 que cinq femmes sont élues en même temps. Elles ont enfin mis le pied dans la porte. Depuis 1940, 196 députées ont été élues à l’Assemblée nationale du Québec. Voici la liste complète :
14 décembre 1961
Élection partielle
Les femmes représentent 1,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
14 novembre 1962
Les femmes représentent 1,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
KIRKLAND, Marie-Claire
5 juin 1966
Les femmes représentent 0,9 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
KIRKLAND, Marie-Claire
29 avril 1970
Les femmes représentent 0,9 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
29 octobre 1973
Les femmes représentent 0,9 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
15 novembre 1976
Les femmes représentent 4,5 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
CUERRIER, Louise
Parti Libéral du Québec
14 novembre 1979
Élection partielle
Les femmes représentent 5,5 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
13 avril 1981
Les femmes représentent 6,5 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
Parti Libéral du Québec
5 décembre 1983
Élections partielles
Les femmes représentent 8,2 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
2 décembre 1985
Les femmes représentent 14,8 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
25 septembre 1989
Les femmes représentent 18,3 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
12 septembre 1994
Les femmes représentent 18,3 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
Parti Libéral du Québec
19 février 1996
Élection partielle
Parti Québécois
9 décembre 1996
Élection partielle
Les femmes représentent 20,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
28 avril 1997
Élections partielles
Parti Québécois
Parti Libéral du Québec
6 octobre 1997
Élection partielle
Les femmes représentent 22,4 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
30 novembre 1998
Les femmes représentent 23,2 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
Parti Libéral du Québec
9 avril 2001
Élection partielle
Les femmes représentent 24,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
1er octobre 2001
Élections partielles
Les femmes représentent 24,8 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
15 avril 2002
Élections partielles
Les femmes représentent 26,4 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
17 juin 2002
Élections partielles
Les femmes représentent 28,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Action démocratique du Québec
14 avril 2003
Les femmes représentent 30,4 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
CHAMPAGNE, Noëlla
CHAREST, Solange
DIONNE-MARSOLAIS, Rita
Action démocratique du Québec
20 septembre 2004
Élections partielles
Les femmes représentent 32,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
14 août 2006
Élection partielle
Les femmes représentent 32,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
26 mars 2007
Les femmes représentent 25,6 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
BEAUCHAMP, Line
GAGNON-TREMBLAY, Monique
Action démocratique du Québec
Parti Québécois
24 septembre 2007
Élection partielle
Les femmes représentent 26,4 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
12 mai 2008
Élections partielles
Les femmes représentent 27,2 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
8 décembre 2008
Les femmes représentent 29,6 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
JAMES, YolandeLibéral
Parti Québécois
Action démocratique du Québec
5 juillet 2010
Élection partielle
Les femmes représentent 29,6 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
4 septembre 2012
Les femmes représentent 32,8 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
Parti Libéral du Québec
Coalition avenir Québec
Québec solidaire
DAVID, Françoise
7 avril 2014
Les femmes représentent 27,2 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
Coalition avenir Québec
Québec solidaire
8 juin 2015
Élection partielle
Les femmes représentent 27,2 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
9 novembre 2015
Élection partielle
Les femmes représentent 28,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
11 avril 2016
Élection partielle
Les femmes représentent 28,8 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Québécois
5 décembre 2016
Élection partielle
Les femmes représentent 29,6 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Parti Libéral du Québec
MELANÇON, Isabelle
Parti Québécois
2 octobre 2017
Élection partielle
Les femmes représentent 29,6 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Coalition avenir Québec
1er octobre 2018
Les femmes représentent 42,4 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Coalition avenir Québec
BLAIS, Marguerite
Parti Libéral du Québec
DAVID, Hélène
GAUDREAULT, Maryse
MACCARONE, Jennifer
MELANÇON, Isabelle
MÉNARD, Nicole
MONTPETIT, Marie
Parti Québécois
Québec solidaire
DORION, Catherine
GHAZAL, Ruba
LESSARD-THERRIEN, Émilise
MASSÉ, Manon
10 décembre 2018
Élection partielle
Les femmes représentent 43,2 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Coalition avenir Québec
GUILLEMETTE, Nancy
2 décembre 2019
Élection partielle
Les femmes représentent 44,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Coalition avenir Québec
11 avril 2022
Élection partielle
Les femmes représentent 44,0 % des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Coalition avenir Québec
3 octobre 2022
Les femmes représentent 46% des sièges
de l'Assemblée nationale du Québec.
Coalition avenir Québec
Parti Libéral du Québec
Québec solidaire
MADAME LA DÉPUTÉE
Fascicules présentant les 32 et 36 femmes élues à l’Assemblée nationale du Québec lors des élections du 26 mars 2007 et du 8 décembre 2008. L’élection de 2007 marque un recul de la présence des députées à l’Assemblée nationale du Québec depuis que les femmes ont le droit de vote en 1940. En 1976, la représentation féminine à l’Assemblée devient plurielle, les cinq élues occupant 4,5 % des sièges. Jusqu’en 2006, chaque échéance électorale a pour effet de maintenir ou d’augmenter le contingent de femmes. En 1985, les élues forment pour la première fois plus de 10 % de la députation (14,8 %) et elles atteignent 20 % en 1996. Lors de la dernière élection en 2018, l’Assemblée nationale entre dans la « zone paritaire » pour la première fois de l’histoire du Québec avec un contingent de 42,8 % de femmes.
Qui sont-elles ? Les députées de la 38e législature. Conseil du statut de la femme. 2007.
Collection Dave Turcotte
Qui sont-elles ? Les députées de la 39e législature. Conseil du statut de la femme. 2009.
Collection Dave Turcotte

Plus les femmes sont présentent à l'Assemblée nationale, plus la condition de vie des femmes québécoises s'améliore. Dans le but de mettre en lumière le travail des femmes parlementaires, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec a produit un tableau des projets de loi présentés par les députées à l’Assemblée nationale du Québec, de 1962 à aujourd’hui.
Une de la revue L'Actualité mettant notamment en vedette les députées Monique Jérôme-Forget, Monique Gagnon-Tremblay, Louise Harel, Jeanne Blackburn. L'Actualité. Janvier 2007.
Collection Simon Turmel

Publicité illustrant le premier conseil des ministres paritaire de l’histoire du Québec, celui du gouvernement libéral du premier ministre Jean Charest.
Publicité du gouvernement du Québec dans l'édition spéciale soulignant le 50e anniversaire de la revue Châtelaine. Châtelaine. Novembre 2010.
Collection Dave Turcotte

Page couverture du magazine La Gazette des femmes de janvier-février 1991. Volume 12, numéro 5. Conseil du statut de la femme.
Collection Dave Turcotte
1976
La politique de pères en filles
Françoise David
Françoise David est une militante dans le sens noble du terme. Féministe engagée, elle s’implique aussi dans la lutte à la pauvreté. Elle est notamment organisatrice communautaire au Centre des services sociaux de Montréal (1972 à 1986), coordonnatrice du Regroupement des centres de femmes du Québec (1987 à 1994), présidente de la Fédération des femmes du Québec (1994 à 2001). En 2004, elle fonde et devient porte-parole féminine et permanente au sein du mouvement politique Option citoyenne. En 2006, Option citoyenne fusionne avec l'Union des forces progressistes pour former Québec solidaire dont elle devient coporte-parole.
Elle est l’arrière-petite-fille du député et sénateur Laurent-Olivier David, la petite-fille du député, ministre et sénateur Athanase David, la fille du sénateur Paul David et la sœur de la députée et ministre d’Hélène David.
26 mars 2007
Elle est candidate défaite de Québec solidaire dans Gouin.
8 décembre 2008
Elle est candidate défaite de Québec solidaire dans Gouin.
4 septembre 2012
Elle est élue députée de Québec solidaire dans Gouin.
7 avril 2014
Elle est réélue députée de Québec solidaire dans Gouin.
19 janvier 2017
Elle annonce sa démission à titre de députée de Gouin.

Dépliant du programme de Québec Solidaire.
Québec Solidaire. Élection 2012.
Collection Alain Lavigne
Dépliant de la candidate Françoise David. Québec Solidaire. Élection 2012.
Collection Dave Turcotte

Jocelyne Ouellette est élue députée du Parti Québécois dans Hull en 1976. Elle est ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement dans le cabinet Lévesque du 6 juillet 1977 au 30 avril 1981. Elle est défaite à l'élection de 1981.
Journal Le Jour. Volume 1, numéro 20. 17 au 23 juin 1977.
Collection Dave Turcotte
Macaron de la candidate Jocelyne Ouellette. Parti Québécois. Élection 1981.
Collection Dave Turcotte


1981

Carmen Juneau est candidate du Parti Québécois défaite dans Johnson à l'élection partielle du 17 novembre 1980. Elle est élue députée du Parti Québécois dans Johnson en 1981. Elle est réélue en 1985 et en 1989. Elle ne se représente pas en 1994.
Macaron de la candidate Carmen Juneau. Parti Québécois. Élection 1989.
Collection Simon Turmel
Joan Dougherty est élue députée libérale dans Jacques-Cartier en 1981. Elle est réélue en 1985. Elle est défaite en 1989.
Macon de la candidate Joan Dougherty. Parti libéral du Québec. Élection 1985.
Collection Simon Turmel

1983
Aline Saint-Amand est élue députée libérale dans Jonquière à l'élection partielle du 5 décembre 1983. Elle est défaite en 1985 et en 1989.
Macon de la candidate Aline Saint-Amand. Parti libéral du Québec. Élection 1985.
Collection Simon Turmel

1985

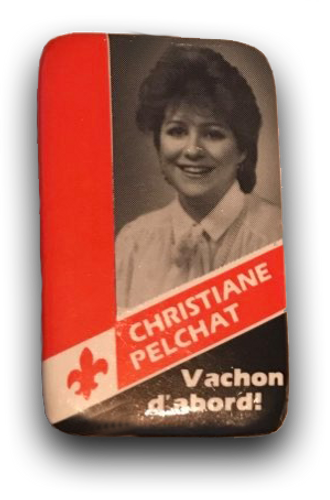
Christiane Pelchat est élue députée libérale dans Vachon en 1985. Elle est réélue en 1989. Elle ne se représente pas en 1994.
Affiche autographiée de la candidate Christiane Pelchat. Parti libéral du Québec. Élection 1985.
Collection Dave Turcotte
Macon de la candidate Christiane Pelchat. Parti libéral du Québec. Élection 1989.
Collection Simon Turmel

Violette Trépanier est élue députée libérale dans Dorion en 1985. Elle est réélue en 1989. Elle est adjointe parlementaire au ministre des Affaires municipales du 13 décembre 1985 au 3 mars 1989. Elle est ministre déléguée aux Communautés culturelles dans le cabinet Bourrassa du 3 mars au 11 octobre 1989 et ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la Famille du 11 octobre 1989 au 11 janvier 1994. Elle est ministre déléguée à la Condition féminine et à la Famille et ministre de la Sécurité du Revenu dans le cabinet Johnson (Daniel fils) du 11 janvier au 26 septembre 1994. Elle ne se représente pas en 1994.
Feuillet Le patrimoine familial : une question de justice présenté par la ministre Violette Trépanier. Gouvernement du Québec. 1990.
Collection Dave Turcotte
Don d'Alain Lavigne
Macaron de la candidate Violette Trépanier. Parti libéral du Québec. Élection 1985.
Collection Simon Turmel

1989
Luce Dupuis est élue députée du Parti Québécois dans Verchères en 1989. Elle est défaite lors de la convention de ce parti dans Borduas le 16 août 1994. Elle ne se représente pas en 1994.
Dépliant de la députée Luce Dupuis. Assemblée nationale du Québec. Juin 1990.
Collection Dave Turcotte


Denise Carrier-Perreault est élue députée du Parti Québécois dans Chutes-de-la-Chaudière en 1989. Elle est réélue en 1994 et en 1998. Elle est vice-présidente de la Commission de l'aménagement et des équipements du 1er décembre 1994 au 29 janvier 1996. Elle est ministre déléguée aux Mines, aux Terres et aux Forêts dans le cabinet Bouchard du 29 janvier 1996 au 25 février 1998 et ministre déléguée aux Mines et aux Terres du 25 février au 15 décembre 1998. Elle est présidente de la Commission de l'économie et du travail du 4 mars 1999 au 27 mars 2001. Elle est leader parlementaire adjointe du gouvernement du 9 mars 2001 au 13 mars 2002 et vice-présidente de la Commission des affaires sociales du 13 mars 2002 au 12 mars 2003. Elle ne se représente pas en 2003.
Dépliant de la députée Denise Carrier-Perreault. Assemblée nationale du Québec. Juin 1994.
Collection Dave Turcotte
1994

Louise Beaudoin est candidate du Parti Québécois défaite dans Jean-Talon en 1976 et à l’élection partielle du 20 avril 1979. Elle est ministre des Relations internationales dans le cabinet Johnson (Pierre Marc) du 16 octobre au 12 décembre 1985. Elle est défaite dans Louis-Hébert en 1985. Elle est élue députée du Parti Québécois dans Chambly en 1994. Elle est réélue en 1998. Elle est ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes dans le cabinet Parizeau du 26 septembre 1994 au 29 janvier 1996, ministre de la Culture et des Communications du 3 août 1995 au 15 décembre 1998. Elle est ministre des Relations internationales dans le cabinet Bouchard du 15 décembre 1998 au 8 mars 2001 puis dans le cabinet Landry du 8 mars 2001 au 29 avril 2003. Elle est défaite en 2003. Elle est élue députée du Parti Québécois dans Rosemont en 2008. Elle est Vice-présidente de la Commission de la santé et des services sociaux du 10 février au 22 septembre 2010. Elle siège comme indépendante à partir du 6 juin 2011. Elle réintégre le caucus du Parti Québécois le 3 avril 2012. Elle ne se représente pas en 2012.
Affiche de la candidate Louise Beaudoin. Parti Québécois. Élection 1994.
Collection Dave Turcotte

Danielle Doyer est élue députée du Parti Québécois dans Matapédia en 1994. Elle est réélue en 1998, en 2003, en 2007 et en 2008. Elle est déléguée régionale du Bas-Saint-Laurent et adjointe parlementaire au premier ministre du 24 avril 1995 au 29 janvier 1996, adjointe parlementaire au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et secrétaire régionale pour la région du Bas-Saint-Laurent du 29 janvier 1996 au 28 octobre 1998 et adjointe parlementaire au ministre des Régions du 28 janvier 1999 au 21 mars 2001. Elle est vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire du 27 mars 2001 au 12 mars 2003, vice-présidente de la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du 15 janvier au 25 août 2009 et présidente de la Commission des transports et de l'environnement du 27 août 2009 au 1er août 2012. Elle ne se représente pas en 2012.
Affiche de la candidate Danielle Doyer. Parti Québécois. Élection 1994.
Collection Dave Turcotte
Don de Pascal Bérubé

Marie Malavoy est élue députée du Parti Québécois dans Sherbrooke en 1994. Elle est ministre de la Culture et des Communications dans le cabinet Parizeau du 26 septembre 1994 au 25 novembre 1994. Elle est défaite en 1998. Elle est élue députée du Parti Québécois dans Taillon à l'élection partielle du 14 août 2006. Elle est réélue en 2007, en 2008 et en 2012. Elle est ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cabinet Marois du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014. Elle ne se représente pas en 2014.
Dépliants de la candidate Marie Malavoy. Parti Québécois. Élection partielle du 14 août 2006.
Collection Dave Turcotte
1997

Michèle Lamquin-Éthier est élue députée libérale dans Bourassa à l'élection partielle du 6 octobre 1997. Elle est réélue en 1998 et en 2003 dans Crémazie. Elle est leader parlementaire adjointe du gouvernement du 29 avril 2003 au 19 octobre 2005 et du 22 décembre 2005 au 21 février 2007. Elle est défaite en 2007.
Carton de la candidate Michèle Lamquin-Éthier. 2007.
Collection Dave Turcotte
1998


Agnès Maltais est élue députée du Parti Québécois dans Taschereau en 1998. Elle est réélue en 2003, en 2007, en 2008, en 2012 et en 2014. Elle est ministre de la Culture et des Communications dans le cabinet Bouchard du 15 décembre 1998 au 8 mars 2001. Dans le cabinet Landry, elle est ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la Jeunesse du 8 mars 2001 au 30 janvier 2002 et ministre déléguée à l'Emploi du 30 janvier 2002 au 29 avril 2003. À l'opposition officielle, elle est présidente du caucus du 29 avril 2003 au 21 février 2007 et leader parlementaire adjointe du 16 décembre 2008 au 21 septembre 2010. Elle est vice-présidente de la Commission des finances publiques du 5 octobre 2010 au 1er août 2012. Dans le cabinet Marois, du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014, elle est ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la Capitale-Nationale. De retour à l'opposition officielle, elle est leader parlementaire du 23 avril 2014 au 16 mai 2015 et leader parlementaire adjointe du 16 mai 2015 au 12 mai 2016. Elle est vice-présidente de la Commission des institutions du 24 août 2016 au 1er novembre 2016, puis vice-présidente de la Commission de la culture et de l'éducation jusqu'au 23 août 2018. Elle ne se représente pas en 2018.
Dépliant de la députée Agnès Maltais. Assemblée nationale du Québec.
Collection Dave Turcotte
Dépliant de la candidate Agnès Maltais. Parti Québécois. Élection 2012.
Collection Dave Turcotte


Linda Goupil est élue députée du Parti Québécois dans Lévis en 1998. Elle est ministre de la Justice et de la Condition féminine dans le cabinet Bouchard du 15 décembre 1998 au 8 mars 2001. Elle est ministre d'État à la Famille et à l'Enfance dans le cabinet Landry du 8 mars 2001 au 30 janvier 2002. Elle est ministre d'État à la Solidarité sociale, à la Famille et à l'Enfance du 30 janvier 2002 au 29 avril 2003. Ell est défaite en 2003, en 2007, puis dans Bellechasse en 2014.
Carte de vœux de Noël de la ministre Linda Goupil. Gouvernement du Québec. 2000.
Collection Dave Turcotte
Carton de la candidate Linda Goupil. Parti Québécois. Élection 2014.
Collection Dave Turcotte
2002



Sylvie Lespérance est candidate libérale défaite dans Joliette en 1989 et en 1998. Elle est élue députée de l’ADQ dans Joliette à l’élection partielle du 17 juin 2002. Elle est, avec Marie Grégoire, la première femme élue députée de son parti. Elle est défaite en 2003. Décédée en 2006, un nouveau Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) porte son nom depuis septembre 2019. Elle est assurément une des premières femmes députées à s’inscrire dans la toponymie québécoise.
Dépliant de la candidate Sylvie Lespérance. Action démocratique du Québec. Élection partielle du 17 juin 2002.
Collection Dave Turcotte
Photographie du Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance à Joliette. 2019.



Marie Grégoire est candidate de l'ADQ défaite dans L'Assomption en 1998. Elle est élue députée de l'ADQ dans Berthier à l'élection partielle du 17 juin 2002. Elle est défaite en 2003.
Dépliant de la candidate Marie Grégoire. Action démocratique du Québec. Élection partielle du 17 juin 2002.
Collection Dave Turcotte
Une du journal La Presse annonçant la victoire de Marie Grégoire dans Berthier lors de l'élection partielle du 17 juin 2002.
Journal La Presse. 18 juin 2002.
Collection Dave Turcotte
2003
Carole Théberge est élue députée libérale dans Lévis en 2003. Elle est ministre déléguée à la Famille dans le cabinet Charest du 29 avril 2003 au 18 février 2005 puis ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du 18 février 2005 au 18 avril 2007. Elles est défaite à l'élection de 2007.
Macaron de la candidate Carole Théberge. Parti libéral du Québec. Élection 2007.
Collection Dave Turcotte


Sylvie Roy est élue députée de l'ADQ dans Lotbinière en 2003. Elle est réélue en 2007 et en 2008, puis réélue sous la bannière de la Coalition avenir Québec dans Arthabaska en 2012 et en 2014. Elle est leader parlementaire adjointe de l'opposition officielle du 4 avril 2007 au 5 novembre 2008. Elle est cheffe intérimaire de l'ADQ du 26 février au 18 octobre 2009 et cheffe du deuxième groupe d'opposition du 21 avril au 29 octobre 2009. Elle est leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition du 29 octobre 2009 au 14 février 2012. Elle décède en fonction, le 31 juillet 2016, à l'âge de 51 ans et 8 mois.
Signet funéraire de Sylvie Roy. 2016.
Collection Dave Turcotte
2004
Elsie Lefebvre est élue députée du Parti Québécois dans Laurier-Dorion à l'élection partielle du 20 septembre 2004. Elle est défaite en 2007.
Carte professionnelle de la candidate Elsie Lefebvre. Parti Québécois. Élection partielle du 20 septembre 2004.
Collection Dave Turcotte
Macarons de la candidate Elsie Lefebvre. Parti Québécois. Élection 2007.
Collection Dave Turcotte
Don de Pascal Bérubé



2007
Lucille Méthé est candidate défaite de l'ADQ dans Iberville en 2003. Elle est élue députée de l'ADQ dans Saint-Jean en 2007. Elle est la première femme députée de l'histoire de cette circonscription. Elle est whip adjointe de l'opposition officielle du 4 avril 2007 au 15 mai 2008. Elle est défaite à l'élection de 2008.
Dépliant de la candidate Lucille Méthé. Action démocratique du Québec. Élection 2007.
Collection Dave Turcotte

Dépliant de la candidate Lucille Méthé. Action démocratique du Québec. Élection 2008.
Collection Dave Turcotte

2008
Carole Poirier est élue députée du Parti Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve en 2008. Elle est réélue en 2012 et en 2014. Elle est première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec du 30 octobre 2012 au 20 mai 2014. Elle est whip en chef de l'opposition officielle du 14 octobre 2016 au 2 février 2018. Elle est leader parlementaire adjointe de l'opposition officielle du 2 février au 8 avril 2018 et leader parlementaire de l'opposition officielle du 8 avril au 15 mai 2018, puis leader parlementaire adjointe de l'opposition officielle du 15 mai au 23 août 2018. Elle est défaite en 2018.
Macaron de la candidate Carole Poirier. Parti Québécois. Élection 2012.
Collection Dave Turcotte


Marie Bouillé est candidate défaite du Parti Québécois dans Iberville en 2007. Elle est élue députée du Parti Québécois dans Iberville en 2008. Elle est la première femme députée de l'histoire de cette circonscription. Elle est réélue en 2012. Elle est défaite en 2014.
Dépliant de la candidate Marie Bouillé. Parti Québécois. Élection 2008.
Collection Dave Turcotte
2010

Martine Ouellet est élue députée du Parti Québécois dans Vachon à l'élection partielle du 5 juillet 2010. Elle est réélue en 2012 et en 2014. Elle est ministre des Ressources naturelles dans le cabinet Marois du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014. Elle est vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire du 2 juin 2014 au 5 février 2017. Elle est candidate défaite à la chefferie du Parti Québécois le 15 mai 2015 et le 7 octobre 2016. Elle siège comme députée indépendante à partir du 5 février 2017. Elle devint la première femme cheffe du Bloc Québécois le 18 mars 2017 et démissionne de ce poste le 11 juin 2018. Elle ne se représente pas en 2018. Elle devient cheffe de Climat Québec, nouveau parti politique québécois dont elle est la fondatrice, à partir du 2 août 2021. Elle est candidate défaite de Climat Québec dans Marie-Victorin à l'élection partielle du 11 avril 2022 et à l'élection générale de 2022. Elle est candidate défaite de ce parti dans Jean-Talon à l'élection partielle du 2 octobre 2023.
Dépliants et accroche-porte de la candidate Martine Ouellet. Parti Québécois. Élection partielle du 5 juillet 2010.
Collection Dave Turcotte
2012
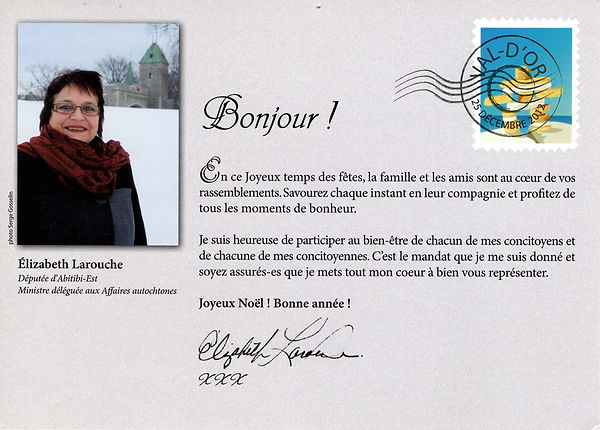

Élizabeth Larouche est élue députée du Parti Québécois dans Abitibi-Est en 2012. Elle est ministre déléguée aux Affaires autochtones dans le cabinet Marois du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014. Elle est défaite en 2014 et en 2018.
Carte de souhaits de Noël et de la nouvelle année de la ministre Élizabeth Larouche. Gouvernement du Québec. 2012.
Collection Dave Turcotte
Dépliant du bilan de la première année de mandat de la ministre Élizabeth Larouche. Gouvernement du Québec. 2013.
Collection Dave Turcotte

Suzanne Proulx est élue députée du Parti Québécois dans Sainte-Rose en 2012. Elle est adjointe parlementaire à la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles (volet intégration des immigrants) du 20 septembre 2012 au 24 octobre 2012. Elle est adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Condition féminine du 24 octobre 2012 au 5 mars 2014. Elle est vice-présidente de la Commission de la santé et des services sociaux du 5 décembre 2012 au 5 mars 2014. Elle est défaite en 2014. Elle devient présidente du Bloc Québécois le 21 mai 2023.
Carton de la députée Suzanne Proulx. Assemblée nationale du Québec. 2013.
Collection Dave Turcotte

Jeannine Richard est candidate défaite du Parti Québécois dans Îles-de-la-Madeleine en 2008. Elle est élue députée du Parti Québécois dans Îles-de-la-Madeleine en 2012. Elle est adjointe parlementaire au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet pêcheries) du 20 septembre 2012 au 5 mars 2014. Elle est défaite en 2014.
Carton d'invitation de la députée Jeannine Richard. Assemblée nationale du Québec. 2012.
Collection Dave Turcotte

Karine Vallière est élue députée libérale dans Richmond en 2012. Elle est réélue en 2014. Elle est whip adjointe du gouvernement du 14 avril 2014 au 3 février 2016. Elle ne se représente pas en 2018.
Dépliants de la députée Karine Vallière. Assemblée nationale du Québec.
Collection Dave Turcotte
Don de Karine Vallière
2014

Dépliant de la candidate Manon Massé. Québec solidaire. Élection 2014.
Collection Dave Turcotte
Manon Massé est candidate défaite de Québec solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques en 2006, 2007, 2008 et 2012. Fait à noter, elle est la première candidate de l'histoire à se présenter sous la bannière de Québec solidaire. Elle est finalement élue députée en 2014. Elle est cheffe du troisième groupe d’opposition du 10 octobre 2018 au 20 mars 2019 et du deuxième groupe d’opposition du 21 mars 2019 au 1 août 2021. Elle est réélue en 2022. Elle est Vice-présidente de la Commission des relations avec les citoyens depuis le 6 décembre 2022.
Publicité de la candidate Manon Massé. Québec solidaire. Élection partielle du 10 avril 2006.
Collection Dave Turcotte


Macaron de la candidate Manon Massé. Québec solidaire. Élection 2018.
Collection Dave Turcotte
2015


Véronyique Tremblay est élue députée libérale dans Chauveau à l’élection partielle du 8 juin 2015 face à son adversaire caquiste Jocelyne Cazin, elle aussi vedette de la télévision. Elle est assermentée ministre déléguée aux Transports dans le cabinet Couillard le 11 octobre 2017. Elle occupe cette fonction jusqu’au 18 octobre 2018. Elle est défaite en 2018.
Photo des affiches des candidates Véronyque Tremblay (Parti libéral du Québec) et Jocelyne Cazin (Coalition avenir Québec). Élection partielle du 8 juin 2015.
Collection Dave Turcotte
Photo de l'affiche de la candidate libérale Véronyque Tremblay. Parti Libéral du Québec. Élection partielle du 8 juin 2015.
Collection Dave Turcotte


Dominique Anglade est élue députée libérale dans Saint-Henri–Sainte-Anne le 9 novembre 2015. Elle est réélue en 2018 et en 2022. Dans le cabinet Couillard, elle est ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 28 janvier 2016 au 18 octobre 2018, ministre responsable de la Stratégie numérique du 28 janvier 2016 au 18 octobre 2018, vice-première ministre du 11 octobre 2017 au 23 août 2018, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs suppléante du 29 novembre 2017 au 8 décembre 2017 et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec suppléante du 29 novembre 2017 au 8 décembre 2017. Elle est vice-présidente de la Commission des institutions du 4 décembre 2018 au 17 juin 2020. Le 11 mai 2020, elle devient la première femme cheffe de l'histoire du Parti libéral du Québec. Elle est cheffe de l’opposition officielle du 11 mai 2020 au 28 août 2022, puis du 12 octobre au 7 novembre 2022. Elle démissionne le 1er décembre 2022.
Affiche de la candidate Dominique Anglade. Parti libéral du Québec. Élection partielle du 9 novembre 2015.
Collection Dave Turcotte
Macaron de la candidate Dominique Anglade. Chefferie du Parti libéral du Québec. 2020.
Collection Simon Turmel
2016




Isabelle Melançon est candidate libérale défaite dans Saguenay à l'élection partielle du 5 avril 2002. Elle est élue députée libérale dans Verdun le 5 décembre 2016. Elle est réélue en 2018. Elle est ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cabinet Couillard du 11 octobre 2017 au 18 octobre 2018. Elle est leader parlementaire adjointe de l’opposition officielle du 18 octobre 2018 au 16 juin 2020. Elle est vice-présidente de la Commission des finances publiques du 17 juin 2020 au 28 août 2022. Elle est défaite en 2022.
Publicité de la candidate Isabelle Melançon. Parti libéral du Québec. Élection partielle du 5 avril 2002.
Collection Dave Turcotte
Signet de la députée Isabelle Melançon. Assemblée nationale du Québec. 2016
Collection Dave Turcotte
Accroche-porte de la candidate Isabelle Melançon. Parti libéral du Québec. 2022.
Collection Dave Turcotte
Don d'Isabelle Melançon
2018

Jennifer Maccarone est élue députée libérale dans Westmount–Saint-Louis en 2018. Elle est réélue en 2022. Elle est vice-présidente de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles du 4 novembre 2021 au 28 août 2022. Elle est présidente de la Commission des transports et de l’environnement depuis le 6 décembre 2022.
Dépliant de la députée Jennifer Maccarone. Assemblée nationale du Québec. 2019.
Collection Dave Turcotte

Isabelle Charest est élue députée caquiste dans Brome-Missisquoi en 2018. Elle est réélue en 2022. Elle est ministre déléguée à l’Éducation du 18 octobre 2018 au 20 octobre 2022 et ministre responsable de la Condition féminine du 5 février 2019 au 20 octobre 2022. Elle est ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air depuis le 20 octobre 2022.
Affiche de la candidate Isabelle Charest. Coalition Avenir Québec. 2022.
Collection Dave Turcotte


Méganne Perry Mélançon est élue députée du Parti Québécois dans Gaspé en 2018. Elle est défaite en 2022. Elle est la porte-parole du Parti Québécois depuis janvier 2023.
Dépliant de la candidate Méganne Perry Mélançon. Parti Québécois. 2018.
Collection Dave Turcotte
Don de Pascal Bérubé
2022

Maïté Blanchette Vézina est élue députée caquiste dans Rimouski en 2022. Elle est ministre des Ressources naturelles et des Forêts depuis le 20 octobre 2022 et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine depuis le 20 octobre 2022.
Affiche de la candidate Maïté Blanchette Vézina. Coalition Avenir Québec. 2022.
Collection Dave Turcotte
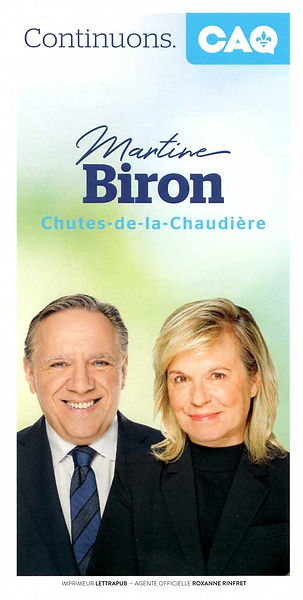

Martine Biron est élue députée caquiste dans Chutes-de-la-Chaudière en 2022. Elle est ministre des Relations internationales et de la Francophonie depuis le 20 octobre 2022. Elle est ministre responsable de la Condition féminine depuis le 20 octobre 2022.
Carton de la candidate Martine Biron. Coalition Avenir Québec. 2022.
Collection Dave Turcotte
Don de Martine Biron


Audrey Bogemans est élue députée caquiste dans Iberville en 2022. Elle est présidente de séance depuis le 2 décembre 2022.
Carton de la candidate Audrey Bogemans. Coalition Avenir Québec. 2022.
Collection Dave Turcotte

Alejandra Zaga Mendez est candidate défaite de Québec solidaire dans Bourassa-Sauvé en 2018. Elle est présidente de Québec solidaire du 21 novembre 2021 au 3 octobre 2022. Elle est élue députée de Québec solidaire dans Verdun en 2022. Elle est Whip du deuxième groupe d’opposition depuis le 26 mai 2023. Elle est membre du Bureau de l’Assemblée nationale depuis le 26 mai 2023.
Dépliant de la candidate Alejandra Zaga Mendez. Québec solidaire. 2022.
Collection Dave Turcotte
Don de Benoit Chartrand
Mots de femmes
Dans son livre, Le pouvoir ? Connais pas !, Lise Payette écrit : « la cause des femmes, la plus importante minorité du monde, a toujours été mon engagement premier, premier dans ma prise de conscience personnelle, et premier dans la priorité de mes causes. Depuis le début des années 1960, j’ai fait le cheminement classique des Québécoises sans modèle vers la définition, l’articulation et l’expression de mon identité de femme. Il y avait longtemps, en 1976, que j’avais constaté qu’en dehors de la crise profonde des mentalités, la solution à nombre de problèmes identifiés par les femmes quant à leur statut inférieur se trouvait dans les parlements. Égalité juridique, égalité des chances au travail comme dans l’éducation, contrôle de la santé et accès aux services qui favorisent l’autonomie des femmes comme les garderies et les congés de maternité, les solutions étaient souvent à Québec. Peu organisées, et c’est ce qui en fait une minorité alors qu’on devrait parler de majorité, les femmes ont longtemps toléré d’avoir peu ou pas de représentantes sur le plan politique. À Québec, deux femmes dans toute l’histoire du Parlement avant 1976 : Claire Kirkland-Casgrain dans le gouvernement Lesage et Lise Bacon dans le gouvernement Bourassa. […] Seules au sein du pouvoir, au moment où l’opinion publique féminine était beaucoup moins en alerte que maintenant, elles ont dû faire la démonstration de leur capacité d’être des hommes politiques pour être seulement admises dans le club très privé des honorables. Leurs témoignages nous manquent ».
Constatant que trop peu de femmes politiques ont écrit leurs mémoires, nous avons cru pertinent de terminer cette exposition en donnant la parole à des ex-parlementaires des différentes tendances politiques québécoises pour nous raconter quelques moments de leur passage en politique.
1. Lise Bacon
Émission Mémoires de députés
2. Nicole Léger
Entrevue de Dave Turcotte
3. Marie Grégoire
Entrevue de Dave Turcotte
4. Françoise David
Entrevue de Dave Turcotte
Bon visionnement !
MOTS DE FEMMES
Première partie de l'entrevue de Lise Bacon à l'émission Mémoires de députés.
Assemblée nationale du Québec
Deuxième partie de l'entrevue de Lise Bacon à l'émission Mémoires de députés.
Assemblée nationale du Québec
Entrevue de Nicole Léger avec Dave Turcotte. 2 mars 2021.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Entrevue de Marie Grégoire avec Dave Turcotte. 2 mars 2021.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Entrevue de Françoise David avec Dave Turcotte. 2 mars 2021.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Conférence de Dave Turcotte en direct sur Facebook sur l'exposition Femmes & politique. 13 mars 2021.
Musée virtuel d'histoire politique du Québec
Sources
Livres
Baillargeon, Denyse (2019). Repenser la nation. L'histoire du suffrage féminin au Québec. Les éditions du remue-ménage.
Black, Conrad (1977). Duplessis : L'ascension. Les éditions de l'Homme.
Conseil du statut de la femme (1978). Pour les Québécoises: égalité et indépendance. Éditeur officiel du Québec.
Forget, Nicolle (2013). Thérèse Casgrain. La gauchiste en collier de perles. Groupe Fides.
Guay, Jean-Herman et Serge Gaudreau (2018). Les élections au Québec : 150 ans d’une histoire mouvementée. Les presses de l’Université Laval.
Lacoursière, Jacques (2020). Histoire populaire du Québec moderne : 2. L'autonomie provinciale, 1933-1960. Bibliothèque québécoise.
Lisée, Jean-François (1993). Les Prétendants. Qui sera le prochain premier ministre du Québec ?. Les Éditions du Boréal et Jean-François Lisée.
Payette, Lise (2010). Le pouvoir ? Connais pas !. Athéna Éditions.
Pelletier-Baillargeon, Hélène (1985). Marie Gérin-Lajoie. De mère en fille, la cause des femmes. Les Éditions du Boréal Express.
Proulx, Gilles (2020). Ces audacieuses qui ont façonné le Québec. Les éditions du Journal.
Robin, Marie-Jeanne (1983). La politique au féminin. Inédi.
Revues
Châtelaine (édition spéciale de novembre 2010). Spécial 50 ans. On en a fait du chemin! Hommage aux femmes qui bâtissent le Québec. Éditions Rogers
Assemblée nationale du Québec (2010). Femmes et vie politique. De la conquête du droit de votes à nos jours. Assemblée nationale du Québec.
Articles
Lanthier, Stéphanie (2009, mise à jour en 2017). « Idola Saint-Jean ». L'Encyclopédie canadienne, Historica Canada.
Sicotte, Anne-Marie (2011, Volume 17). « LACOSTE, MARIE (GÉRIN-LAJOIE) ». Dictionnaire biographique du Canada, Université Laval/University of Toronto.
Stoddart, Jennifer (2008, mise à jour en 2015). « Thérèse Casgrain ». L'Encyclopédie canadienne, Historica Canada.
Audiovisuel
Payette Renouf, Flavie et Jean-Claude Lord (2013). Lise Payette : Un peu plus haut, un peu plus loin. Productions J.
Sites
Répertoire du patrimoine culturel du Québec
















